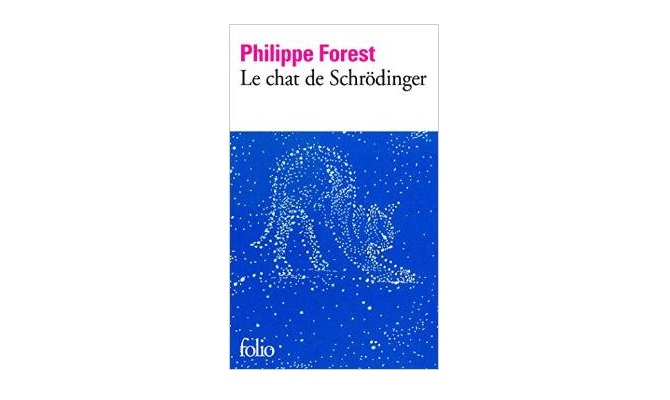Hier, dimanche 16 novembre, au soir, passant devant une des bibliothèques du salon, mon regard se pose sur la tranche de Rameaux, un essai de Michel Serres, lu voici quelques années déjà. Pourquoi ce livre ? A ce moment, je ne sais pas. Et puis c'est juste un regard, une ou deux secondes, sans même que je me pose la question de savoir pourquoi je reste un bref instant suspendu sur ce livre. C'est presque insignifiant, ce regard. Rien qui soit digne en apparence d'être noté.
Hier, dimanche 16 novembre, au soir, passant devant une des bibliothèques du salon, mon regard se pose sur la tranche de Rameaux, un essai de Michel Serres, lu voici quelques années déjà. Pourquoi ce livre ? A ce moment, je ne sais pas. Et puis c'est juste un regard, une ou deux secondes, sans même que je me pose la question de savoir pourquoi je reste un bref instant suspendu sur ce livre. C'est presque insignifiant, ce regard. Rien qui soit digne en apparence d'être noté.Plus tard, je me replonge dans Le chat de Schrödinger, de Philippe Forest. J'ai acheté le livre en Folio le 8 novembre dernier. Drôle de bouquin, qui a laissé en son temps la critique presque muette. Pour avoir déjà lu plusieurs livres de Forest, je dois dire que celui-ci est le plus austère, le plus complexe, il confine même à l'aridité. Mais la beauté iridescente de la phrase nous soulève comme un simoun : le texte possède la somptuosité du désert.
Avec, au centre vibrant de l’œuvre, comme dans tous les ouvrages de l'auteur, la mort de l'enfant, la petite fille emportée à quatre ans par un cancer des os. Perte irréparable, chagrin inguérissable, deuil impossible.
Je ne veux pas résumer le livre. Tous les articles que j'ai pu lire sur lui confessent la même impuissance à le faire. Mon propos n'est d'ailleurs pas là.
Le passage que je découvre ce soir-là s'articule autour d'une histoire racontée par le philosophe Leibniz dans la troisième partie de ses Essais de Théodicée. Le jeune Sextus Tarquin, qui deviendra le dernier des rois légendaires de la cité romaine, interroge l'oracle d'Apollon sur son avenir. Devant la noirceur du tableau, Sextus s'insurge et se rend à Dodone, près de Jupiter, afin qu'il rectifie le destin prédit. Jupiter restant inflexible, Sextus, dépité, s'abandonne à son destin qui s'accomplit donc selon ce qu'il a été prévu.
Un prêtre, Théodore, qui assiste à la scène, s'émeut du sort de Sextus, de sorte que le dieu suprême le dirige vers sa fille Pallas, à Athènes. En songe, Théodore, touché par un rameau d'or*, est convié à pénétrer dans le "palais des destinées".
 |
| Lucrèce et Sextus Tarquin (Simon Vouet) - Wikipedia |
"Celui-ci contient toutes les représentations, dit la déesse, "non seulement de tout ce qui arrive, mais encore de tout ce qui est possible", de sorte que Jupiter puisse passer en revue toutes les formes que l'univers aurait pu prendre et parmi lesquelles il a choisi celle qui lui a plu. Chaque pièce du palais contient ainsi l'une des versions de chacun des événements qui ont fait, qui feront ou qui auraient pu faire l'histoire de tous les hommes comme celle de chacune d'entre eux. (...) Pour convaincre l'homme à la foi vacillante, Pallas propose à Théodore de visiter les pièces qui concernent le malheureux Sextus. Dans l'une de ces chambres se trouve l'histoire vraie de celui-ci où Théodore reconnaît la scène à laquelle il a assisté, Sextus recevant d'Apollon puis de Jupiter l'oracle qui le condamne. Mais il existe toute une série d'autres chambres, d'autres mondes aussi que la déesse lui montre où Sextus connaît d'autres destins, plus vertueux, plus heureux et où il devient un saint plutôt qu'un salaud. Si Jupiter, dans sa grande sagesse et avec la plus totale équité a élu pour le jeune homme un destin honteux et misérable, c'est parce que de celui-ci devaient sortir les grandes choses nécessaires au bien de l'humanité. Il fallait le crime de Sextus - en l'occurrence le viol de Lucrèce - pour que devienne possible la gloire de Rome, "felix culpa", faute heureuse, aussi nécessaire que le péché d'Adam ou la trahison de Judas au salut du monde." (pp. 248-249)
"Mais tant qu'on reste dans le dedans de la boîte, c'est autre chose : un grand récit sans partage pour lequel toutes les péripéties possibles, au lieu de s'exclure les unes les autres, s'additionnent, manifestant sous le regard le réseau ramifié de ce à quoi elles auraient pu conduire et que plus personne ne pourrait vraiment raconter puisqu'il n'existe pas de position depuis laquelle les considérer toutes à la fois."
Quelque chose demande à être dévoilé. Du moins, perçu.
Ou peut-être que je m'illusionne, si c'est le cas, ce n'est pas grave, je n'aurais perdu que mon temps et un peu de sommeil.
Rameaux est paru en 2004, je l'ai acheté à Limoges cette année-là. Dix ans plus tard, je suis bien incapable d'en citer ne serait-ce qu'une seule ligne, mais à le relire, en diagonale, en suivant mes soulignements au crayon, la mémoire revient de l'essentiel du propos.
Et puis, tout à coup, page 171, la fulgurante coïncidence :
" Voici une image ancienne de ces nouveautés. A la fin des Essais de théodicée (414 sqq.), la déesse Pallas entraîne Théodore, le grand sacrificateur, au dernier étage de la pyramide des mondes : à sa pointe extrême, elle lui découvre un appartement si beau qu'il s'en évanouit ; voilà, lui dit la déesse, après l'avoir réveillé, le monde actuel, le nôtre, l'unique, le meilleur. En dessous, dans la nappe inférieure du volume, voyez se multiplier, en bifurcations infinies, d'autres appartements, les mondes possibles que Dieu, au moment de créer, n'a pas choisis.
En cette description sublime, Leibniz mous persuade que Dieu les élimina parce qu'ils comportaient plus de mal que celui-ci."
Tout se passe comme si j'avais eu l'intuition de l'avenir. Quelque chose m'était désigné qui allait prendre sens plus tard. Comme une forme de voyance (qui ne verrait pas grand chose en réalité mais ouvrirait une fenêtre sur un possible). Un geste oraculaire qui se reflète dans l'histoire elle-même, qui est une histoire d'oracle.
L'étrange c'est aussi la surgie de cet adjectif "ramifié", qui vint donc réactiver le souvenir du regard, faire le lien avec le livre de Serres et déclencher mon désir de savoir. Sans cette présence du mot, il est vraisemblable que le regard eut été oublié, et la connexion non réalisée.
Celle-ci m'a si fortement frappé que j'avais aussitôt résolu d'en rendre compte ici. Ceci dit, le sens plus global de tout cela m'échappe. Nous n'avons pas fini de méditer sur les figures du hasard objectif.
__________________
* Petite erreur de Philippe Forest, il s'agit d'un rameau d'olivier et non d'un rameau d'or.