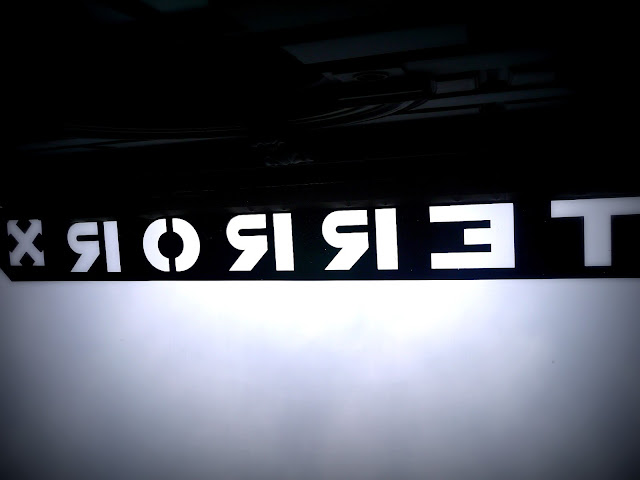Les trois ont été avalés dans la semaine (mais j'attendrai le terme du prêt pour aller les rendre).
Voyons ça dans l'ordre.
Prems, Avant que j'oublie, de Anne Pauly, un premier roman édité chez Verdier dans la collection Chaoïd. Un titre qui était, de façon surprenante, exactement le même que celui de la pièce que j'avais vue une semaine plus tôt dans un lieu éphémère boulevard George Sand, Avant que j'oublie donc, forte pièce de Vanessa Van Durme, qu'elle joue elle-même sous forme d'un monologue, mais que Niko Lamatière avait bellement mise en scène avec Pascale Chatiron et Francis Labbaye (avec qui j'avais joué Tout mon amour de Laurent Mauvignier). Ceci dit, les deux oeuvres n'ont pas grand chose à voir.
L'incipit donne tout de suite le ton : "Le soir où mon père est mort, on s'est retrouvés en voiture avec mon frère, parce qu'il faisait nuit, qu'il était presque 23 heures et que passé le choc, après avoir bu le thé amer préparé par l'infirmière et avalé à contre-coeur les morceaux de sucre qu'elle nous tendait pour qu'on tienne le coup, il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer."
Ce père est au centre du livre, avec sa personnalité contrastée : le "gros déglingo" qu'il était, alcoolique, parfois violent, voisinait avec l'amateur de haïkus et de sagesses orientales. Anne Pauly raconte la tragi-comédie de cette vie, l'enterrement et le deuil, et le souci de cette maison qu'il laisse, à Carrières-sous-Poissy, épouvantablement encombrée.
Il faudra traverser tout le livre pour que l'auteure renoue véritablement avec son frère, longtemps empli d'amertume. Elle va lui rendre visite, à lui et à sa famille, "dans leur maison du Perche, un corps de ferme humide et un peu endormi au bout d'un chemin bordé par une forêt." Elle y fait connaissance de la jeune pie, tombée du nid pile devant la porte de leur bureau, qu'ils ont recueillie, soignée, nourrie et qui leur tient désormais compagnie.
La pie, familière et taquine, qui finit par s'endormir bercée par les voix de la famille, s'impose comme le symbole d'une fraternité retrouvée : "C'était si doux et on était si bien. Personne ne l'a dit mais à ce moment-là, c'est devenu clair que l'oiseau n'était pas venu par hasard." Dans l'entretien qu'Anne Pauly a accordée à Johan Faerber dans Diacritik, elle termine en disant que "Le retour à la vie et à la joie s’opère quand se rétablit la capacité à voir les signes, à les lire et à leur trouver un sens. Ce qui sauve dans tout ça, ce sont les histoires !""J'avais souri au téléphone en apprenant la nouvelle parce que c'était quand même une drôle de coïncidence. Depuis toujours Jean-François était spécialiste des oiseaux. Il connaissait toutes les espèces, leurs couleurs, leurs habitudes, leurs habitats de prédilection, leurs cris et je l'avais vu déjà faire venir sur des branches, à quelques mètres de nous, buses, coucous et chouettes effraies. Et puis, quand il était ado, en plus du corbeau sauvé des plombs d'un chasseur, il avait justement possédé deux pies bleues de Chine." (p. 136)
Voilà qui évidemment me parle, et résonne fort en moi, qui ne cesse d'essayer de lire les signes laissés par le hasard. Lire et lier, relier et relire, au risque du délire et de sembler fou à lier.
Deusse. La Clé USB de Jean-Philippe Toussaint. Chez Minuit, comme d'habitude (attention je vais spoiler quelque peu l'ouvrage alors n'allez pas plus loin si vous comptez le lire). Un bien curieux livre qui commence comme un roman d'espionnage, avec des passages très techniques sur les blockchains, bitcoins, Commission européenne et cybersécurité. Un voyage secret en Chine avant une double conférence à Tokyo. Une clé USB perdue qui contient peut-être les preuves d'une corruption de grande ampleur. Et puis tout ça finalement ne se révèle qu'un tas de fausses pistes, et le désastre que semblait redouter le narrateur s'incarne pour lui de façon inattendue : son père se meurt, son père va mourir, alors il abrège son séjour nippon, rentre au plus vite, mais ce sera trop tard.
Je savais que le livre d'Anne Pauly allait évoquer la mort d'un père, mais j'ignorais complètement que le roman de Toussaint allait aussi culminer avec cet événement. Deux pères qui meurent donc, et qui meurent d'une même cause, un cancer.
Je dois consigner une autre coïncidence. J'avais commencé la lecture de La Clé USB le vendredi 22 dans l'après-midi, et l'avais abandonné pour me rendre à une conférence sur l'eau à la Maison des Associations, que nous organisions avec le collectif Châteauroux demain. Or, à 23 h 40, je reçus le sms suivant :
Je répondis que non, je ne l'avais pas vue (et un peu plus tard, un autre message m'avertit que la clé avait été retrouvée, c'est le conférencier qui l'avait embarquée).
Tres. Je voudrais parler au directeur de Jacques A. Bertrand (Bernard Barrault, 1990). C'est le deuxième Bertrand que je sauve du désherbage (je comprends mal qu'on sorte des collections ce superbe mais sans doute trop discret écrivain). Il n'est pas question ici de la mort d'un père, mais la narration est à la première personne, comme chez Toussaint. Jonathan, écrivain-aquarelliste, est conduit manu militari dans une "Maison" qui tient à la fois de la pension de famille et de l'hôpital psychiatrique. Il voudrait parler au Directeur mais le Directeur semble absent ou inapprochable. Un motif qu'on pourrait dire kafkaïen, mais l'auteur ne tire pas sur la corde cauchemardesque. Le bonheur se glisse ici et là, furtivement, comme avec l'arrivée d'Hermine, qui "n'était pas une femme depuis très longtemps" et qui devient rapidement l'amie et la complice de Jonathan : "Sa formidable simplicité, qui allait de pair avec une grande liberté de vie, et ses performances informatiques (elle était capable d'accéder aux mémoires les mieux verrouillées) avaient attiré sur elle l'attention de la commission spéciale." Commission spéciale qui rappelle bien sûr (ou plutôt préfigure) la Commission européenne au cœur du roman de Toussaint, tandis que cette compétence informatique (c'est bien la seule référence au monde des ordinateurs présente dans le livre) résonne avec le thème de la backdoor de La Clé USB. Cette porte dérobée qui permet de pénétrer au coeur des systèmes, et qui donne lieu à une scène marquante, celle où le narrateur s'introduit de nuit dans la mine (ainsi nomme-t-on l'usine où l'on produit les bitcoins), et retrouve Jimmy le jeune hacker chinois :
"En m'entendant prononcer le mot "backdoor", son regard s'illumina, quelque chose se dénoua, un verrou lâcha, et, soudain mû par un feu intérieur, par une flamme, une ferveur, quelque chose d'irrépressible, comme une nécessité, ou une démangeaison, il fit glisser son siège à roulettes en arrière sur le sol pour aller ramasser son sac à dos et en sortir son ordinateur portable, un PC couvert d'autocollants qu'il alluma sur ses genoux."
Un autre écho plus trivial rassemble les deux romans. Jonathan découvrant sa chambre au troisième étage de la maison, essaye les costumes du placard : "Les vestons tombaient bien mais les pantalons flottaient. Pour les chemises, le col s'avérait trop large quand les manches étaient suffisamment longues et parfait quand elles étaient trop courtes. J'en avais l'habitude mais je n'ai pu réprimer un mouvement d'humeur. J'ai balancé le tas dans le placard et claqué la porte. J'ai rouvert, tout replacé sur les cintres, c'était idiot qu'en plus ce soit froissé." (p .42-43)
Jean Detrez, le narrateur de La Clé USB, arrivant dans sa chambre de l'hôtel chinois, à Dalian, ne parvient pas à replacer les cintres dans l'armoire car ce sont des cintres antivol qui n'ont pas de crochet, et il s'emporte tout comme Jonathan :
"J'avais toujours le cintre à la main, et, de plus en plus enragé, essayant une dernière fois de le fixer, je finis par le faire valdinguer par terre avec agacement. Pour me passer les nerfs, je décrochai alors tous les cintres de la tringle, et j'allai en jeter une poignée dans la poubelle de la salle de bain, je les fichai à la verticale dans la poubelle, où ils restèrent en exposition comme un bouquet de tulipes. Puis, ouvrant ma valise, je balançai les autres cintres à la volée au-dessus de mes vêtements et je refermai ma valise, avec l'intention de les emporter avec moi quand je quitterais l'hôtel."(p.135)
Et ainsi la narratrice d'Anne Pauly (qui se nomme Anne Pauly) de lire semblablement les signes que la vie lui apporte :"Le fin chasseur devait prendre un vif plaisir à être chassé ; il se laissait presque rattraper avant de plonger brusquement, laissant les corbeaux sur place. Ces derniers se séparaient pour essayer de le coincer et la scène recommençait. Les corbeaux savaient qu'ils étaient beaucoup plus lents mais ils s'amusaient. Ils savaient aussi qu'on ne sait jamais. L’épervier avait beau être fulgurant, vous aviez une chance. Si vous ne laissiez pas tomber, un jour la Vie finirait par passer un petit peu trop près et vous lui fileriez un bon coup de bec. [...] Vous aviez compris que la journée s'annonçait belle, à tous ces signes. Vous pouviez vous croire autorisé à percevoir à nouveau la piste fléchée du Destin dans le maquis du Hasard." (p. 124) [C'est moi qui souligne]
Trois romans, intriqués, en une tresse unique de récits et de rencontres. Comme pour nous encourager à persévérer nous aussi dans la lecture des signes du temps."Un conte à base d'anges qui vous caresse la joue, de guides et de défunts qui ne vous laissent pas tomber et continuent de vous parler pour peu que vous sachiez voir les signes. Et petit à petit, en contemplant les choses comme il me l'avait appris, je me suis mise à en voir un certain nombre. Pas des faux trucs hein, de bonnes vieilles coïncidences troublantes, comme dans les livres : je pensais à Machin qui pourrait m'aider à sortir de mon trou professionnel, et alors que je ne l'avais pas vu depuis des lustres, toc, Machin apparaissait au coin de la rue. Je cherchais un appartement, et toc, le proprio n'était autre que le cousin de la soeur de Bidule avec qui j'avais été à l'école. Au travail, alors que je négociais mon départ, toc, le comptable s'était emmêlé la calculette me laissant largement de quoi me retourner. Chez l'ostéo, la radio à très bas volume avait été prise de folie alors que le praticien s'apprêtait à me dévisser la tête. A la laverie, une femme tout ce qu'il y avait de plus normal était rentrée et s'était approchée de moi pour me dire : Sois courageuse, ma fille, ça va aller pour toi, mais arrête de fumer ou ça te tuera. Peu à peu, l'incrédulité s'était transformée en une forme d'amusement et de gratitude et je souriais dans ma barbe à chaque nouvelle occurrence : on me guidait, on me protégeait, on m'offrait des options, on me consolait. J'allais mieux." (p. 129-130)