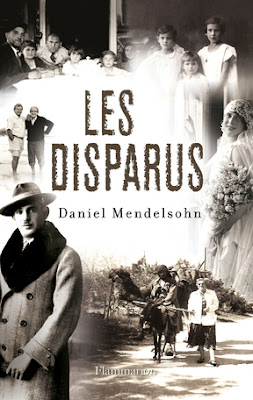Qui ne montre pas grand chose… Ce rêve me paraissait une scansion importante. Après le retour du cimetière, la nuit où Coline et Simon ont fait l’amour dans une espèce de désespoir, il fallait qu’Azar se manifeste. Le rêve est l’un des moyens par lesquels les morts se rappellent à nous. Mon ami Pierre Pachet, l’un des disparus auxquels le film est dédié, disait du rêve que c’est « le parloir des morts ». J’aime beaucoup cette expression."
Entretien avec Pascal Bonitzer (pour son film Les Envoûtés)
J'ai déjà cité cette partie d'un entretien avec Pascal Bonitzer dans un article précédent. J'y reviens aujourd'hui car il a suscité en moi une curiosité à propos de cet écrivain ami du cinéaste, Pierre Pachet. Je ne le connaissais pas, n'avais jamais rien lu de lui, mais il y eut comme une sorte d'appel. A la médiathèque, je recherchais son oeuvre, je ne trouvais que trois volumes (sur les quinze que compte une bibliographie arrêtée en 2005), parmi lesquels je choisis un recueil de chroniques, Loin de Paris, écrites entre 2001 et 2005 pour La Quinzaine littéraire. Comme on pouvait s'y attendre, il était exilé en magasin.
Pierre Michon s'était fendu d'une préface, intitulée Tôkaidô. C'est par là que je commençai. Tôkaidô, c'est le parcours de 500 kilomètres qui reliait Edo à Kyoto, les deux capitales, une sorte de pèlerinage que les lettrés japonais s'imposaient au moins une fois dans leur vie : cinquante-trois étapes le jalonnaient, où l'on se remémorait tel poème, l'on y voyait "tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionné". Pachet, suggère Michon, a accompli son Tôkaidô personnel, en cinquante étapes, trois de moins que chez les Japonais. L'une d'elles, narrée au fragment 7, était Tel Aviv. Pachet, rapporte Michon, regarde en juin 2001 une pelouse de campus et écrit : là, "des corneilles de couleur insolite, les ailes et la queue noires, le dos et le ventre beiges", s'ébattent. Quand ils se revoient, Michon fait observer à Pachet que ces corneilles n'ont rien d'insolite pourvu qu'on les appelle par leur nom de corneilles mantelées. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd :
"En décembre 2002, Pachet est à Louxor, dans le pays des morts et du temps. Il évoque des ombres chères qui le rabrouent. Les morts sont de puissants souverains. Des coqs chantent en pleine nuit, les canards vont par sept, la Grande Ourse et le croissant de lune sont sanglants, on est au pays de la magie noire. A deux pas , le désert attend. Au milieu de ces vicissitudes, il a la mince satisfaction d'appeler les choses vivantes par leur nom. Il sort un instant, par la pensée, d'Egypte. Il écrit : "Sur les fils des derniers poteaux électriques sont postées des corneilles mantelées."
Quinze jours plus tard dans La Quinzaine je lis ces lignes. Je suis content d'y découvrir mon influence sur Pachet. Nous sommes sur le Tôkaidô, nous nous citons les uns les autres, imperceptiblement." (p.10-11)
L'histoire des corneilles ne s'arrête pas là, poursuit Michon. Elles reviendront dans un texte sur Walter Benjamin qu'il devait donner dans un colloque au même moment et qui lui donnait du fil à retordre. Passons.
Ce qui m'a sidéré à la lecture de ce texte, c'est que le même jour, le 9 janvier 2020, dans la matinée, alors que je manifestai avec des milliers d'autres dans les rues de Châteauroux contre la réforme des retraites, il avait été aussi question d'une corneille, au sein même de ce défilé animé par une batucada improvisée. Le musicien Michel Thouseau avait délaissé sa contrebasse pour une percussion plus modeste. Comme le prochain thème de notre chère revue Torticolis doit porter sur l'animal, je l'entretins des oiseaux car j'avais encore en mémoire l'inénarrable performance qu'il fit au Blanc pour une des dernières éditions du festival Chapitre Nature : Il était un oiseau, que l'on voit encore figurer sur la page d'accueil de son site :
Extrait :
(On peut se demander quel rapport peut bien avoir l'oiseau avec l'objet même de la manif, mais c'est ainsi, on parle de plein de choses dans les manifs et même si l'on a à coeur la défense des quelques valeurs essentielles qui nous ont amené à battre le bitume, on s'autorise aussi de quelques belles digressions.) Bref, c'est lors de cette discussion que Michel me parla de la corneille de Tristan Plot.
Tristan Plot est un spécialiste des méthodes douces d'éducation d'oiseaux. Milan noir, cygnes, geai et donc corneilles sont entraînés pour intervenir sur des plateaux de théâtre, au cinéma ou dans des performances artistiques.
Comme il vit dans la Vienne, non loin d'ici, Michel a entamé un travail musical avec l'une des corneilles de Tristan Plot. Travail fascinant, semble-t-il.
En tout cas, retrouver la corneille, fut-elle mantelée, le soir-même sous la plume de Michon, fut une belle résonance.
Une autre résonance s'imposa juste après. J'avais commencé, je l'ai dit, la lecture de l'essai d'Albert Camus, L'été. Dans la partie nommée L'énigme, cette nuit-là je lus ceci :
"Mais nous avons appris, loin de Paris, qu'une lumière est dans notre dos, qu'il nous faut nous retourner en rejetant nos liens pour la regarder en face, et que notre tâche avant de mourir est de chercher, à travers tous les mots, à la nommer." (p .150) [C'est moi qui souligne]
Loin de Paris... Le titre même du livre de Pierre Pachet.