Le fond de la campagne française a tout de même honoré la mémoire de celui qu'elle avait accueilli. Et qui ne s'est guère montré reconnaissant dans son écriture, où vous chercherez en vain le berrichon. Car si Jean de Boschère aime à observer faune et flore, pigeons, hérissons, rats, vaches, il accorde en revanche peu d'attention au troupeau de ses congénères. Le titre du livre de souvenirs de sa compagne Elisabeth d'Ennetières est d'ailleurs tout à fait significatif : Nous, et les autres.
Mais qu'importe, la soirée fut belle sous les voûtes rustiques, et l'after fut à l'avenant, avec la traditionnelle galette aux patates de Jackie, une nouvelle fois au-delà de tout éloge. Nous étions près d'une vingtaine dans le grand salon, autant dire que la table n'y suffisait pas. On ramena force chaises et une petite table, et nous prîmes place comme les gosses dans un repas de famille. Le hasard, dans son objectivité maintenant bien connue, me plaça à côté d'un Suisse allemand, goguenard et rigolard, qui nous instruisit, entre autres, de l'origine de l'expression "boire en Suisse".
On sait que le Suisse est, enfin fût, pendant longtemps, mercenaire. Au service du Roi de France ou du Pape, au choix. Et ce depuis le fameux traité de Fribourg, après la bataille de Marignan, où François 1er signa une Paix perpétuelle entre la France et les cantons suisses.
Paix perpétuelle, une idée surréaliste si l'on y songe bien, car je crois bien que c'est le seul exemple de paix perpétuelle jamais signé, et le comble est que ça a réussi, ça a tenu (et ça devrait tenir encore un peu, l'invasion de la Suisse n'étant pas à l'ordre du jour malgré l'évasion fiscale et Jérôme Cahuzac). Que n'a-t-on pas généralisé cette idée de Paix perpétuelle ?
Bref, revenons à nos mercenaires suisses, qui buvaient donc en Suisse, c'est-à-dire qu'ils ne remettaient pas leur tournée dans les tavernes comme on en a l'habitude en France. Est-ce pour préserver leur solde et la ramener entière au pays, ou bien simplement coutume locale ignorante de la ruineuse tournée ? Je ne sais plus.
En tout cas, ce Suisse ne buvait pas en Suisse cette nuit-là. La preuve, il avait même amené deux bouteilles d'excellent blanc.
A un moment donné, je ne sais pas non plus pourquoi, il me parla de Zwingli.
Zwingli, je connaissais, et depuis belle lurette, depuis la plus tendre enfance où j'aimais à parcourir le dictionnaire Larousse, dans l'édition où, comme disait André Hardellet, des jeunes filles étaient employés à souffler sur les fleurs de pissenlit. Dans la section des noms propres, j'aimais commencer par la fin, et dans cette fin, il y avait bien sûr Zwingli, ce prédicateur protestant encore plus radical que Luther.
 |
| Portrait de Zwingli, peinture à l'huile de Hans Asper (en), 1531 ; Kunstmuseum Winterthour. |
Quelques jours plus tard, j'ouvre Mourir de penser, le dernier ouvrage de Pascal Quignard, acheté la semaine dernière mais que je gardais en réserve. Bon, j'y jette un oeil, par curiosité, et le premier paragraphe bien sûr me retient :
L'année 699, les Frisons consentirent à se convertir au christianisme. Au mois de mars 700, le premier d'entre eux, Rachord, roi des Frisons, devant l'ensemble de ses tribus, se prépara à recevoir le baptême. Déjà, il était tout nu, il avait mis un pied dans les fonts quand, pris de doute, hésitant à plonger l'autre pied dans l'eau qui était sainte, il demanda, avec inquiétude, au prêtre qui s'apprêtait à l'ondoyer :
- Mais où sont les miens ?
Je lis la suite bien sûr (je ne vous raconte pas), et puis tout le chapitre premier. Et puis voilà, page 12, ce court paragraphe :
Zwingli mourut en s'écriant :
- Vos ancêtres y seront aussi !
Les catholiques le découpèrent en morceaux parce qu'ils désiraient le manger comme une bête sauvage. Myconius s'empara de son cœur et le jeta dans le Rhin de sorte que les catholiques ne le déchirent pas en le dévorant et ne le fassent pas leur en digérant.
La coïncidence est frappante (on ne parle pas de Zwingli tous les jours, vous l'avouerez). Comme je poursuis ma lecture, je parviens au troisième chapitre, que je me retiens difficilement de ne pas citer en entier tant il m'apparaît essentiel. J'en donne tout de même le début, et un peu plus :
Ulysse en haillons est reconnu par son vieux chien Argos.
Homère a écrit, il y a 2800 ans, dans Odyssée XVII, 301 : Enoèsen Odyssea eggus eonta. Mot à mot : Il pensa "Ulysse" dans celui qui s'avançait devant lui.
La scène est bouleversante parce qu'aucun homme et aucune femme sur l'île d'Ithaque n'a encore reconnu Ulysse déguisé en mendiant : c'est son vieux chien, Argos, qui reconnaît cet homme tout à coup. Le premier être surpris à penser, dans l'histoire européenne, est un chien.
C'est un chien qui pense un homme.
[...] Argos, quant à lui, lève les yeux, tend son museau dans l'air, "pense" Ulysse dans le mendiant, remue la queue, couche ses deux oreilles, meurt.
Il pense et il meurt.
Ainsi le premier être qui pense dans Homère se trouve être un chien parce que le verbe "noein"(qui est le verbe grec qu'on traduit par penser) voulait dire d'abord "flairer". Penser, c'est renifler ma chose neuve qui surgit dans l'air qui entoure. C'est intuitionner au-delà des haillons, au-delà du visage barbouillé de noir, au sein de l'apparence fausse qui ne cesse de se modifier, la proie, une vitesse, le temps lui-même, un bondissement, une mort possible."
La suite est aussi forte, et en rapport direct avec les traces de l'autre jour, mais, la nuit étant trop avancée, ce sera pour une prochaine fois.
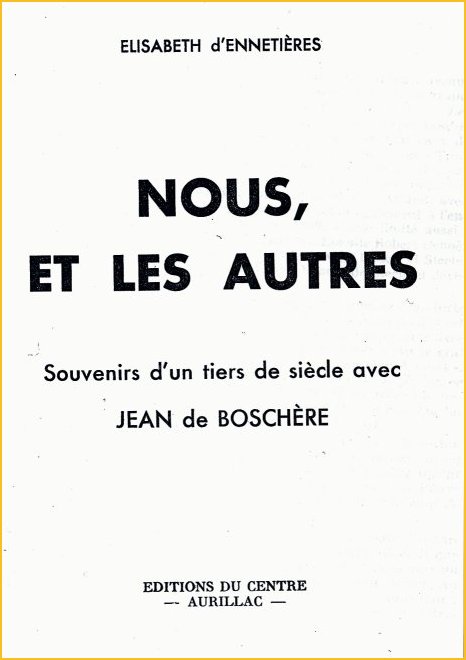
5 commentaires:
Encore un chien...de Vadim à Valmer, de la nuit puissante à la mer, le chien flaire la pensée et en meurt. Dans Accident nocture, un chien permet au narrateur de poursuivre son chemin nocturne dans sa mémoire fragmentée.
Chien nécessaire à l'homme!
Oui encore un chien, encore un chien qui meurt, chien de chasse habile à suivre la piste : "Nulle proie n'échappait à sa vitesse lorsqu'il la poursuivait dans les profondeurs des épaisses forêts : car ce chien excellait à connaître les traces du gibier."
Je reviendrai bientôt sur cette question des traces.
« Nous et les autres » n’a pour Elizabeth d’Ennetières pas d’autre but que de situer biographiquement le « nous » qu’elle forme avec Jean de Boschère, vis-à–vis des « autres », c'est-à-dire les interlocuteurs, intellectuels et artistes, qu’elle et lui ont côtoyés. Cela ne concerne pas les voisins géographiques que tel ou tel domicile leur ont permis de côtoyer. Ces « autres » sont aussi des amis comme Suarès, Milosz, Michaux, Artaud, Fargue, Elskamp, Audiberti … que Jean de Boschère a d’ailleurs croqués par la plume du dessin et du texte dans « Mes amis », amis au nombre desquels il y a aussi…. Elizabeth d’Ennetières ! Dans son « journal » J de B met des matériaux de la vie quotidienne et de sa vie spirituelle. Ceux-ci sont bien plus nombreux que ceux là. Mais le tri effectué par Yves-Alain Favre pour l’édition du texte ne donne pas d’indication exhaustive de valeur de l’un et de l’autre. J de B n’est pas un ermite isolé, loin de là. Une journée au cours de laquelle il n’a de conversation avec qui que ce fut est remarquée ; elle semble donc, de fait, plutôt relever de l’exception. Il entretient une correspondance dont on ne connaît pratiquement que celle avec André Lebois, écrit des poésies, son « journal d’un rebelle solitaire », ses « Mémoires », reçoit parfois et voyage même. Orgueilleux et sûr de ses goûts, J de B l’est sûrement. Il reprend dans une de ses lettres la formule de « la vache Sand », attribuable il me semble à Baudelaire. A ce dernier il emprunte la formule des « poèmes en prose ». Mais cet orgueil ne se place aucunement sur le terrain social : il se limite au terrain artistique, voire au terrain d’esthétique littéraire. Suivant nos critères personnels on pourrait peut-être relever de la vanité « poseuse » plutôt que de l’orgueil. Mais cet orgueil ne se porte jamais sur la différenciation sociale et ceci qu’il soit habitant de Rome, de Paris, de Fontainebleau, de Londres ou de La Châtre. Il ne porte pas plus de jugements sur les londoniens ou les romains que sur les berrichons. Cependant les individus ne sont pas transparents à ses yeux. Dans son « Journal » écrit à La Châtre apparaissent des voisins comme « Pierre » qui a une mare, « Langlois » l’amateur de pigeons. On sait qu’un forgeron avait souvent la visite de J de B, ce dernier admirant. Son habileté. Le très bon jardinier, le sculpteur et le bon bricoleur sont aussi des facettes de J de B. Remarquons aussi que dans son Journal, il porte un jugement complexe sur ses propres « préjugés de classe » qu’il veut comprendre. Son rapport à la nature est celui d’un poète et d’un naturaliste passionné par les insectes, les fleurs et les oiseaux. On ne peut pas dire qu’il ait choisi le pays berrichon et ses habitants. Disons plutôt que c’est le paysage berrichon qui l’avait choisi, lui, le poète Jean de Boschère. Mais un autre paysage pouvait de nouveau l’appeler : pour preuve, avant de décéder il envisageait de déménager vers la côte atlantique ! Dans la phrase suivante : « Humilier est un crime, s’humilier un geste de destruction » (Journal I p 130) J de B exprime deux facettes de son extrême tension humaine.
Merci Jean-Claude pour ce commentaire qui relativise mon persiflage peu amène envers J de B. Il est dommage de n'avoir pas le Journal entier, fut-ce sous forme électronique, ce qui permettrait d'avoir une image sans doute plus juste et plus complète de l'artiste, du grand artiste qu'il est, cela je n'en disconviens pas.
Enregistrer un commentaire