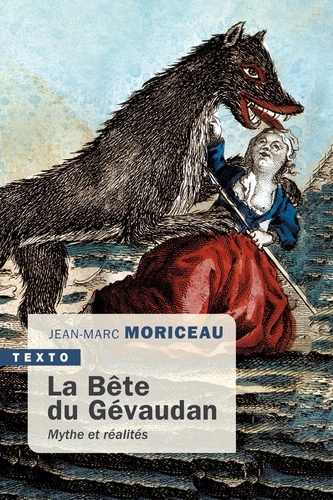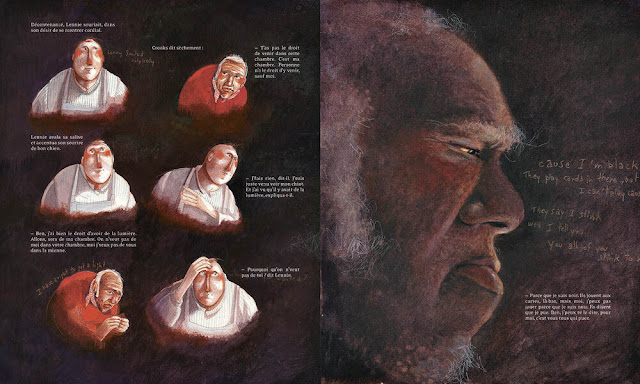"Un matin, au café, elle me regarda longuement en souriant, avant de me dire :
- Vous savez, vous parlez de marche au hasard. Je vous ai dit que je la pratiquais moi-même. Mais au fond, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas au hasard.
- Si ce n'est pas le hasard, qu'est-ce que c'est ?
- Je ne sais pas. Pour ma part, je me sens portée par une énergie très particulière. C'est cette énergie qui me guide quand je marche.
- Et vous en connaissez l'origine ?
- Non, je l'ignore. Mais je marche vers l'inconnu avec la pensée que rien n'arrive jamais au hasard. Jamais.
- J'admire votre façon d'en être si sûre.
- Je pense que les hommes sont présomptueux quand ils affirment que quelque chose leur est arrivé par hasard. C'est leur ignorance qui les empêche de savoir ce qui les dirige."
Rémy Oudghiri, La société très secrète des marcheurs solitaires, Puf, 2022, pp. 239-240
J'avais vu Rémy Oudghiri à l'émission d'Arte, 28 minutes, dirigée par l'excellente Elisabeth Quin. Il y présentait le livre dont j'ai extrait le passage ci-dessus. Je ne pouvais pas n'en pas parler à Gaëlle, ma marcheuse solitaire du chemin de Stevenson (dont elle avait fait une partie, de Florac à Alès, lors des vacances de printemps). Et c'est elle qui a acheté le livre samedi dernier, à la librairie Compagnie, 58 rue des Ecoles, après que nous eûmes visité le musée de Cluny.

Au sortir de la librairie, un violent orage s'abattait sur le Quartier latin. Nous n'avions aucun vêtement de pluie, aussi nous nous réfugiâmes à la terrasse du Sorbon, à quelques mètres de là. Des cyclistes passaient, trempés comme des soupes. Le garçon de café, le teint rougi de servir sans discontinuer tous ces gens qui s'agglutinaient pour fuir les éléments déchaînés, plaça à un moment son visage sous l'ondée, le pied dans le caniveau torrentiel. Il vit que je le regardai avec amusement et nous échangeâmes un regard complice. Il devait être de ces gamins qui aiment à défier les gouttières débordantes ou sauter dans les flaques.
Nous dûmes partir sans attendre la fin de l'averse, et par bonheur la bouche de métro n'était pas loin. Gaëlle commença très vite à lire le livre (qu'elle finit le lendemain). Par curiosité, je le feuilletai lors d'un instant où elle l'avait reposé, et je tombai sur ce début de chapitre : "Tout a commencé un soir de septembre. J'étais attablé dans un café de la rue des Ecoles en compagnie de J."
Voilà qui augurait bien de la suite. Car la suite fut également semé de signes et de coïncidences. Le lendemain, après être allé à Courbevoie choisir des livres dans la riche bibliothèque d'une parente de Gaëlle récemment décédée (et qui avait toute sa vie travaillé dans diverses librairies), nous avions gagné par Saint-Lazare et la ligne 13 le 18ème arrondissement où nous avions rendez-vous pour un covoiturage (aucun train n'étant plus disponible ce dimanche-là, sinon à des prix prohibitifs et au départ de la gare Montparnasse). Arrivés largement en avance à la rue Doudeauville, lieu fixé pour la rencontre, nous avons pris un café au Montmartre, à l'angle de la rue Custine et de la rue de Clignancourt. Je vis alors un homme avec une grosse caméra de télévision prendre des images de la rue, rejoint ensuite par un type portant un micro LCI.
Ce n'est qu'en retrouvant à 15 heures Catherine, la co-voitureuse qui revenait chez elle, à Cahors, que nous comprîmes la raison de cette présence de la télé. La veille au matin, un drame avait eu lieu à cet endroit-même, un contrôle de police avait mal tourné, et les fonctionnaires de police, arguant la légitime défense, avait tiré à neuf reprises sur un véhicule, blessant grièvement le conducteur et la passagère avant, une jeune femme qui devait décéder le lendemain. Le quartier avait été bouclé et Catherine et sa fille n'avaient pu regagner l'appartement de celle-ci qu'après 18 heures. Un sentiment d'étrangeté ne me quittait pas : dans les articles de presse, je retrouvais les noms des rues que nous avions arpentées, rue Custine, rue de Clignancourt, rue Doudeauville, le café Montmartre. Dans ce grand Paris, nous avions rendez-vous sur les lieux exacts d'un drame qui continue à l'heure où j'écris à faire polémique.
Et un autre indice apparut avec le livre de Rémy Oudghiri. L'écrivain est originaire de Casablanca, son récit est régulièrement interrompu par des chapitres où il revient sur son enfance en cette ville, où il voit la naissance de son goût pour la marche au hasard : "Quand je m'échappe de la maison, quelque chose en moi se modifie. A la première bifurcation, je me sens revivre. / Derrière la villa de mes parents, les rues sont plongées dans une pénombre pleine de mystère. Je remonte la rue Paul-Doumer, puis la rue des Fauvettes et je m'enfonce dans les parties les plus paisibles du quartier." (p. 33)
Cette rue Paul-Doumer revient à plusieurs reprises, ainsi que l'homme lui-même. Page 83 : "Quand je ne sors pas, je reste dans la bibliothèque de mes parents, et je lis tout ce que j'y trouve : les pensées de Paul Doumer, l'encyclopédie Larousse, des ouvrages sur le Maroc. Dans un livre de Jules Romains, je tombe sur cette phrase qui dit exactement ce que je ressens : Je marche sans passé, sans aïeux et sans moi, / Et je suis du bonheur en marche vers le soir."
Et puis, dans la seconde partie du livre, Les cimetières magiques, où il rencontre plusieurs personnes qui font leur délice de la marche en ces lieux, voici que Paul Doumer surgit, comme par hasard :
"Quelque chose avait changé en moi. Dès que j'approchais d'un cimetière, mes pas en prenaient naturellement la direction. Un jour où je me promenais rue Lecourbe, je fus ainsi attiré par le petit cimetière de Vaugirard. J'entrai, comme aimanté, et après quelques tours dans les allées, j'y découvris par hasard la sépulture de Paul Doumer.
Ce personnage de la IIIè République restait pour moi un souvenir d'enfance. A Casablanca, la première rue que j'avais l'habitude de prendre, en sortant de la maison, portait son nom. Je me souvenais avoir lu ses pensées dans un petit livre trouvé dans la bibliothèque familiale, mais il ne m'en restait absolument rien. Grise, un peu défraîchie par les années, sa tombe n'avait rien d'exceptionnel. Son nom était gravé au-dessus de celui de sa femme, en lettres dorées." (p. 175)

Or, du café Montmartre où nous étions attablés en terrasse, j'avais remarqué (et c'était avant de lire cette partie du livre d'Oudghiri) à l'angle de la rue de Clignancourt et de la rue Custine, le collège Roland Dorgelès, avec cette plaque rendant hommage à Paul Doumer.
Il ne faut pas oublier que Paul Doumer, lui aussi, fut victime d'un coup de feu, un an à peine après son élection. Le 6 mai 1932, le Russe Pavel Gorguloff, fondateur (et unique membre) d’un parti fasciste russe, tire plusieurs fois sur le Président de la république, lors d'un salon d'écrivains anciens combattants. Grièvement blessé, Doumer est rapidement transporté à l’hôpital Beaujon tout proche, 208 rue du faubourg Saint-Honoré. Il semble pourtant qu'il aurait dû survivre : selon Amaury Lorin, un chirurgien anonyme aurait ainsi rapporté : « le président de la République française est mort, en 1932, treize heures après sa blessure dans un poste chirurgical moderne, d’une hémorragie artérielle tardivement traitée. Le diagnostic était certain (hémorragie, disparition du pouls). Il fallait lier l’artère d’extrême urgence et faire une ou deux transfusions. La ligature d’une artère est une opération simple, classique. Elle aurait dû être faite immédiatement avant tous les autres soins ». Raté par l’assassin, on dit que le président Doumer a été achevé à coups de gaffes : « aucune des deux balles n’était mortelle. Un simple pecquenaud ramassé dans la rue et soigné par le plus humble des médecins de campagne s’en fût tiré."
Jugé après une instruction de seulement un mois, Paul Gorguloff, dont les avocats plaident la folie, voit sa responsabilité pénale retenue, il est condamné à mort par la cour d'assises de la Seine et guillotiné en public le 14 septembre 1932. Bien qu'il ait toujours affirmé avoir agi seul, la thèse d'un complot circule longtemps : Doumer, "de toute façon connu pour sa détermination à réarmer la France le plus vite possible face à la montée des périls qu’il pressentait, non sans raison, était dans le collimateur des mouvements d’obédience fasciste et nazie". Sa mort a peut-être changé le destin de la France et du monde.
"Jusqu’à la guerre de 1939-1945, l’association des écrivains combattants dépose une couronne de fleurs le 6 mai de chaque année sur la tombe du président Doumer. Le culte perdure après-guerre. Sous la présidence de René Coty, l’association commémore le centenaire de sa naissance le 22 mars 1957. À cette occasion, un texte hagiographique de Maurice Genevoix, académicien et écrivain combattant, est lu aux écoliers, collégiens et lycéens de France. Le trente-cinquième anniversaire de la mort tragique du président Doumer est célébré au cimetière de Vaugirard. Pierre Chanlaine retrace les étapes du cursus honorum de Paul Doumer : si, dit-il, Paul Doumer avait pu conduire son septennat jusqu’à son terme (1938), le cours de l’histoire n’aurait sans doute pas été tout à fait le même. En particulier, beaucoup de choses auraient été changées dans l’histoire militaire de la France."
 |
Paul Doumer avec ses cinq fils, dont quatre mourront pendant la Première guerre mondiale (Nadar, 1905).
|
Encore un mot sur Doumer, né à Aurillac, de parents d'origine très modeste. Son père, Jean Doumerg, aurait abandonné sa famille, conduisant la mère, Victorine David, à déménager en région parisienne avec ses trois jeunes enfants. Né en 1821 à Camburat (Lot), agent voyer à Castelnau-Montratier jusqu'à sa démission en 1854, Doumerg quitte en 1858 le secteur des chemins vicinaux pour aller vivre à Paris comme métreur. En 1873, il est condamné par contumace pour avoir pris part à la Commune de Paris. Revenu dans la capitale après l'amnistie de 1880, il meurt dans le 17e arrondissement en 1893. "
Selon Jean-Michel Miel, poursuit la notice Wikipedia,
Paul Doumer aurait entrepris à l’âge de 20 ans des recherches sur son ascendance et aurait été convaincu par cette thèse ; pendant son parcours politique, il aurait volontairement entretenu le flou ses origines familiales, de crainte qu’être vu comme le fils d'un communard ne nuise à sa carrière." Notre aimable conductrice, cinglant vers son Lot natal (elle se revendiquait très précisément de Souillac), ainsi qu'un autre compagnon de voyage (un jeune éleveur de chèvres, fabricant de
cabecous) savaient-ils cette histoire d'un fils d'ouvrier lotois devenu chef d'Etat, une ascension sociale, assure la notice, qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de France ?
Revenons à nos marcheurs. En réalité, souvent des marcheuses. Comme B., qui raconte à l'auteur ses flâneries et errances dans Londres. B. , dit-il, avait lu le livre de
Virginia Woolf,
Au hasard des rues, et, comme elle, "
avait éprouvé le sentiment de l'aventure propre à Londres, cette ville dont chaque méandre entretient le mystère." Ah, Virginia Woolf, dont j'ai parlé naguère à propos des
phares, et dont, dans l'appartement de Courbevoie, j'avais emporté pas moins d'une dizaine de volumes (il me semblait que de l'écrivaine, notre donatrice inconnue avait voulu tout lire, tout découvrir).
Rentrant chez lui après sa conversation avec B., Rémy Oudghiri replonge avec ferveur dans ce petit livre : "En sortant de la maison, on se débarrasse du moi que nos amis connaissent et l'on devient partie de la vaste armée républicaine des marcheurs anonymes, dont la compagnie est si prisée après la solitude de notre chambre."
La relecture de ce texte lui donna, dit-il, une nouvelle impulsion. Grâce à lui, il ressentait le désir de poursuivre l'aventure et de rencontrer d'autres membres de cette société secrète des marcheurs solitaires, si secrète que ses membres ne savent même pas qu'ils lui appartiennent.