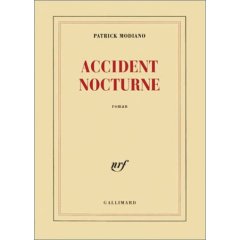Soudain aux arêtes de la pierre
mon sang a brûlé mes yeux se sont tus
le ciel dans mes paumes ne reposait plus
j'élus domicile dans l'ornière
Topper était un labrador, un chien noir, tout noir. Le plus intelligent des chiens que nous ayons eu à la ferme. Beau, affectueux, et indépendant comme un chat : quand il voulait aller folâtrer dans les champs, il faisait la sourde oreille et ne répondait plus à nos appels.
C'est un petit train de marchandises qui le renversa et lui ôta la vie.
Une semaine plus tard la ligne était désaffectée.
Pourquoi évoquer son souvenir ?
Si ce n'est qu'un autre labrador noir a disparu récemment, Vadim, le chien de l'amie Sylvie, qu'un garagiste nomma Valmer. "Au reste, est-ce que son erreur a un sens, j'en doute", écrivait-elle dans la note qu'elle lui consacre. Sur cette erreur, je fis un commentaire sur le site : c'est qu'il m'apparaissait que ce nom - Valmer - n'était pas sans faire surgir toute une chaîne d'échos.
Si ce n'est que l'article que je rédigeais au même moment évoquait Accident nocturne, un roman de Modiano paru en 2003, et que je m'avisai qu'un chien noir y avait place, qui croisait l'errance du personnage dans la capitale :
Une nuit, un chien m'avait suivi depuis l'Alma jusqu'à l'esplanade du Trocadéro. Il était de la même couleur noire et de la même race que celui qui s'était fait écraser du temps de mon enfance. Je remontais l'avenue sur le trottoir de droite. D'abord, le chien se tenait à une dizaine de mètres derrière moi et il s'était rapproché peu à peu. A la hauteur des grilles des jardins Galliera, nous marchions côte à côte. Je ne sais plus où j'avais lu - peut-être était-ce une note au bas d'une page des Merveilles célestes - que l'on peut glisser à certaines heures de la nuit dans un monde parallèle : un appartement vide où l'on n'a pas éteint la lumière, et même une petite rue en impasse. On y retrouve des objets égarés depuis longtemps : un porte-bonheur, une lettre, un parapluie, une clé, et les chats, les chiens ou les chevaux que vous avez perdu au fil de votre vie. (p. 120)
La magie Modiano s'exerce ici à plein, il y suffit d'un chien qui vous suit, que l'on suit, et une brèche semble s'ouvrir dans le mur compact du réel. Le temps s'y laisse reconquérir furtivement.
Je l'ai vu s'éloigner de moi, comme s'il ne pouvait rester plus longtemps en ma compagnie et qu'il allait manquer un rendez-vous. Alors, je lui ai emboîté le pas. Il marchait le long de la façade du musée de l'Homme et il s'est engagé dans la rue Vineuse. Je n'avais jamais emprunté cette rue. Si ce chien m'y entraînait, ce n'était pas un hasard. J'ai eu la sensation d'être arrivé au but et de revenir en terrain connu.
Le chien est passeur, intercesseur de l'ombre. Il guide le narrateur jusqu'à un bar, fermé, c'est un dimanche :
Je m'étais arrêté un moment et j'essayais de déchiffrer ce qui était écrit sur l'enseigne, au-dessus de la porte d'entrée : Vol de Nuit. Puis j'ai cherché du regard le chien, devant moi. Je ne le voyais plus. J'ai pressé le pas pour le rattraper. Mais non, il n'y avait pas trace de lui. J'ai couru et j'ai débouché au carrefour du boulevard Delessert. Les lampadaires brillaient d'une clarté qui m'a fait cligner les yeux. Pas de chien à l'horizon, ni sur le trottoir en pente du boulevard, ni de l'autre côté, ni en face de moi vers la petite gare du métro et les escaliers qui descendent jusqu'à la Seine. La lumière était blanche, une lumière de nuit boréale, et j'aurais vu ce chien noir de loin. Mais il avait disparu. J'ai éprouvé une sensation de vide qui m'était familière et que j'avais oubliée depuis quelques jours grâce à la lecture apaisante des Merveilles célestes. Je regrettais de n'avoir pas retenu le numéro du téléphone qu'il portait à son collier. (p. 123)
Le lendemain, à la nuit tombée, il repassera par cette rue Vineuse, et retrouvera la Fiat couleur vert d'eau qui l'avait renversé au début du roman, place des Pyramides, et, à l'intérieur du bar Vol de Nuit, Jacqueline Beausergent, la conductrice.
Vol de nuit, c'est le titre aussi d'un célèbre roman de Saint-Exupéry.
C'est précisément d'un vol de nuit dont il va être question dans la suite de cette pérégrination.