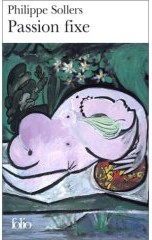Parmi celles-ci, une séquence que j'ai intitulée Carpe diem. Qui commence par une évocation des "journées plurielles" de Ronsard par Jean Starobinski, à travers une étude de 1987 reprise dans le volume Quarto intitulé "La beauté du monde". J'avais travaillé là-dessus au mois de juin, et il me souvient maintenant que c'était au moment de la canicule précoce. D'ailleurs, j'avais envoyé à un ami qui fêtait son anniversaire le 21 juin quelques vers du poète, empruntés au recueil "Les Quatre Saisons de Ronsard" (Poésie/Gallimard, 1985) :
Joyeux anniversaire Antoine ! né avec l'été, à toi ces quelques vers de Ronsard :
"L’estincelante Canicule ,
Qui ard, qui cuist, qui boust, qui brule,
L’esté nous darde de la haut.
Et le souleil qui se promeine
Par les braz du Cancre, rameine
Ces mois tant pourboullis du chaut".
Le même Antoine me remercia quelques jours plus tard en m'envoyant à son tour quelques vers d'Horace (lequel est le créateur du fameux Carpe diem, faut-il le préciser, mais Antoine n'était absolument pas au courant de ma recherche d'alors), ajoutant que "Pensant au cycle des saisons, ce sont les premiers vers qui me soient venus à l’esprit lorsque j’ai vu ton petit mot." :
Ce qui donne en traduction :
J'avais même cru un instant qu'il s'agissait du passage du Carpe diem, car il surgit aussi d'une Ode XI, mais elle est au livre I, tandis que l'Ode citée par Antoine est au livre II.
Dont voici la traduction par Danielle Carles, sur son site Fonsbandusiae :Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Vt melius quicquid erit pati !
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida
aetas : carpe diem, quam minimum credula postero.
Carpe diem, traduit ici par "Prends le jour qui s'offre", signifie littéralement "Cueille le jour" - ce que je trouve beaucoup plus poétique.N’essaye pas de savoir - c’est une chose interdite - pour moi, pour toi,le temps que les dieux nous ont donné, Leuconoé. Ne sonde pasles horoscopes babyloniens. Quoi qu’il arrive, tout en sera meilleur !Que Jupiter nous donne encore de très nombreux hivers, que celui-ci soit le dernier,qui, en ce moment même, fait se briser les vagues de la mer Tyrrhéniennesur les rochers usés, toi, pleine de sagesse, fais couler du vin et abrège l’attentetrop longue pour un instant si court. Le temps de parler, et la vie jalousesera enfuie. Prends le jour qui s’offre, ne fais pas crédit à demain.
Il se trouve que ce jour où j'écris est aussi presque caniculaire. Et, ma foi, c'est donc sur cette coïncidence climatique que j'aborde, rasséréné, cette nouvelle séquence.