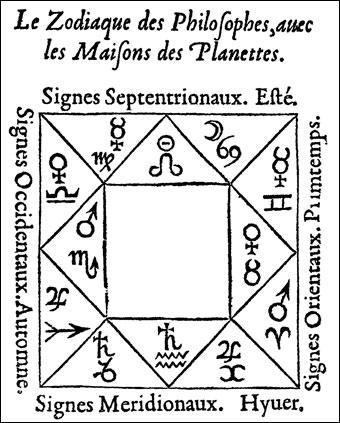Peut-être par cet achat inattendu, la semaine dernière, à La Châtre. Quand je dis achat inattendu, je veux dire que c'est un achat que je n'avais pas prémédité. Qu'il m'a suffi d'ouvrir ce livre là, devant moi, d'en lire quelques lignes pour qu'aussitôt un sentiment de nécessité s'installe. On aurait tort de croire que cela se produit à chaque fois. Il m'arrive d'arpenter toute une librairie, même bien achalandée, et de ne rien éprouver de tel. Cela s'accompagne d'ailleurs d'un pénible sentiment de déception. Non, rien, rien ne s'est imposé. La mystérieuse nécessité n'a pas frappé.
Elle frappa, là, avec La Grande Chute, de Peter Handke. Je m'étonne que sur ce site, si peu de place soit accordée à Peter Handke (une seule mention dans un article sur Modiano, qui lui avait dédié un roman). Pourquoi n'ai-je jamais écrit, par exemple, sur ce merveilleux carnet de notes, Hier en chemin, publié chez Verdier ?
C'est qu'Handke est un marcheur, un flâneur. Le récit de La Grande Chute raconte la marche d'un comédien, à travers une forêt, puis à travers la ville. Je ne conseille pas ce livre aux amateurs de romans comme on dit bien ficelés, avec une intrigue au cordeau, ce récit est bien autrement déconcertant, si déconcertant qu'ils ne sont pas légion les critiques à avoir chroniqué ce livre. Cela rejoint une observation de Handke (entendu chez Alain Veinstein, dans Du jour au lendemain, un des rares espaces où la littérature se fait encore entendre) comme quoi la critique littéraire a presque disparu.
Peut-être par le sauvetage de ces petits animaux rencontrés sur les trottoirs de Châteauroux. J'en fis état sur Facebook, dont je trouve la formule bien adaptée à la narration de ces micro-événements (dire du bien de FB, c'est si rare). Lucane, escargot, que faisaient-ils sur le bitume urbain, à la merci d'un pied négligent ou cruel ? Comment étaient-ils arrivés là ? Ils se gardèrent bien de me renseigner évidemment, je me contentai donc de saisir ces petites bêtes et de les relâcher dans un milieu moins dangereux pour leurs frêles anatomies, un bout de verdure, il s'en trouve toujours, même au cœur de la cité.
Alors je pourrais continuer par ce passage de La Grande Chute où le narrateur évoque le besoin de secourir de son personnage, celui qu'il nomme "mon comédien" : "Quand il en était ainsi, il lui semblait alors tout naturel non seulement d'aider l'autre, mais de le sauver. Avait-il déjà sauvé quelqu'un ?"
Plus loin : "Et il lui vint aussi à l'esprit que jamais encore dans la vie extérieure, en dehors de son travail, de son jeu, de son interprétation, il n'avait pu sauver qui que ce fût."
Et encore un peu plus loin : "A vrai dire, je n'ai sauvé tout au plus que des animaux, et assez petits de surcroît."
Dois-je insister sur la coïncidence ? Non, certainement.
"Un jour que je marchais, depuis l'aube, dans l'un de ces déserts qui croissent même en Europe, sans avoir croisé âme qui vive, ni même un animal, un oiseau, j'ai rencontré, vers le soir, une abeille qui venait de tomber dans l'eau de pluie d'une de ces auges qui remontaient au temps où les déserts étaient des pâturages, et qui, là, se débattait désespérément : pour cette abeille-là, j'étais le sauveur, et de même, autrefois, lors d'une autre randonnée, pour ce hérisson qui, dans l'une des forêts désormais rendues à la jungle, s'était empêtré jusqu'au cou, ou jusqu'au museau, ou je ne sais comment ça s'appelle chez les hérissons, dans un grillage rouillé et recouvert de végétation, au point qu'il ne pouvait plus avancer ni reculer, quoiqu'il s'y essayât sans doute depuis des jours, y jetant maintenant ses dernières forces : pour ce hérisson-là aussi, j'étais, je m'en souviens, moi qui ai découpé le grillage, le sauveur, l'ange ; pour un hérisson et une abeille."
Une seule phrase, ample, magnifique, pour dire d'une seule coulée, le sauvetage de l'abeille et du hérisson. Qu'on la relise, lentement, qu'on la savoure comme je l'ai savourée en la reprenant pour cet article, la goûtant, oui, bien mieux qu'à la première lecture. Ici on frôle l'épopée.
Et je songe pour finir que moi aussi, c'était en 1991, je participai au sauvetage d'un hérisson, lui aussi coincé dans une grille, événement que je transcris dans un roman jamais publié, jamais envoyé à éditeur, Les routes de l'ambre, écrit cette année-là, pour sauver - encore une fois il s'agit de sauver -, mais là c'était le souvenir d'un amour :
Un jour j’ai eu la surprise de voir un hérisson
coincé dans une grille. Le pauvre avait voulu se promener dans la cour, aussi
s’était-il engagé entre deux barreaux mais il était resté bloqué à mi-corps
comme la belette de la fable. Difficile de ne pas être ému par son bout de
museau noir et ses deux yeux tristes. Comme j’approchai ma main, il se mit en
boule. Cyd, que j’étais allé chercher entre temps, courut prendre des gants de
travail qu’elle avait repérés dans une remise, et se fit un devoir de dégager elle-même le
hérisson de son étreinte de fer. Elle le prit dans ses mains et le posa délicatement
au milieu de la cour. Il y resta longtemps immobile. Il nous fallut attendre
patiemment une bonne vingtaine de minutes
avant de le voir détaler en direction du pré, dont nous avions pris la
précaution de laisser la barrière ouverte. Bonheur de cet instant. (Il y a une
joie toute particulière à apporter la délivrance. Qui n’a pas senti, enfant, la
fierté le gagner quand, d’une main leste, il a touché cette autre main tendue
qui suppliait, quand les corps une seconde plus tôt contraints à l’immobilité
se sont égaillés autour de lui comme une volée de pigeons et que certains
regards se sont embués de reconnaissance et d’admiration ? Dans cette joie de
porter secours, que d’aucuns ternissent en l’appelant devoir, l’homme va
parfois jusqu’à sacrifier sa vie).
 |
| Escargot sur ortie, rives de l'Issoire |