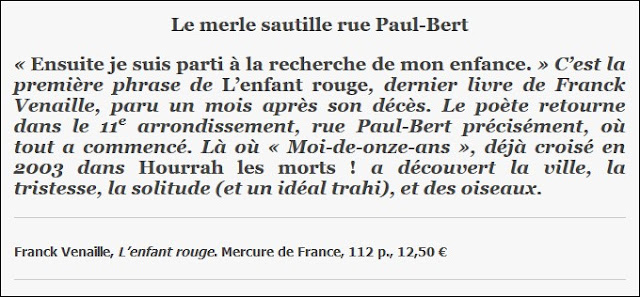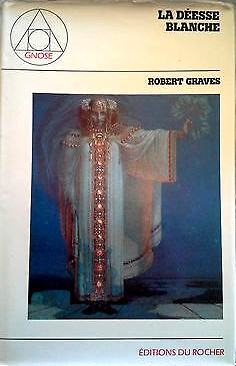"Ce n'était pas ce qui intéressait Amélie : ce qu'elle aurait voulu savoir, c'était comment on vivait avant, quand dans les maternités il n'y avait pas de surprises et que tous les chats avaient quatre pattes : elle avait du mal à imaginer ce temps-là. Bien réglé, oui, mais peut-être un tantinet insipide, comment faire des comparaisons ?"
Primo Levi, Dyxphylaxie, in Lilith, Livre de poche Biblio, 1989, p. 104.
De Primo Levi je ne connaissais que le versant du témoignage de sa captivité à Auschwitz, avec Si c'est un homme, devenu un classique de la littérature sur les camps. C'est avec Lilith que j'ai découvert un autre aspect de son oeuvre : après la première partie encore consacrée à quelques figures de la déportation, il explore des voies complètement différentes, en touchant au conte, au fantastique, voire à la science-fiction. Ainsi des quelques huit pages de Dysphylaxie. Oui, huit pages seulement mais qui ouvre un monde vertigineux, où toutes les barrières entre espèces se retrouvent abolies : les défenses immunitaires qui empêchaient les croisements devenues faibles ou inopérantes, "rien ne vous interdisait de vous faire implanter des yeux d'aigle ou un estomac d'autruche, ou même des branchies de thon pour faire de la plongée sous-marine, mais en contrepartie une semence quelconque, mise en contact par le vent, l'eau ou tout autre agent avec un ovule quelconque, avait de bonnes chances de produire un hybride."(p. 105) La grand-mère d'Amélie, le personnage principal, avait ainsi commis une imprudence lors d'une excursion et avait été fécondée par du pollen de mélèze : "n'importe qui pouvait se rendre compte qu'elle était dysphylactique : elle avait une peau foncée, rêche et écailleuse, et des cheveux verdâtres, qui viraient au jaune-doré en automne et tombaient en hiver, la laissant chauve ; par bonheur ils repoussaient rapidement au printemps."(p. 104)
Le récit, installé en quelques lignes, s'avère d'une efficacité redoutable, sans pour autant forcer sur le pathos. L'auteur fait bien ressentir le quotidien de ce monde nouveau, Amélie va passer un examen à l'Institut d'Histoire Moderne comme n'importe quel étudiant d'aujourd'hui, mais une petite notation suffit pour en quelque sorte inverser les perspectives, c'est le réel de notre époque qui se trouve soudainement en train d'imiter la fiction : "Par contraste avec l'éclat du soleil, le hall lui parut sombre : avant de voir les visages, elle distingua les masques de gaze antiseptique que tout le monde portait, blancs pour les garçons, multicolores pour les filles."(p. 106-107)
 | |||
|
Au retour de l'examen, sur un sentier à travers bois, Amélie se sent attirée par les fleurs, attirée d'une "manière étrange". "Même si cette manière de sentir, écrit-il, était commune à bien des hommes et des femmes, et qui n'avaient pas tous du sang de mélèze dans les veines. Elle y pensait, tout en continuant à marcher : ça devait être bien gris, bien ennuyeux le bon vieux temps, quand les hommes étaient seulement attirés par les femmes et les femmes par les hommes." (p. 109)
Alors, lisant cette nouvelle, me revint en mémoire une coïncidence qui m'avait troublé à la mi-août. Le 14 août précisément, j'avais relevé dans les statistiques du site que 4 personnes avaient consulté un article publié dix ans plus tôt jour pour jour, autour de La Sed, un poème écrit lui-même bien avant cette date.
Jamais jusque-là je n'avais enregistré de visites sur cet article. A l'ordinaire les articles les plus anciens, et qui plus est consacrés à la poésie, ne font guère recette. Attention, ce n'était pas la ruée, non, mais tout de même, quatre (la possibilité qu'il s'agît de bots arpentant le web n'est bien sûr pas à proscrire, mais même cette éventualité, à mon sens, n'évacue pas le mystère). Mais voyons le poème :
La Sed
Elle vient du fond des nuits pâles
elle sourd de la hanche des glaciers
elle a franchi tous les biefs
C'est le dernier désir d'un mélèze
le regret d'une anguille
le lit vivant de la fièvre
Elle arrive dans sa nuit d'obsidienne
sa fureur s'épanche au feu de nos reins
elle s'inondera au-delà de nos fiefs
C'est le quatrième vers, surtout, C'est le dernier désir d'un mélèze, qui entrait en résonance avec la nouvelle de Primo Levi, avec cette autre phrase encore suivant la dernière citée : "Maintenant, ils étaient nombreux à être comme elle : pas tous, bien sûr, mais beaucoup de jeunes, devant les fleurs, les plantes ou un animal quelconque, à leur vue, à leur odeur, au son de leur voix ou à leur seul frémissement, se sentaient envahis de désir."
La Sed, autrement dit la soif (en espagnol) est à lire avec le premier mot du poème, la Sed/elle, autrement dit la Sédelle, cette petite rivière creusoise qui, avant de se jeter dans la Creuse à Crozant-les-Ruines, prend des allures de torrent auvergnat. Un chemin la longe presque jusqu'au confluent, serpentant dans des gorges noyées d'une verdure luxuriante. Une des sources du poème, autant qu'il m'en souvienne, est un roman de George Sand, Le péché de Monsieur Antoine, évoqué par un auteur bien oublié, Louis Peygnaud, dans De la vallée de George Sand aux collines de Jean Giraudoux : De Nohant à Bellac (1949), un des rares livres que possédaient mes grands-parents maternels. Le roman est disponible sur Wikisource, et c'est là que je retrouve cette description de Crozant :
"Les premiers siècles de la féodalité ont vu construire peu de forteresses aussi bien assises que celle de Crozant. La montagne qui la porte tombe à pic de chaque côté, dans deux torrents, la Creuse et la Sédelle, qui se réunissent avec fracas à l’extrémité de la presqu’île, et y entretiennent, en bondissant sur d’énormes blocs de rochers, un mugissement continuel. Les flancs de la montagne sont bizarres et partout hérissés de longues roches grises qui se dressent du fond de l’abîme comme des géants, ou pendent comme des stalactites sur le torrent qu’elles surplombent. "
 |
| Crozant (Wikipedia) |
Aujourd'hui, il n'est plus de torrents : la construction du barrage d'Eguzon a transformé ce site, et le lac remonte jusqu'au pied des ruines. C'est à cet endroit qu'Emile, le héros du roman, rencontre Gilberte de Châteaubrun et que l'amour, profitant de la sieste paternelle à l'ombre des vestiges du château, naît en remontant le cours de la Sedelle :
« Allons voir si mon père est réveillé. »
Mais elle tremblait ; une pâleur subite avait effacé les brillantes couleurs de ses joues ; son cœur était prêt à se rompre ; elle fléchit et s’appuya sur le rocher pour ne pas tomber. Émile était à ses pieds.
Que lui disait-il ? Il ne le savait pas lui-même, et les échos de Crozant n’ont pas gardé ses paroles. Gilberte ne les entendit pas distinctement ; elle avait le bruit du torrent dans les oreilles, mais centuplé par le battement de ses artères, et il lui semblait que la montagne, prise de convulsions, oscillait au-dessus de sa tête.
Elle n’avait plus de jambes pour fuir, et d’ailleurs elle n’y songeait point. On fuirait en vain l’amour ; quand il s’est insinué dans l’âme, il s’y attache et la suit partout. Gilberte ne savait pas qu’il y eût d’autre péril dans l’amour que celui de laisser surprendre son cœur, et il n’y en avait pas d’autres en effet pour elle auprès d’Émile. Celui-là était bien assez grand, et le vertige qu’il causait était plein d’irrésistibles délices."
 |
| Sédelle (Août 2013) |
Le couple est rejoint par le père, le bon M. Antoine, qui convie Emile à partager leur périple. Et c'est ainsi qu'ils parviennent à Fresselines :
"Il faisait tout à fait sombre quand ils arrivèrent à Fresselines. Les arbres et les rochers ne présentaient plus que des masses noires d’où sortait le grondement majestueux et solennel de la rivière.
Une fatigue délicieuse et la fraîcheur de la nuit jetaient Émile et Gilberte dans une sorte d’assoupissement délicieux. Ils avaient devant eux tout le lendemain, tout un siècle de bonheur."
Or, Fresselines, où se situe le confluent de la Petite et de la Grande Creuse, et où Monet vint peindre au printemps 1889, à l'invitation de son ami, le poète Maurice Rollinat, j'y étais allé la veille même, avec ma fille Violette : du vieux pont de pierre, nous avions suivi la rivière jusqu'au confluent, et remonté jusqu'au village assoupi, une promenade que nous avions déjà faite tant de fois mais dont chaque été semble imposer le retour nécessaire. Et c'est une photo prise également en 2010, au confluent qui illustrait l'article de La Sed :
Il ne me plaît guère d'entrer dans l'explication d'un poème personnel, mais au fond je ne trahis pas grand chose si je précise que La Sed tente de traduire la course folle du désir, tel qu'il semble surgir d'un plus grand que soi, du coeur même du monde, du fond des nuits pâles. Tension cosmique et érotique qui nous ouvre l'inconnu, au-delà de nos fiefs.
La Sed était l'un des 63 poèmes d'un recueil resté inédit, mais dont je reprendrai le titre, Alluvions, pour nommer ce site. Un autre de ces poèmes, dont le titre était Il faut qu'une nudité soit caressée par une fougère, me revint aussi en mémoire avec le dernier paragraphe de la nouvelle de Primo Levi :
"Elle s'arrêta devant un cerisier en fleur : elle en caressa le tronc luisant où elle sentait monter la sève, en toucha légèrement les noeuds gommeux, puis, ayant jeté un coup d'oeil aux alentours, elle le serra étroitement contre elle, et il lui sembla que l'arbre lui répondait par une pluie de fleurs. Elle s'ébroua en riant : "Il ne manquerait plus qu'il m'arrive la même chose qu'à l'arrière-grand-mère !" Après tout, pourquoi pas ? Qui choisir ? Fabio ou le cerisier ? Fabio, sans aucun doute ; il ne faut pas céder aux impulsions du moment. Mais à ce moment précis, Amélie sut qu'elle désirait en quelque manière que le cerisier entre en elle, fructifie en elle. Elle gagna la clairière et s'étendit entre les fougères, fougère elle-même, seule, légère et flexible dans le vent."(p. 110-111)
In fine, c'est à un autre italien que je pensai en lisant ces lignes, le jeune philosophe Emmanuele Coccia, qui, dans La vie des plantes (2016), définit une véritable métaphysique du mélange, dont Dysphylaxie est en somme une géniale prémonition. Ainsi peut-il écrire que " La raison est une fleur : l'on pourrait exprimer cette équivalence que tout ce qui est rationnel est sexuel, tout ce qui est sexuel est rationnel. La rationalité est une question de formes, mais la forme est toujours le résultat d'un remuement, d'un mélange qui produit une variation, un changement. Inversement, la sexualité n'est plus la sphère morbide de l'infrarationnel, le lieu des affects troubles et nébuleux. Elle est la structure et l'ensemble des rencontres avec le monde qui permettent à toute chose de se laisser toucher par l'autre, de progresser dans son évolution, de se réinventer, de devenir autre dans le corps de la ressemblance. La sexualité n'est pas un fait purement biologique, un élan de la vie en tant que telle, mais un mouvement du cosmos dans sa totalité : elle n'est pas une technique améliorée de reproduction du vivant mais l'évidence que la vie n'est que le processus à travers lequel le monde peut prolonger et renouveler son existence uniquement en renouvelant et en inventant des nouvelles formes de mélange. Dans la sexualité, les vivants se font des agents de brassage cosmique, et le mélange devient un moyen de renouvellement des êtres et des identités."(p. 137-138)