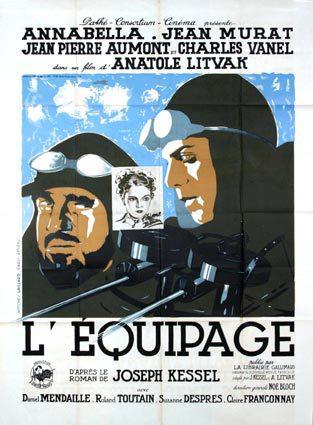"Considéré du point de vue de la littérature, mon destin est très simple. Ce talent que j'ai pour décrire ma vie, vie qui s'apparente au rêve, a fait tomber tout le reste dans l'accessoire, et tout le reste s'est affreusement rabougri, ne cesse de se rabougrir."
Kafka, Journal, 6 août 1914
Le 30 août 1992, en recopiant cette note dans mon cahier, j'écris avoir tout de suite pressenti qu'elle ne m'était pas inconnue. Au moment du coucher des enfants, je tirai de la bibliothèque de la chambre un vieux cahier de 1978, le seul que je n'avais pas encore rangé avec les autres dans le grenier. Au bas d'une page, je retrouvai la citation en question. Force de la mémoire, disais-je, après quatorze ans. Mais faiblesse aussi, car j'avais bien noté à l'époque la source : Kafka, Journal : "Or, quand j'ai découvert celui-ci en librairie, ce fut une surprise, comme si je n'avais jamais su qu'il existât."
La page suivante du cahier, rédigée le même jour, mentionne : "Lecture difficile. Semaine stérile pour l'écriture." Et bien sûr, rien ne me reste de ces affres du moment. Je passe sans transition à Plupart du temps de Pierre Reverdy. Recueil de poésie composé entre 1915 et 1922. La même époque que le Journal de Kafka. Je lis alors la préface de Hubert Juin, qui contient des détails que je juge saisissants : "Il est rare que Reverdy dise, dans ces poèmes, "Je", mais "on" ou "quelqu'un", un peu comme ce "K" désignant - de biais - le héros de l'exilé de Prague." Et puis : "Solesmes, ce n'est pas le Sinaï. La marche a commencé, mais c'est une marche dans le désert. Le poète qui gémissait d'être séparé du dehors par un mur, voilà qu'il se lamente parce qu'un mur le sépare du dedans. Certains textes témoignent pour "on" ou "quelqu'un" rôdant dans un jardin, au long d'un mur qui interdit l'accès de la maison. D'autres montrent "on" ou "quelqu'un", souffrant d'être captif des quatre murs d'une chambre. Tantôt ici, tantôt là, obstiné, refusant de s'ouvrir, de s'évanouir : le mur."
Je note ensuite qu'un texte de La lucarne ovale (1916), l'une des parties du recueil, présente de troublantes similitudes avec un récit de Kafka inclus dans son Journal, Tentation au village, écrit le 11 juin 1914, apparaissant lui-même comme une esquisse du Château. Ce poème en prose a pour titre Encore marcher. Je le retranscris ici en entier :
S'il se soulève quand je passerai près de lui; s'il pleure quand viendra la nuit, s'il ne crie pas? J'aurai cru le voir et ce sera fini.
Plusieurs heures de chemin dans un sentier où l'herbe ne vit plus. J'ai marché bien longtemps et je me suis perdu. Je n'osais plus revenir sur mes pas ni appeler. Et je sentais derrière moi ses yeux qui me cherchaient.
Une faible lumière au loin s'allume entre les arbres. Une fenêtre où je ne pourrai pas frapper. Le feu où l'on refuse de me laisser réchauffer. Et je n'ai même pas le droit de m'arrêter. Un mur en face de moi s'est mis à reculer.
Les cloches sonnent au clocher d'un village lointain et je ne sais que faire de mes mains. Avancer malgré le vent et la nuit qui monte lentement. Je n'ai pas de manteau. Dans l'ombre j'entendais le pas de leurs chevaux.
Où vas-tu me mener? L'auberge où l'on descend est trop loin pour y aller. Les gens s'en vont je ne sais où ; je les suivrai. Quand une main d'enfant m'a fait signe de rester. Et seul je suis perdu là devant vous, devant vous tous et je ne peux plus m'en aller.
Ce mur sur lequel insistait Hubert Juin s'inscrit au centre du texte : Un mur en face de moi s'est mis à reculer. Mur aussi chez Kafka : "Au moment même où je passais devant un grand mur tout couvert de verdure, une petite porte s'ouvrit dans le mur, trois visages se montrèrent, disparurent, et la porte se referma." Et un peu plus loin : "Un instant, je ne sus pas du tout d'où venait la voix, puis j'aperçus au-dessus de moi un jeune homme qui, assis les jambes ballantes sur le mur de la ferme, cognait ses genoux l'un contre l'autre et me disait d'un air négligent : Je viens d'entendre dire que vous voulez passer la nuit au village. Mais vous ne trouverez nulle part de logement possible, sauf ici, dans cette ferme."
Cette inhospitalité du village se retrouve chez Reverdy, dans le troisième paragraphe : "Une faible lumière au loin s'allume entre les arbres. Une fenêtre où je ne pourrai pas frapper. Le feu où l'on refuse de me laisser réchauffer. Et je n'ai même pas le droit de m'arrêter." Dans le cinquième paragraphe, il est dit que "L'auberge où l'on descend est trop loin pour y aller." Ce à quoi semble répondre le texte de Kafka :
"- Est- ce le bon chemin pour aller à l'auberge ?
L'homme s'arrêta et dit :
- Nous n'avons pas d'auberge, ou plutôt nous en avons une, mais elle est inhabitable."
Le salut pourrait-il venir d'un enfant ? Reverdy : "Quand une main d'enfant m'a fait signe de rester." Kafka : " (...) un gamin qui se trouvait près de moi me tira par la veste, comme s'il pensait que je dusse les accompagner . et puisque j'avais effectivement envie d'aller me coucher aussi, je me levai et quittait la chambre sans mot dire, en grande personne, au milieu des enfants qui disaient bonsoir d'une voix forte et unie. Le petit garçon affable me tenait par la main, ce qui me permettait de m'orienter aisément dans le noir." (C'est moi qui souligne)
Je notai que la suite immédiate du récit kafkaïen comportait une référence directe à la lucarne, mot-phare du titre de cette partie du recueil de Reverdy (alors que, bien sûr, Kafka ne pouvait avoir aucune connaissance de l'oeuvre du poète français, qui plus est, ce recueil ne fut publié par Gallimard qu'en 1945) :
"Bientôt, nous arrivâmes du reste à une échelle que nous escaladâmes, et nous fûmes au grenier. On apercevait juste un mince croissant de lune par une petite lucarne ouverte dans le toit, c'était une vraie joie de marcher dessous - ma tête la dépassait presque - et de respirer l'air tout à fois tiède et frais."
Le grenier est présent dès l'entame du recueil avec les deux premiers poèmes justifiés :
En ce temps-là le charbon
était devenu aussi précieux
et rare que des pépites d’or
et j’écrivais dans un grenier
où la neige, en tombant par
les fentes du toit, devenait
bleue.
Dans quelques coins duJe ne suis jamais revenu sur cette étrange rencontre intertextuelle entre Reverdy et Kafka. Ecrivains que l'on songe peu à rapprocher (pour prendre un exemple, dans cette thèse de 2012, Les Lieux de Reverdy par Patrick Vayrette, le nom de Kafka n'apparaît qu'une seule et unique fois, dans le titre d'un article cité). Gil Pressnitzer constate que lui, "l’ermite de Solesmes, est un poète passé de mode, lui qui fut longtemps considéré comme le plus grand. On préfère maintenant des liqueurs plus fortes comme les éclats de silex de René Char, ou les jongleries verbales de Gherasim Luca ou Jacques Roubaud. Mais il est tant de poèmes de Reverdy pour lesquels je donnerais les œuvres complètes de ceux-là." Il faut lire sa belle défense de la poétique de Reverdy, l'exigence qu'elle réclame : "Ses poèmes refusent de fournir la moindre aspérité où s’accrocher, pas de prise, le vertige plus bas, il faut escalader à mains nues en créant ses propres voies. Et nul ne vous assure, vous tomberez tout au fond, sans rappel aucun." Et encore : "La poésie de Reverdy ne dit pas, elle chuchote. L’angoisse est aux aguets. Le temps s’immobilise. L’invisible marche de long en large. Ses pas craquent jusqu’à nous.
grenier j'ai trouvé des om-
bres vivantes qui remuent
Reverdy est le chaman du mystère immédiat, du réel devenu lyrique."
"Ses doutes et son cheminement spirituel le conduisent à rompre avec le brillant littéraire et s’installer à Solesmes en 1926, aux portes de l’abbaye. Il n’a même pas 37 ans.
Il ne trouvera jamais la clé de la porte, et comme dans un conte de Kafka, restera dans l’antichambre où le gardien lui dira que cette porte n’était que pour lui. Veilleur isolé, il n’aura pas vu l’ennemi venir car « la prière est inconnue aux habitants de l’ombre ».
Le 17 juin 1960 il meurt à 71 ans, à Solesmes, dans « cet affreux petit village où il fait toujours froid ». Dans la solitude et l’exigence. Il voulait vivre et mourir dans la même tempête, ce fut une tempête de silence et de questions. Il écrira peu en ce lieu, toujours tendu vers Paris."
 |
| Pierre Reverdy, par Modigliani (1915) |