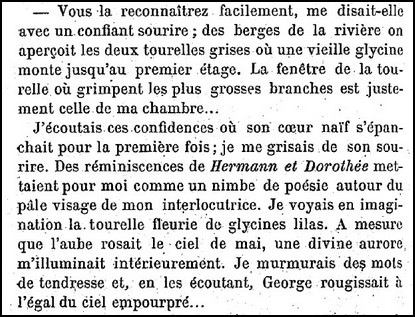- Non, je suis passé par la porte tout bonnement, veuillez m'en excuser, mais en matière d'alpinisme je ne suis pas de taille.
- J'aurai mauvaise grâce à vous le reprocher, je suis très mauvais escaladeur moi aussi, car sujet au vertige. Et pour la spéléologie, c'est encore pire. Claustrophobe invétéré.
- C'est Bartt qui va être déçu. Il semble qu'après la découverte du causse, un gouffre de 800 mètres n'ait rien pour lui faire peur.
- Je l'attendrai au bivouac. De fait, j'eusse été un très mauvais compagnon de voyage pour l'expédition au Mont Analogue. Cela n'a pas empêché Daumal de se signaler à nouveau par trois fois ces temps derniers.
- Ah bon ? Le contraire m'eût étonné, à vrai dire. Vous ne jurez plus que par lui.
- Persiflez tant que vous voudrez. Le fait est que, sans rien chercher, je suis retombé dessus à plusieurs reprises. Tout d'abord avec cette page du livre de Maxime Préaud, Cécile Reims graveur (2000), que j'ai consulté pour la rédaction d'un article commandé par le magazine La Bouinotte.
Le jour suivant, alors que nous passions quelques jours chez des amis près d'Aix-en-Provence, j'ai remarqué dans leur bibliothèque un livre qui s'intitulait A la Verticale de soi. Ouvrage d'une championne d'escalade, Stéphanie Bodet. L'ouvrant au hasard, je choisis d'abord de lire un chapitre qui se nomme Vertiges. C'est là qu'elle cite René Daumal, page 244 : "Je songeais que la vie ne tarde pas à nous retirer "ce manteau de puissance" pour reprendre la belle expression de Christian Bobin. Lorsqu'il vient à glisser de nos épaules, on a froid soudain, on vacille et on réalise enfin que cette nudité est une grâce qui permet de redevenir humble et humain. A l'avenir, se méfier de la réputation, me disais-je. Et se défier de soi car "sait-on bien toujours si l'on vit ou si l'on joue ?"comme l'écrit René Daumal dans sa correspondance."
- La grimpeuse a des lettres...
- Elle a en poche un Capes de lettres et a même enseigné un temps. Enfin, pas longtemps, l'appel de la roche la séduisait plus que l'appel de la cloche.
- Vous réfléchissez longtemps pour produire de telles formules à la noix ?
- Et enfin, il y a eu le commentaire de Rémi Schulz à propos de son article du 4/4/2012, La mode Daumal, où il relate une de ses plus fabuleuses coïncidences, autour de l'achat d'une page de dessins et de calculs de Daumal jeune.
- Bon d'accord, mais l'autre jour vous mettiez Daumal en rapport avec Sebald. Vous avez oublié ?
- J'y viens. Mais tout d'abord...
- Encore une digression...
- A peine... La veille de notre escapade caussenarde et poulignesque, je suis passé à la librairie Arcanes. Le livre que j'avais commandé n'était pas arrivé mais j'ai flashé immédiatement sur un inédit de Frances A. Yates, Le Théâtre du Monde, édité chez Allia. Magnifique édition, soit dit en passant, comme souvent avec cette petite maison.
- Frances A. Yates, l'auteur de L'Art de la mémoire. Vous en avez parlé plusieurs fois sur Alluvions.
- Ravi que vous vous en souveniez. Ce livre, par ailleurs, n'est pas vraiment une nouveauté : il a été publié en 1969, il a donc fallu un demi-siècle pour qu'il passe la Manche. Il se trouve qu'au retour de notre périple jurassique et brennou, j'ai procédé à une petite recherche sur internet. A ma requête "Frances Yates + Allia", je tombe en page 2 (page 3, aujourd'hui) sur une mention du site Norwich.
L'article, vieux de dix ans, évoque un autre livre de Yates édité chez Allia, Fragments autobiographiques.
- En quoi ce site Norwich vous interpelle-t-il ?
- Je prends votre excellente mémoire en défaut. Ceci dit, votre oubli est compréhensible, je n'ai pas reparlé de ce site et de son auteur, Sébastien Chevalier, depuis octobre 2012. Et si j'en ai parlé c'est qu'il évoquait principalement Sebald, comme en témoigne le sous-titre "Du temps et des lieux chez W.G. Sebald et quelques autres." Je suis curieux alors de savoir si le blog est toujours actif et je me rends donc sur la page d'accueil. Le dernier billet publié remonte au 18 mai de cette année (il est titré d'ailleurs 18.5). J'ai fait une copie d'écran :
- Je vois maintenant pourquoi vous parliez l'autre jour du 18 mai 44, naissance de Sebald, trois jours avant la mort de Daumal. Ici, dans Austerlitz, dans la dernière page de son dernier livre, Sebald (qui vivait et enseignait la littérature à Norwich, en Angleterre, d'où le nom du blog de Chevalier) se glisse dans l'histoire avec cette mention de Max Stern, 18.5.1944.
- Il n'aimait pas ses deux prénoms Winfried et George, et préférait qu'on l'appelle Max. Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
- Il fait trop chaud cet après-midi. Que diriez-vous d'une bonne bière ?
- Un peu de patience, vil soiffard ! Je disais donc que l'affaire ne s'arrêtait pas là. Je sursautai aussi sur cette mention de Drancy. Car il en était fortement question dans le livre que j'avais entamé deux jours avant, Une île, une forteresse, sur Terezín, d'Hélène Gaudy. Par exemple, page 266 : "C'est de la gare de Bobigny qu'est partie Ginette Kolinka, qu'est parti mon grand-père, comme tous ceux qui ont quitté Drancy pour Auschwitz à partir de 1943."
- Mais ce livre, il me souvient que vous l'aviez acheté aux rencontres de Chaminadour, à Guéret, en septembre 2017, il y a presque deux ans. Vous m'y aviez traîné et je dois dire que je n'ai rien regretté : la romancière était d'ailleurs présente mais vous aviez été trop timide pour lui réclamer une dédicace.
- Chaminadour ce n'est pas un salon du livre. Elle était en pleine conversation , je n'ai pas osé l'interrompre.
- Donc vous avez attendu deux ans pour lire ce livre.
- C'est ça. A vrai dire, je l'avais commencé à l'époque puis vite interrompu, je ne sais plus pourquoi, et je ne sais pas non plus la raison qui m'a décidé à le reprendre, précisément le 19 août, au milieu de cinquante livres encore à lire qui s'entassent dans la bibliothèque et ses parages. C'est de l'ordre de l'intuition, une intimation de l'Attracteur étrange...
- Votre fameux Attracteur étrange... Là, désolé, je coince, et je ne suis pas le seul...
- Je vous comprends, c'est dur à avaler. Vous n'êtes qu'un attracto-sceptique de plus... Voyez tout de même cet ouvrage d'Hélène Gaudy. Le sujet, Terezín, l'ancienne forteresse militaire devenue ghetto modèle de Theresienstadt, antichambre d'Auschwitz, est au coeur d'Austerlitz de Sebald, qui décrit la quête de son personnage principal sur les traces de sa mère disparue en ces lieux. Un peu plus bas, sur la page d'accueil de Norwich, je lis : "PS: Pendant ce temps, je poursuis moi aussi mon enquête, paresseusement, sur d’autres carnets que Norwich. Pour des raisons pratiques, j’ai rapatrié l’un d’eux, Extractions, sous WordPress. Ce sera donc Extractions (2). Sa particularité : se limiter strictement à la récolte de matériaux." Je clique alors sur ce nouveau carnet et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est plutôt en déshérence puisque le dernier article remonte à juillet 2017. En fait il a migré vers un Tumblr. Néanmoins, l'une des dernières extractions est précisément un extrait de "Une île, une forteresse."
Voici l'extrait : "Rassemblement des Juifs allemands dès
1938 dans des immeubles qui leur sont réservés, trains interdits sauf
quand il s’agira de les déporter, décret empêchant de leur vendre des
articles de maroquinerie: ils deviennent des voyageurs sans bagages,
évincés de la vie publique, cantonnés à un quartier, une rue, un
immeuble, un appartement, une chambre, un châlit dans une chambrée.
On ne se déplace plus, on est déplacé,
envoyé à l’Est ou, dans une symétrie absurde, empêché sous peine de
représailles de s’éloigner de plus de 30 km de son domicile.
Tout se restreint, s’atrophie, les loisirs, les professions, l’habitat, les déplacements. L’ombre nous tient lieu de forêt, et une bassine d’eau remplace la rivière,
écrit Helga Weissowa dans son journal commencé en 1938, à l’âge de 8
ans, et tenu jusqu’à la fin de la guerre parce que son père lui a dit:
Dessine ce que tu vois." (Une île, une forteresse, p.27)"
- [...]
- Vous avez toujours envie d'une bière ? J'ai une bonne artisanale.