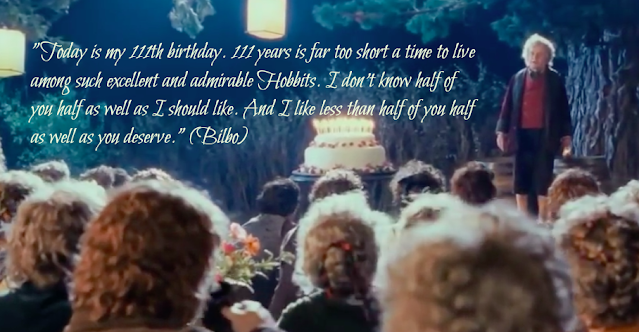A Vierzon le 17 décembre pour aller chercher mon fils à la gare. J'arrive sur le parking à 8 h 30, bien en avance, le train ne devant arriver qu'à 9 h 15. Las, je reçois un message : le train venant de Nantes a été arrêté une heure à Angers, et n'arrivera pas avant 10 h 55. Me voilà donc contraint d'attendre deux heures et demie dans cette bonne ville, pas spécialement réputée pour ce que le jargon actuel nomme attractivité.
N'importe, cette ville proche de chez moi, je la connais si peu, elle doit bien receler quelques petites parcelles de beauté. Je m'en vais donc à pied vers le centre-ville, et descends vers l'Yèvre, qui se jette un peu plus loin dans le Cher. Un vieux pont, un jardin art déco sur une île, un sentier qui longe les eaux rapides de cette rivière où se mêlent les lettres du rêve, et mène jusqu'au vieux canal de Berry et ses rives solitaires. Je croise peu de monde, quelques promeneurs, des ouvriers municipaux dont l'un, équipé de cuissardes, racle le fond d'un bassin aux bordures de mosaïque. Je goûte l'instant, avant de me réfugier dans un Patapain pour un chocolat chaud et lire quelques lignes du recueil de nouvelles d'Ursula K. Le Guin, Aux douze vents du monde. J'essaie tout de même, en incorrigible addict de l'imprimé, de repérer une librairie, mais il semblerait que la dernière librairie indépendante ait mis la clé sous la porte. Dans le centre, la seule offre possible est l'espace culturel Leclerc. Elle ouvre à dix heures, je vais y tuer ma dernière heure d'attente. C'est là que je vais me décider à acheter le livre aperçu l'autre jour à Cultura, et dont le titre a aussitôt fait tilt dans mon esprit : pensez donc, c'était Fenua, ce Fenua que je venais de rencontrer dans le roman de Nicolas Chemla, Murnau des ténèbres.
Ce Fenua là était un récit de Patrick Deville, son dernier, paru en août 2021. Je connaissais Patrick Deville sans avoir jamais lu un seul de ses ouvrages. J'étais toujours resté à l'écart, allez savoir pourquoi. Mais là, Fenua, juste après avoir écrit un article autour de ce mot, de cette notion, la tentation était trop forte, j'avais résisté à Cultura, là je capitulai, il fallait qu'une trace demeure de ce passage forcé à Vierzon.
La raison du titre apparaît en quatrième de couverture : "La Polynésie se décline en un poudroiement d’îles, atolls et archipels, sur des milliers de kilomètres, mais en fin de compte un ensemble de terres émergées assez réduit : toutes réunies, elles ne feraient pas même la surface de la Corse. Et ce territoire, c’est le Fenua." Petite surprise, le Fenua ne prend pas chez Deville le sens mystique qu'il revêt chez Chemla. C'est le terme tahitien qui signifie la terre des hommes, le pays, le territoire.
J'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir, car Deville mêle le souvenir de ses séjours avec l'évocation des explorateurs, romanciers, navigateurs et artistes qui ont sillonné cette partie de l'Océanie (ce nom donné à un continent m'a toujours semblé étrange : un continent est en général défini comme une grande étendue de terres, or ici, faute sans doute de celle-ci, on l'a désigné par son contraire, l'Océan immense).
Poudroiement d'îles, atolls et archipels, et donc aussi poudroiement d'histoires. Je ne m'attarderai aujourd'hui que sur trois d'entre elles, très arbitrairement.
1/ Murnau, bien entendu. J'étais curieux de voir si le cinéaste allait prendre place dans le récit, mais je n'ai pas sauté à sa recherche, j'ai patiemment attendu la page 259 (Deville suit un fil approximativement chronologique, de Bougainville et Cook jusqu'à Gaston Flosse et Mururoa). Le chapitre, chez Murnau, commence ainsi : "Si les espoirs de prospérité que les colons tahitiens avaient placés dans l'ouverture du canal de Panama avaient été vite douchés, dès l'inauguration de celui-ci, en août 1914, par la déclaration de guerre, ces espoirs renaissaient : en 1923, (...) les Messageries maritimes ouvraient une première ligne régulière, affectaient sur celle-ci le paquebot mixte El-Kantara, affirmaient par le choix de ce village algérien ralliant la Polynésie française que l'empire avait survécu au conflit mondial." (Il n'est pas sans doute pas fortuit non plus que Kantara en arabe signifie "pont", "passerelle","arche"- le magazine de l'Institut du monde arabe se nomme précisément Qantara). Panama, qui mettait Papeete à une dizaine de jours de San Francisco et de Hollywood, me rappelle évidemment le Maqroll d'Alvaro Mutis. A part ça, peu d'informations nouvelles sur Murnau et son tournage maléficié. Deville évoque la rencontre avec Matisse avant de passer dans ce même chapitre à Georges Simenon. L'écrivain "avait entrepris un tour du monde qui l'amenait en Polynésie en 1935 pendant que Matisse, de retour à Nice, y peignait à tête reposée Tahiti." Deville consigne dans un carnet spécialement consacré aux "arrivées" sa description de la première vision de l'île, avec, dit-il, "cette variante de la pluie"(le motif de la pluie, ici encore) :
"On était en rade de Tahiti. On attendait le pilote et il pleuvait à torrents. Dans les nuages gris, une montagne en pain de sucre, toute noire, s"élevait jusqu'à deux mille mètres. On devinait de la verdure sombre, quelques toits rouges." On venait alors d'inaugurer dans la vallée de Fautaua, au "Bain-Loti", un buste de l'auteur, pour sa contribution peut-être au tourisme et au saccage. Georges Simenon écrirait ici deux romans, Long cours et Touriste de bananes, ainsi que des reportages pour Paris-Soir."

Deville écrit plus loin que Simenon n'était pas superstitieux : il ne craint pas, dès son arrivée, de louer la grande villa qui avait été celle de Murnau à Punaauia, entamant une vie de fêtes, "dans le tourbillon du rhum et des soirées endiablées." "Plus tard, poursuit Deville, il reprendrait les Maigret vendus par camions, nécessaires à son train de vie, aux places et aux yachts, aux châteaux, aux demeures de vingt pièces aux etats-Unis puis en Suisse, avant le retrait serein de la vieillesse et de la solitude. Comme si, succédant aux rêveries de l'enfance, la vie adulte était seulement le moment d'aller collecter le matériau des souvenirs paisibles des dernières années pour enfin ne plus bouger, se pelotonner dans une petite piaule avenue des Figuiers à Lausanne, planer sur le tapis volant, allongé, immobile, les yeux au plafond, retrouver les images enregistrées pendant son tour du monde. Comme ce serait aussi le cas pour Matisse, mais la lumière des lagons ne quitterait plus son esprit. Et il noterait dans ses Mémoires, en 1976, quarante ans après son séjour polynésien: "Hier, je me suis endormi sur des images de Tahiti."
2/ Le cinquième chapitre évoque
Tupaia, le chef tahitien que James Cook emmena avec lui, lors de son deuxième voyage en Polynésie, en 1769. Je le mentionne ici pour faire écho au commentaire récent d'Alain Sennepin sur le billet consacré à Mutis, et qui me renvoyait à un article du magazine
Knowable sur cet incroyable navigateur au savoir géographique étendu.
J'en ai appris plus sur Tupaia après lecture d'un article de Courrier international, extrait du Wall Street Journal :
"Lorsque le prêtre polynésien Tupaia décide de quitter Tahiti en embarquant avec le capitaine James Cook pour, in fine, rallier l’Angleterre, il part dans un but précis : revenir d’Europe avec des exemplaires de ces mousquets qui assurent aux Anglais une supériorité mortelle face aux lances et aux herminettes des Tahitiens. C’est ce qu’écrit l’historienne et romancière Joan Druett, l’auteure d’une biographie* “
réussie” du Polynésien, selon The New Zealand Herald. Ainsi armé, Tupaia entend combattre ses ennemis de l’île de Bora-Bora, qui l’ont chassé de son fief, l’île de Raiatea. À bord de
l’Endeavour, Tupaia se révèle un marin hors pair, capable de s’orienter sans compas ni sextant. Mais, dans son journal de bord, James Cook peine à reconnaître les mérites du Tahitien. Certes, il évoque son rôle d’intermédiaire avec les Maoris de Nouvelle-Zélande, mais il minimise l’importance de
la carte de plus de 70 îles qu’il a lui-même établie en collaboration avec Tupaia.
 |
| Carte dessinée par Tupaia (elle n'obéit pas aux critères occidentaux, et elle n'a été décryptée que récemment*) |
Tupaïa n’arrivera jamais en Angleterre. Il meurt en novembre 1770, à proximité de Batavia (l’actuel Jakarta), probablement du scorbut. “C’était un homme avisé, intelligent et ingénieux, mais orgueilleux et obstiné, ce qui rendait souvent sa vie à bord désagréable, à la fois pour lui-même et pour ceux qui l’entouraient”, écrit James Cook dans son journal de bord. Une nécrologie “d’une grossière injustice”, estime Joan Druett. Les données récoltées par James Cook et le naturaliste Joseph Banks ont “bénéficié de l’intermédiaire polynésien le plus intelligent et le plus éloquent de l’histoire des découvertes européennes : si les journaux de Cook et de Banks sont d’éminentes relations de voyage, cela est dû directement à Tupaia.” Pour l’auteure, cette épopée aurait dû être celle de trois hommes extraordinaires, et non de deux, et Tupaia n’aurait jamais dû être plongé dans l’anonymat qui a été jusqu’à récemment le sien."
* Tupaia, le pilote polynésien du capitaine Cook, Joan Druett, ’Ura-Éditions, 2015, pour la traduction française.
3/ Le récit de Patrick Deville ne suit pas complètement le fil chronologique. Il commence par ce qu'il appelle la première image, la photographie prise par Gustave Viaud, le frère de Pierre Loti, le 15 août 1860. Première image, car c'est la première de Tahiti à n'être du dessin ni de l'aquarelle ni de la peinture de chevalet.
La photo est décrite mais n'est pas reproduite dans le livre (la photo de la couverture n'est pas celle de Viaud). Je l'ai retrouvée sur le site de la Médiathèque historique de Polynésie.
 |
Papeete, maison de Gustave Viaud
Auteur : Gustave Viaud (1836-1865)
Date : 1859/1862 |
Sujet : Frère aîné de l’écrivain Pierre Loti (Louis Marie Julien Viaud), Gustave Viaud est chirurgien de marine et débarque à Tahiti en 1859, il exerce à Taravao et dans les îles. Il fut probablement le premier photographe de Tahiti. Il possédait un appareil qui exigeait des temps de pose très longs, entre 5 et 15 minutes, qui l’obligea à ne prendre que des paysages, à l’exception d’une photo de la princesse de Bora Bora. Gustave Viaud laisse 25 vues de Papeete qui constituent autant de documents historiques. Il quitte Tahiti en 1862 avant d’être nommé en Cochinchine. Gustave ne reviendra jamais à Tahiti, il décède le 10 mars 1865, sur l’Alphée, et est immergé le lendemain à la sortie du détroit de Malacca.(Wikipedia)Type : Calotype (facsimilé)Droits : Domaine publicSource : Gustave Viaud, premier photographe de Tahiti – Société des Océanistes – Exposition du Musée de l’Homme en 1964 (Patrick O’Reilly – André Jammes).
Ceci m'a conduit à lire enfin Le roman d'un enfant, de Pierre Loti, que j'avais chiné à la brocante de Chéniers le 18 août 2019, un livre presque de poche, collection Nelson (1931), où l'écrivain évoque avec beaucoup de sensibilité et de poésie ses souvenirs d'enfance à Rochefort, et donc le départ de son grand frère adoré pour Tahiti. Il parle de sa première lettre reçue de là-bas, qui mit quatre mois à parvenir en France. Elle contenait un billet pour le petit Julien, accompagnée d'une fleur séchée, sorte d'étoile à cinq feuilles d'une nuance pâle, encore rose, une pervenche, "qui était une petite partie encore colorée, encore presque vivante, de cette nature si lointaine et si inconnue..."
"Et, après bien des années, quand je vins faire un pèlerinage à cette case que mon frère avait habitée sur l'autre versant du monde, je vis qu'en effet le jardin ombreux d'alentour était tout rose de ces pervenches-là . qu'elles franchissaient même le seuil de la porte et entraient, pour fleurir dans l'intérieur abandonné."

Le titre de l'article est tiré de l'un des derniers chapitres de Fenua, où Deville relate son séjour à Bora-Bora, depuis son arrivée sur la quai du village de Vaitape, "où s'était entassé le matériel photographique de Murnau". Il avait ensuite pris un autocar pour la pointe Matira et l'hôtel Maitai. Là, allongé sur un lit, il relisait dans un carnet des phrases "de ce Loti tant décrié qui pourtant nous avait tous amenés ici : "Là-bas, en dessous, bien loin de l'Europe, le grand morne de Bora-Bora dressait sa silhouette effrayante, dans le ciel gris et crépusculaire des rêves." S'il n'avait jamais vu l'île, précise Deville, à la différence de son frère Gustave qui fait photographié la princesse de Bora-Bora, il en avait fait la lieu de naissance de sa Rarahu, et lorsque son personnage Loti embarquait pour le retour, Viaud avait composé la bluette qu'elle lui adressait :
A hoi mai pai ei parahi tua / Reviens pour que nous restions ensemble
i tau fenua i Bora-Bora, / dans mon pays de Bora-Bora
ei haapaa i nia iho / pour que nous nous installions
i tau fenua i Bora-Bora / dans mon pays de Bora-Bora "
_________________________
* Ce décryptage est à lire par exemple sur un article de Tahiti-infos, relatant une conférence donnée en 2013 par Jean-Claude Teriierooiterai :
" Il y a 5 ans, une chercheuse du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, ndlr) Anne Di Piazza, qui est française - d’ailleurs ce détail mérite d’être relevé, parceque jusqu’à présent tous les spécialistes qui ont étudié la navigation polynésienne viennent des pays anglo-saxon. (…) Et là, nous avons cette dame-là parce que maintenant on sait à quoi sert la carte de Tupaia. On sait que nous, Polynésiens, nous sommes dans la tradition orale. Il n’y avait pas d’écrit. On ne dessinait pas une carte, il y a 200 ans. Les cartes étaient plutôt emmagasinées dans la tête, dans la mémoire.
Tupaia a donc dû faire un exercice qui n’était pas facile pour lui. Il fallait traduire tout ce qu’il avait dans sa mémoire et mettre tout cela sur un papier, mais il a fait ce qu’il a pu avec le capitaine Cook et les scientifiques qu’il y avait sur l’Endeavour. Cela se passait en 1769 et Tahiti venait juste d’être découverte deux ans plutôt. On était là dans le domaine encore vierge de la connaissance. (…) et donc, la connaissance que Tupaia avait transmise venait directement des ancêtres.
Aujourd’hui, avec cette carte qui a été décryptée par Anne Di Piazza, on sait à quoi elle servait. Ce n’est pas une carte géographique. Elle ne servait pas pour positionner une île ou un archipel par rapport à un autre archipel, mais plutôt à indiquer comment, à partir d’une île, rejoindre une autre île. C’était une carte de navigation. Grâce à l’exploit d’Anne Di Piazza, on sait désormais comment l’utiliser. En fait, du point de vue de Tupaia, il prenait une île et de là, il plaçait les autres îles ainsi que leur espacement (…) en jours de navigation. Tupaia a su donner le temps de navigation entre une île et une autre et ce, par rapport aux vents dominants. Par exemple, sur une carte moderne, l’île de Hao est placée par rapport à l’île de Mataiva (archipel des Tuamotu). Hao est deux à trois fois plus loin que Mataiva par rapport à Tahiti. Le problème, c’est que Tupaia avait positionné Hao très proche de Tahiti, par rapport à Mataiva. Certains ont a dit « mais il a mal placé Hao ! », et donc pendant des années, on a dit que la carte de Cook était bien, puisqu’elle donnait les noms des îles, mais complètement erronée par rapport aux distances. (…) Pourtant, Anne Di Piazza a démontré le contraire. Pour elle, la carte était exacte puisque, par rapport aux vents dominants (celui du Sud-Est appellé « Mara’ai » en tahitien) donc, le temps qu’on met pour venir de Hao à Tahiti est très court, alors que celui de Mataiva à Tahiti était plus long puisque ce trajet précis se faisant en vent contraire. Il fallait louvoyer, louvoyer ce qui augmentait considérablement le temps du voyage. Alors qu’entre Hao et Tahiti, c’était plus rapide. Ce détail, Tupaia l’avait effectivement bien positionné sur la carte. Il ne s’était pas trompé".
On peut lire aussi l'article (en anglais) de Lars Eckstein et Anja Schwarz : The Making of Tupaia’s Map: A Story of the Extent and Mastery of Polynesian Navigation, Competing Systems of Wayfinding on James Cook’s Endeavour, and the Invention of an Ingenious Cartographic System (Journal of Pacific History, volume 54, 2019)