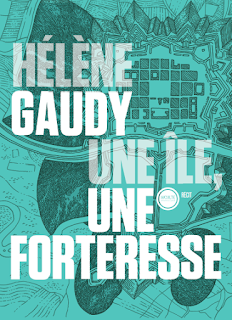"Finkielkraut a été chercher le Péguy du déclin de l’école républicaine sachant que ce qu’on dit de l’école en 2014, Péguy l’écrivait déjà en 1900. Malgré la très grande intelligence de Finkielkraut (bien supérieure à la mienne), je pense qu’il n’a pas compris que Péguy n’était pas un nostalgique. Les grandes saillies de Péguy sur la France éternelle et sur les petites rempailleuses de chaise ne font pas de lui un passéiste. Péguy fait l’apologie de la mémoire et non pas de quelque chose de figé. Finkielkraut regrette que le monde d’aujourd’hui ne soit pas celui d’hier. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que Péguy n’est jamais passé de la gauche à la droite mais de la politique à la mystique."
On appréciera le petit tacle décoché en passant à Finkielkraut. Bref, Moix, Fink... l'Attracteur étrange me gâte en m'envoyant dans les pattes des adversaires de pensée plutôt que des amis. Et il n'est pas question de passer outre car j'ai toujours essayé, je dis bien essayé, de penser contre moi et de me frotter à ce qui se dérobe à ma pente naturelle.
Tout de même, ce même vendredi, invité à France-Inter par Ali Baddou, Fink est survolté. Après avoir confessé avoir pris trois ou quatre fois du LSD dans sa jeunesse (ce qui est un bel exemple d'honnêteté dont ne s'indigneront que les imbéciles), il tire à boulets rouges sur la jeune Greta Thunberg: "Je trouve lamentable que certains adultes s’inclinent aujourd’hui devant une enfant. Je crois que l’écologie mérite mieux", et encore "Nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l’être que de nous
mettre au garde à vous devant Greta Thunberg et d’écouter les
abstraites sommations de la parole puérile." Il rejoint donc le chœur des contempteurs de la jeune suédoise, les Nicolas Sarkozy, Pascal Bruckner, Laurent Alexandre, on ne les compte plus les sombres ricaneurs qui se donnent à bon compte, sur le dos d'une enfant, un certificat d'indépendance de pensée. Mais qui s'incline ? Qui se met au garde à vous ? Écouter, est-ce fléchir le genou ?
Qu'est-ce que Fink aurait dit si une jeune fille d'à peu près le même âge avait non seulement prétendu à la prise de parole, mais à conduire le pays à la guerre contre ceux qui l'occupent et en menacent l'intégrité ? Une jeune fille qui serait allé débusquer le Président dans ses pénates, en arguant de "voix" qui lui en auraient donné l'ordre... A cette parole puérile, que n'aurait-il pas rétorqué...
Et pourtant, pour un péguyste* revendiqué, ce n'est pas bien fort. Car enfin, cette jeune femme c'est Jeanne d'Arc, dix-sept ans en 1429, quand elle rejoint le dauphin et lève le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc dont le poète Péguy a retracé l'épopée dans son Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, dont s'inspire aujourd'hui Bruno Dumont (qui ne prend pas pour rien une actrice de douze ans pour incarner le rôle**). Jeanne, c'est Greta puissance cent.
 |
| Lise Leplat-Prudhomme, dans Jeanne de Bruno Dumont |
Ceci étant dit, j'ai acheté et lu le livre, et dans la journée encore, ce qui n'est pas un exploit car ce n'est pas très long, c'est 115 pages qui ne se veulent pas une autobiographie mais un retour sur une quête obstinée du vrai du réel, de l'élucidation de l'être et des événements - je reprends les termes de l'avant-propos. Qui ne serait d'accord avec ce projet ?
Je suis en pleine lecture lorsque le moment arrive de conduire mon fils Gabriel à un rendez-vous médical à Ardentes. Il est dix-sept trente, un vendredi, la plus mauvaise heure pour circuler dans Châteauroux. Au rond-point de l'avenue Marcel Lemoine, ma récente obsession des plaques d'immatriculation ressort : un 6666 pointe son nez, et la voiture qui roule devant moi affiche un blason 66, des Pyrénées-Orientales. J'enregistre, en me demandant pourquoi cette avalanche de 6 alors que ces derniers jours se sont imposés plutôt le 7 et le 9. Quand j'arrive à Ardentes, avec quelques minutes de retard, je consigne un 666.
Dans la salle d'attente, je reprends la lecture du livre, chapitre II, L'interminable question juive. Fink fait amende honorable sur une ancienne posture de victime qu'il assimile à une comédie, et il faut lui savoir gré de cet aveu lucide. C'est là que, soudain, la présence du six prend tout son sens. Je lis, page 29 :
"Et je m'en voulais d'avoir été le bénéficiaire consentant de la stupeur révérencieuse qui s'imprimait sur le visage de mes interlocuteurs quand je leur apprenais que mon père était un survivant d'Auschwitz. Fini la mascarade, assez de simagrées : il m'incombait désormais d'être fidèle sans monter sur scène pour témoigner de ma fidélité. Ai-je tenu ma promesse ? A la lecture des Disparus, livre paru en 2007, je me suis rendu compte que la réponse était non et que la démystification du juif imaginaire ne m'avait pas rendu aussi attentif que j'aurais dû l'être. Cette enquête méticuleuse et pieuse de Daniel Mendelsohn sur les morts sans sépulture de sa famille (six parmi six millions) m'a renvoyé à ma propre négligence."[C'est moi qui souligne]
Le livre Les Disparus était au sommet d'une pile, dans la chambre, attendant son heure.
________________________
* A la page 70, j'ai eu la surprise de retrouver l'extrait de Péguy que j'avais cité le 18 septembre : "Ce que fut pour moi cette entrée dans cette sixième à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant rosa, rosae, l'ouverture de tout un monde, tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu'il faudrait dire, mais voilà qui m'entraînerait dans des tendresses."
** A la question : "N'est-ce pas dérangeant d'en faire une enfant dans votre film, en salles mercredi ?", Bruno Dumont répond : "Au départ, c'est un concours de circonstances qui a fait que Jeanne Voisin (qui jouait Jeanne adolescente dans le premier film Jeannette, portant sur l'enfance à Domrémy) ne puisse reprendre le rôle. Heureusement qu'il y a eu ce concours car cela met en lumière la puissance de l'innocence, de l'enfance, la détermination. C'est une petite qui n'a peur de rien. Elle représente quelque chose présent dans chacun d'entre nous. Péguy disait qu'on a tous douze ans. Même si cette âme se déglingue un peu, on en garde le souvenir. Dans la peinture flamande qui m'inspire, les peintres pouvaient modifier la proportion des personnages. La disproportion est très intéressante. La modification de la perspective accentue l'enfant. Quand je vois les Brueghel et les Bosch, il y a le recours au grotesque et la distorsion pour représenter la nature humaine." (France3)