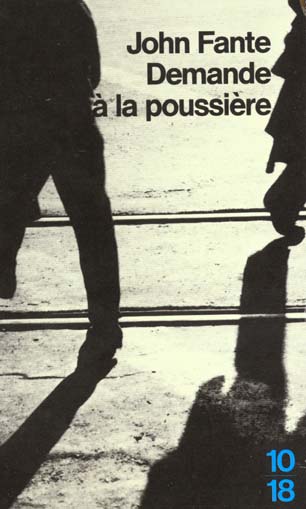Poursuivi hier ma lecture du maître-livre de Peter Handke, Mon année dans la baie de Personne. Je progresse lentement, comme si j'arpentais un sentier de montagne abrupt, avec risque de glissade dans les éboulis qui le longent. Me voici parvenu à la troisième partie, qui porte le nom générique d'Histoire de mes amis et se compose de sept chapitres. Hier, donc, j'abordai l'Histoire de mon amie, quatrième du lot, amie dont le nom n'est pas donné, ce qui semble assez logique quand on apprend qu'elle "était celle pour qui rien ni personne n'avait un nom, et quand cela arrivait tout de même, jamais le nom traditionnel", mais on sait qu'elle est slovène, née à Maribor, et qu'elle fut Miss Yougoslavie et championne nationale junior à la course, au saut en longueur, à la nage et au volley-ball. Et puis première femme de Slovénie à devenir forestière, gozdar, avant de retourner tenir l'auberge de ses parents, sans pour autant s'interdire de partir souvent dans des voyages en solitaire, surtout en Turquie. Voyages en solitaire dont Handke dit dès l'ouverture qu'elle voulait revenir avec un trésor, mais que, chaque fois, elle revenait les mains vides, non pas qu'elle ait échoué à le trouver, ce trésor, mais chaque fois elle le laissait quelque part, sur le trajet du retour, "et le dernier même, au dernier coin de rue avant sa porte." Tout simplement, parce qu'à la fin du voyage, ses trouvailles "s'avéraient n'être pas le trésor auquel elle avait pensé."
Bien singulière amie à qui je n'aurais malgré tout sans doute pas consacré une chronique si je n'étais tombé sur un passage qui résonnait curieusement avec l'article précédent, avec les cycles de l'eau étudiés par Jérôme Gaillardet et, surtout, avec le poème de Raymond Carver sur les eaux qui se mêlent. Peter Handke raconte que son amie était cette fois allée en Turquie pour passer en contrebande une Ford Mustang à quelqu'un d'Izmir. Ceci fait, il dit qu'elle continua vers l'est en traversant l'intérieur du pays, "où, dans une seule plaine, souvent, de nombreux cours d'eau, petits ruisseaux ou petites rivières, signalés par un échelonnement de haies naturelles faites de roseaux, souvent dans un espace vide, chacun comme un être vivant, se dirigeaient côte à côte vers la mer, lents et faciles à traverser (pour elle)." (p. 381)
L'image carvérienne des eaux qui se mêlent se retrouve dans l'évocation par Handke de cette "frontière entre les deux zones de vagues, celle du ruisseau et celle de la mer, leur choc et leur interpénétration, extrêmement douce [...] C'était pour elle quelque chose de particulier que de sentir sur la gorge, sur la hanche ou les cuisses cette frontière légèrement mouvante, une des eaux devant elle, l'autre derrière. [...] Ces régions de débouchés en miniature l'attiraient plus puissamment que la mer." (p. 382)
J'avais noté sur le moment, c'était en début d'après-midi, cette résonance sans savoir encore si j'allais en faire quelque chose.
 |
| Emmanuèle Bernheim - Photo Ulf Andersen. |
Au soir, je repris la lecture entamée la veille du douzième volume du Dernier Royaume de Pascal Quignard, Les heures heureuses. Et parvins au chapitre XXVII, dont le titre est 1955-2017. Dates de naissance et de mort d'Emmanuèle Bernheim, écrivaine et scénariste. Et cela commence ainsi :
"Quand le hasard, l'absence, la nuit, ce livre, font que je songe à Emmanuele Bernheim, ma tête s'emplit de lumière.Si rare l'amitié entre un homme et une femme sans que rien se sexuel n'y surgisse ou n'y porte son ombre." (p. 113)
Emmanuèle Bernheim était donc l'amie de Pascal Quignard, et ce qui est stupéfiant avec ce nouvel écho c'est que l'écrivain la décrit avant tout comme une nageuse acharnée : "Sans cesse elle fonçait vers la mer comme le méandre de la Seine le fait à Rouen puis au port de Jumièges, traversant le marais." Plus loin : "Dans la piscine de l'hôtel de Tozeur, quand elle s'élançait du plongeoir au fond de l'eau, c'était une championne olympique de la RDA. / Dans l'Atlantique elle attend le surgissement de la plus haute vague et, tête baissée, se lance, la crève."
La nage n'est pas le seul point commun entre les deux femmes. Outre le caractère bien trempé qu'elles partagent, le thème de la mort les rassemble. Dans son sixième et dernier livre, Tout s’est bien passé (Gallimard, 2013), Emmanuèle Bernheim parlait de la mort de son père, à 89 ans. Elle racontait comment elle l'avait assisté, avec sa soeur, à sa demande de suicide, en Suisse. Quatre ans plus tard elle était emportée à son tour à 61 ans, le 10 mai 2017, des suites d’un cancer du poumon. Dans le court chapitre XXIX, Quignard évoque une ruine de phare à l'entrée de la baie de Saint-Florent, où son amie aimait à traverser le bras de mer. "C'était la tour de Hérô dans le Bosphore, écrit-il." Evoquant ici le mythe grec de Léandre et Hérô. Héro, prêtresse d'Aphrodite qui vivait dans une tour à Sestos sur la rive européenne de l'Hellespont, était aimé de Léandre, un jeune homme d'Abydos, sur la rive asiatique. Il nageait chaque nuit pour la rejoindre de l'autre côté, guidé par la lumière que Hérô allumait au sommet de sa tour. Mais lors d'un orage, la lampe s'éteint et Léandre se noie. Lorsque la mer rejette son corps le lendemain, Hérô se suicide en se jetant du haut de sa tour.
 |
| Hérô se lamentant devant le corps de Léandre, Jan Van Den Hoecke (1635-1637) |
Et Pascal Quignard de conclure ainsi son chapitre :
"Emmanuèle, tu aurais dû choisir de mourir en te noyant dans cette baie.
*
Comme Leander de Marlowe, comme lord Byron quand il vint à Sestos, tu te dénuderais, tu lèverais tes bras dans la nuit, tu plongerais. Tu mourrais au pied de la tour." (p. 127)
De même, Peter Handke conclut l'histoire de son amie en racontant comment, déposée par un taxi à proximité d'un champ de ruines antiques où se trouvaient les vestiges d'un temple de Léda, après avoir plongé au fond de la mer et découvert des sarcophages d'un cimetière englouti, elle s'était assise sur le rivage :
"Et mon amie dit à mi-voix, ne s'adressant à personne en particulier, ni à elle-même : "Je n'ai jamais vécu une chose pareille. C'en est fini de moi. Je vais bientôt mourir. Aujourd'hui, c'était un jour de bonheur. Merci. Quand était-ce ? Il y a déjà longtemps. Je porte un deuil. Ah, mouvement ! Que veux-tu donc chercher ? Regarde. Il faut regarder. Douce vie. J'ai peur. Y a-t-il quelqu'un ?Et elle écoute sa propre voix et s'étonne de ce qui sort d'elle à travers une simple parole ainsi jetée.Et elle souhaite périr, elle souhaite la gloire." (p. 392-393)
Et où se passent donc les deux histoires, sinon en Turquie ?
Et c'est en Turquie, qu'on appelait Asie Mineure, que se place encore une troisième résonance stupéfiante. Des trésors que rapportait son amie, Handke dit qu'au fil des ans, "elle se mit, si possible au cours même du voyage, à les rapporter à leur place, comme maintenant, dans son entreprise au sud de la Turquie, la borne de route ou de stade antique péniblement déterrée à Ephèse et roulée ensuite pendant des heures et des heures, avec les mains et avec les pieds, et où était inscrit un fragment d'Héraclite : " L'essence de chaque jour est une seule et même", et dont il lui sembla , lorsque l'environnement est changé, qu'il ne s'agissait que d'un accessoire de théâtre." (p. 368-369)
Dans le chapitre XXVI, Les civelles, qui précède immédiatement le chapitre consacré à Emmanuèle Bernheim, Pascal Quignard cite lui aussi un fragment d'Héraclite : "Sea, See, Seele. Mer et âme. / Héraclite disait : C'est la mort pour les âmes - devenir eau." (p. 105) et, à la page suivante, on peut lire ceci :
"La mer peut être dite le fleuve du "même" où tous les fleuves s'engloutissent, où ils se perdent, tandis que le fleuve, qui a une direction, qui va de l'amont vers l'aval, n'est jamais le même, n'est jamais la mer où il vient pourtant se fondre, puisqu'il ne repasse jamais dans ce passer qui en connaît que son élan, que son écoulement.Mouvement d'une perte infinie.C'est le Caystre à Ephèse."
Le Caystre, du grec ancien Καϋστρίος / Kaüstríos, fleuve côtier de l'antique Lydie et de l'actuelle province d'Izmir, en Turquie. Vénéré par les Grecs comme un dieu, cité par Homère dans le livre II de l'Iliade, lorsqu'il évoque le mouvement des troupes des Achéens : " Comme l'on voit, par groupes denses, des oiseaux ailés, courlis, canards sauvages, cygnes parés d'un long cou, dans les prés d'Asias, sur les deux rives du Caÿstre, voler de-ci, de-là, en battant fièrement des ailes, et se poser avec des cris dont les prés retentissent. "