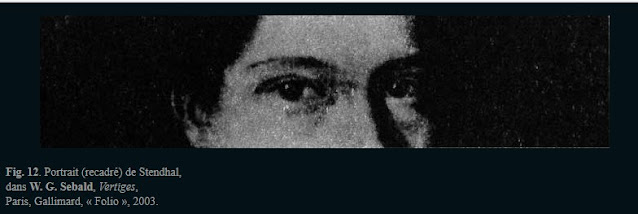"L'échelle, écrit Anouchka Vasak, - escalier, estrade, scala, strada - alerte sur un dispositif subjectif déterminant chez Stendhal. 1797 est peut-être le moment où il se cristallise, comme en témoignent les petits dessins du tableau de l'école centrale." (1797, Pour une histoire météore, p. 352)
 |
| Stendhal au tableau de M. Dupuy (A : Ardoise). Source : Stendhal, ville de Grenoble, Bibliothèque municipale, Vie de Henry Brulard, volume 2 |
"Je connus la douleur pour la première fois de ma vie. Je pensai à la mort.L'arrachement produit par la mort de ma mère avait été de la folie où il entrait à ce qu'il me semble beaucoup d'amour. La douleur de la mort de Lambert fut de la douleur comme je l'ai éprouvée tout le reste de ma vie, une douleur réfléchie, sèche, sans larmes, sans consolation."
"Un soir d'hiver, ce me semble, j'étais dans la cuisine vers les sept heures du soir, au point H vis-à-vis l'armoire de Marion. Quelqu'un vient me dire : "Elle est passée." Je me jetai à genoux pour remercier Dieu de cette grande délivrance."
Anouchka Vasak suggère que le point H est peut-être lié à l'échelle : "non seulement à la notion de gradation ("série continuée et progressive"), étant entendu que le point H serait le climax de cette progression, mais aussi à l'échelle ou l'escalier comme objet. Le point H est ce lieu paroxystique du plaisir et de la jouissance, de l'émotion, comme la Scala de Milan. Point, pointe, punctum."
Je saute par-dessus bien des conjectures intéressantes pour en arriver à la conclusion de Vasak :
"La difficulté où est Stendhal de préciser la date (96, 97, 98 ?) est significative de la période, et conforme à la pensée météore qui s'ouvre avec elle. Pourquoi Stendhal est-il un des premiers à le révéler, avec la désinvolture qui est la sienne, dont témoigne également l'inachèvement de l'autobiographie ? Peut-être parce qu'il est un des premiers à accueillir, à assumer et à mettre en scène la travail de la mémoire subjective dans l'Histoire. Ce que Stendhal initie aussi, c'est un rapport inconscient au signifiant, structurant du sujet. En France, les oeuvres de Jacques Derrida et Hélène Cixous, elle-même grande amatrice de Stendhal, systématiseront ce "travail" au sens analytique : l'empreinte du signifiant dans le sujet. Il me plaît de penser que c'est Stendhal qui, vers 1797, a ouvert la voie." (pp. 370-371)
Lisant ce chapitre, j'ai donc établi le rapport avec ce motif de l'échelle apparu l'année dernière et que je n'avais pas alors relaté. Mais je me suis également souvenu d'un roman de Philippe Sollers où il était question à plusieurs reprises de la Vie de Henry Brulard. Il s'agissait de La Fête à Venise (1991), un livre important pour moi car sa lecture coïncide avec la naissance du concept d'archéo-réseau. Stendhal y apparaît dès la première page et le second paragraphe :
"C'est le 18 septembre 1846 que Le Verrier écrit sa fameuse lettre à Galle. Celui-ci la reçoit le 23 et, la nuit suivante, profitant d'une carte récente et corrigeant une légère erreur de calcul, observe pour la première fois au téléscope la présence de Neptune. On dit que Le Verrier avait mauvais caractère. Possible. J'aime son nom, parmi d'autres. J'aime qu'Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, note qu'il a commencé la rédaction de ses souvenirs le 20 juin 1832, "forcé comme la Pythie". Il a quarante-neuf ans, il est à Rome. Il s'arrête le 4 juillet de la même année, abandonnant son manuscrit sur ces mots : "La chaleur m'ôte les idées à 1h 1/2."On devrait tout laisser inachevé, c'est mieux." (pp.11-12)Ces souvenirs, c'est bien sûr Vie de Henry Brulard. Qui revient à plusieurs reprises dans la suite du roman. Ainsi, page 153 :
"On ne parle pas assez des croquis de lieux et de situations que Stendhal accumule dans ses manuscrits posthumes, topographie émotive et rapide. Il n'a rien à perdre, tout à retrouver. J'étais là, j'allais de là à là, sa mémoire est debout devant lui, tableau noir, carte militaire, partition de musique, souvenirs marqués géométriquement avec leur halo vivant de contrainte ou de joie. Ainsi pour l'annonce de la mort de Séraphie, la soeur de sa mère, sa persécutrice : "Je me jetai à genoux au point H pour remercier Dieu de cette grande délivrance." Le dessin représente la cuisine où il se trouvait (il a quatorze ans) quand la nouvelle ("Ell est passée") a été dite ; la petite cour près de la cuisine ; une grande table ; un point O, "boîte à poudre qui éclata", et sa présence donc, au point H (il s'appelle Henri et sa mère perdue bien-aimée Henriette). D'autres fois, il est en H.H.H. C'est beaucoup plus qu'un récit, une incision à vif, une scarification, une stèle. Un peu comme les Grecs, après un raid victorieux, dressaient un trophée. Réhabiter le point H, tout est là pour qui s'est beaucoup comprimé, et pour cause, dans le temps et l'espace." (pp. 153-154)
Au troisième paragraphe du roman, était apparue Luz, vingt-trois ans, née en 1966 à Los Angeles, étudiante en physique et astronomie à Berkeley. Rencontre par hasard au Louvre avec le narrateur, Pierre Froissart. J'ai déjà écrit (c'était le 6 juillet 2009) que Luz était un nom pour moi primordial : "Luz, la lumière en espagnol, est un nom primordial pour moi, car c'est avec lui que j'ai ouvert l'Archéo-réseau, en février 1991. Deux livres déroulaient en parallèle des échos improbables : Une saison chez Lacan, de Pierre Rey, et La Fête à Venise de Philippe Sollers. L'héroïne de celui-ci se nommait elle aussi Luz, elle était née en 1966 à Los Angeles et avait les yeux très bleus : description qui convenait bien à celle avec qui je partageais ma vie à l'époque.
Sollers citait lui-même un passage d'Hemingway : "Par une soirée brûlante, à Padoue, on le transporta sur le toit d'où il pouvait découvrir toute la ville. Des martinets rayaient le ciel. La nuit tomba et les projecteurs s'allumèrent. Les autres descendirent et emportèrent les bouteilles. Luz et lui les entendirent en-dessous, sur le balcon. Luz s'assit sur le lit. Elle était fraîche et douce dans la nuit chaude."