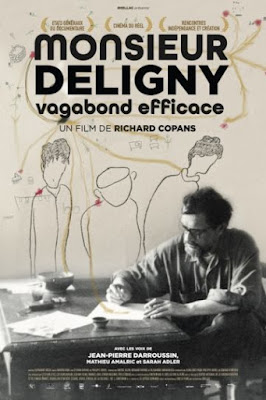J'étais d'autant plus empressé de le lire que le titre à lui seul m'avait saisi. Car enfin, outre la quasi-synchronicité entre l'article et ce Tract, quel mot-clé avait émergé sinon celui de naufrage (inscrit d'ailleurs comme un des libellés attachés au billet) ? Rappelons juste ce passage, comme exemple :
Michaël Ferrier choisit donc pour évoquer le temps présent de s'appuyer sur le récit du naufrage du navire portugais São Paulo datant de l’année 1561. Il s'en explique dans une lettre à Victor Kirtov, rédacteur du site Pileface : "Plutôt qu’un de ces journaux de confinement qui, sauf exception, m’agacent un peu (j’espère qu’ils/elles ne vont pas nous faire en plus des journaux de déconfinement !), il m’a semblé intéressant d’en retourner à l’aube de la mondialisation marchande, et de prendre le sujet sous un angle à la fois historique et littéraire. Vogue la galère !""En date du 9 juin 1946, Giono recopie dans son « journal » un extrait du Voyage de la corvette L’Astrolabe de Dumont d’Urville, qui semble bien correspondre à la manière dont il perçoit sa situation à ce moment : « Nous restâmes ainsi en perdition pendant plus de trois jours ; et dans cette position si longuement désespérante, on voyait par un contraste assez singulier tous nos hommes en costume du dimanche ou de naufrage, comme on voudra l’appeler, c’est-à-dire vêtus de leurs meilleurs habits."
Il est ma foi assez réjouissant de voir que cette intervention du récit de naufrage relève elle aussi d'un hasard :
"Ce à quoi nous assistons depuis quelques semaines porte un nom : c’est un naufrage. Le hasard, qui peut être surprenant comme la rencontre d’une chauve-souris et d’un pangolin sur un lit de réanimation, fait parfois bien les choses : quand la pandémie a commencé à se répandre sur la planète, j’étais en train de lire les Histoires tragico-maritimes (Éditions Chandeigne, 1992), trois récits de naufrages où, sur des mers variées, les hommes meurent par milliers. Ces trois récits portugais sont d’un autre temps (le xvie siècle), dans un contexte sociopolitique différent (à l’aube de la mondialisation des transports, aujourd’hui si avancée) et où la maladie ne joue qu’un rôle parmi d’autres. Pourtant, il n’est pas inutile de prêter l’oreille à ces témoignages des rescapés. Écrits dans une langue précise et sobre, ils voguent littéralement sur une mer déchaînée pour traverser les siècles et se porter jusqu’à nous. Que nous disent-ils ? "(p. 4)
Un peu plus loin, il écrit que "les réactions des uns et des autres forment une sorte de florilège du désastre, où l’on pourra reconnaître les bas-fonds de la nature humaine, dans toute sa diversité." Le dévouement, l'abnégation, le sang-froid y côtoient la lâcheté, l'égoïsme et les croyances stupides et criminelles, rien n'a vraiment changé en presque cinq cents ans.
Comme le naufrage, cette expression "florilège du désastre" ne peut manquer de me toucher également : le désastre ne s'est-il pas imposé comme la figure majeure le 20 avril avec Don DeLillo (A l'avant-poste du désastre), et deux jours plus tôt encore avec Des bibliothèques et du désastre ? Michaël Ferrier s'y connaît d'ailleurs bien en désastre, car il était à Tokyo quand tremblements de terre et tsunami ravagèrent le Japon, provoquant la catastrophe de Fukushima. Il en tira un livre puissant, Fukushima, sous-titré justement Récit d'un désastre, que je lus en 2013.
Ce qu'il écrivit alors, devant la menace nucléaire aussi invisible que celle du coronavirus aujourd'hui, mérite d'être relu et médité. Dans le sillage des Notes d’Hiroshima de Kenzaburô Oé, prix Nobel de littérature, il s’en prend, écrit Albert Gauvin, à « cette fraction des élites dirigeantes qui, avec le nucléaire est en train d’imposer une entreprise de domestication comme on en a rarement vu depuis l’avènement de l’humanité ».
Et la fin de Naufrage est tout autant à méditer :
"Mais les récits du naufrage n’ont pas seulement valeur de témoignage. « Après des tourmentes des épreuves et des mésaventures innombrables », le 27 avril 1561, après avoir marché plus de six cents lieues, bu de l’eau croupie et mangé du singe, les survivants arrivent au port de Banda, aux îles Moluques, sans vêtements sur la peau et couverts de blessures. Récupérés par une escadre portugaise, ils sont reçus comme des revenants de l’autre monde. Le capitaine a alors cette phrase troublante : « Mieux vaut posséder moins sur la terre que de traverser la mer pour des biens si transitoires et de si peu de durée. »
Ainsi, loin de ses grands rêves de conquête et de commerce, le capitaine en est réduit au constat terrible d’un monde littéralement à bout de souffle, en perdition. La catastrophe nous dénude : elle montre la pauvreté de notre imaginaire économique, découvre les défauts du fonctionnement politique comme nos fissures les plus intimes. Elle révèle le caractère au fond inadmissible de notre organisation du monde, et nous invite à retrouver un espace où le corps et la pensée puissent à nouveau circuler autrement."
"En tournée au Brésil où il présentait ses spectacles « By Heart » et « Sopro », Tiago Rodrigues a dû rentrer au Portugal à la suite de l’annulation des dernières représentations. Très vite, l’équipe de direction a décidé de mettre en ligne sur le site du Dona Maria II les captations des spectacles présentés ces dernières années. Ce « rafiot dans un jour de tempête » rencontre un beau succès et ils sont de plus en plus nombreux à attendre, chaque vendredi et samedi à 21h, la mise en ligne d’un nouveau spectacle. Nous ne pouvons que vous conseiller de regarder la captation surtitrée en français de « Sopro », mis en scène par Tiago Rodrigues. Elle est disponible ici. "
 |
| Sopro |