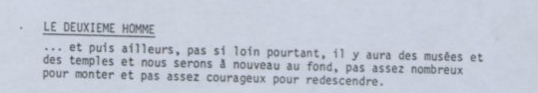A La Châtre, où j'ai habité pendant quelques années, jusqu'en 2003, existait à la sortie de la ville un magasin de vente de pièces automobiles d'occasion, qui portait le nom explicite de Récup Auto (il existe d'ailleurs toujours mais se nomme maintenant Ciel bleu). Il était rapidement devenu une sorte de Noz, spécialisé dans le déstockage en tout genre où, à côté des enjoliveurs et des batteries, on trouvait des meubles, des vêtements, de la bouffe et de la déco, et aussi, oui, des livres. Et pas n'importe lesquels. J'y découvris des Journaux de Louis Calaferte, un essai sur le grand orientaliste Louis Massignon, et, au milieu d'autres bouquins de théologie tout à fait improbables en un tel lieu, un recueil de chroniques d'un certain Olivier Clément que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, publié en 1990 chez Desclée de Brouwer et intitulé Anachroniques.
Issu d'un petit village du vignoble languedocien, enfant d'une famille athée où l'on ne parlait jamais de Dieu, où l'on ne baptisait pas les enfants ni l'on enterrait religieusement les morts, et devenu agrégé d'histoire, il avait découvert la chrétienté orthodoxe à la lecture de Nicolas Berdiaev et de Vladimir Lossky, dont il fut ensuite l'élève et l'ami. Il s'était converti et, nommé professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), il ne cessa plus d'oeuvrer pour une meilleure connaissance du christianisme oriental.
Anachroniques, acheté donc à Récup Auto le 6 octobre 1992, m'a alors passionné. Car c'était d'abord le livre d'un vrai poète, à l'écriture à la fois précise et imagée. Et il témoignait d'un parcours qui n'avait rien d'évident. Comment passe-t-on d'une enfance et d'une adolescence marqués par l'athéisme le plus rigoureux à l'une des religions en apparence les plus archaïques ? A l'époque, sans avoir la foi, je me posais beaucoup de questions d'ordre spirituel, et la générosité de l'approche de Clément, qui n'hésitait jamais à frotter ses convictions aux dures réalités de la modernité, me fut une vraie source de joie. Je remplissais déjà des cahiers (toujours des Clairefontaine petits carreaux) où je consignais toutes les résonances entre les diverses lectures et les petits et grands événements de ma vie. Ainsi, juste avant Olivier Clément, m'étais-je intéressé au peintre Chagall à travers une biographie de Marie-Thérèse Souverbie, un livre que j'avais dû emprunter à la bibliothèque de La Châtre, car il n'en existe aucune trace dans mes rayonnages actuels (je ne roulais pas sur l'or en 1992, et c'était donc une vraie chance, outre la bibliothèque, que de pouvoir acheter à vil prix ces livres introuvables ailleurs qu'à Recup Auto).
Mais je m'aperçois en relisant ce cahier de 1992 que cet intérêt pour Chagall avait aussi une origine bien précise. Et il me faut donc remonter au 8 août de cette année-là, où j'avais commencé la lecture du Moïse de Martin Buber. Le 12, au soir, j'avais assisté au spectacle Dialogue des carmélites, donné dans les ruines de Cluis-Dessous, d'après l'oeuvre de Georges Bernanos. Ma petite soeur y jouait, sous la direction de Liza Viet, le rôle de soeur Mathilde. J'avais alors noté avoir lu le livre dès le lendemain. Et le 13, j'avais acheté le Journal de Kafka, où j'avais tout de suite, dès la lecture des notices d'accompagnement, crû déceler des échos profonds avec l'essai de Buber. Par exemple, on y trouvait une citation de Pierre Sipriot qui se terminait ainsi : "Pour cacher sa solitude profonde dans un univers sans Dieu, sans consistance, l'homme a voulu que la voix de Dieu sorte d'une bouche humaine, il a voulu que ce qui n'existe pas existe." Ce qui résonnait fortement avec l'avant-propos écrit par Buber à Jérusalem en juin 1944 : "(...) Il [Dieu] est invisible et"se laisse voir", et il le fait dans le phénomène naturel ou dans l'événement historique où il veut se laisser voir à un moment donné. Il communique sa parole aux hommes qu'il appelle, et cela de façon telle qu'elle éclate en eux et qu'ils deviennent la "bouche" du Dieu."
Je note ensuite à la date du 4 septembre qu'il m'a fallu attendre la page 520 du Journal pour avoir confirmation de l'apparentement Moïse-Kafka, avec deux notes voisines du 18 et 19 octobre 1921 (laquelle année 1921 ne tenait qu'en quelques pages seulement) :
18 octobre : (...) Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu'elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu'on l'invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C'est là l'essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque."
Buber : "YHVH dit que, sans doute, il sera toujours là, mais chaque fois comme Celui qui sera là, de telle ou telle façon à ce moment-là. Lui qui promet sa présence constante, son assistance, se refuse à se confiner dans des formes de manifestations déterminées. Comment les hommes pourraient-ils être assez outrecuidants pour l'évoquer et lui assigner des limites ? Si la première partie de la déclaration dit : "Je n'ai pas besoin d'être évoqué, car je suis à chaque instant près de vous", la seconde partie dit aussi : "Mais d''ailleurs, il n'est pas possible de m'évoquer." Il faut avoir présent à l'esprit, comme arrière-plan de cette révélation, l'Egypte où le mage menace les dieux que, s'ils n'accomplissent pas sa volonté, non seulement il livrera leur nom aux démons, mais il leur arrachera les boucles de leur tête, comme on enlève des fleurs de lotus d'un étang. Ici, la religion n'était pratiquement guère autre chose que des règles de magie. Dans l'entretien du buisson d'épines, la religion est démagifiée." (pp. 75-76)
19 octobre : Principe du chemin dans le désert. Un homme qui fait ce chemin en qualité de chef de son organisme national, avec un reste de conscience (on ne peut concevoir plus qu'un reste) de ce qui est en train de s'accomplir. Il a durant toute sa vie le flair qu'il faut pour découvrir Chanaan ; qu'il ne doive voir la Terre promise qu'à la veille de sa mort est peu plausible. Ce dernier point de vue ne peut avoir qu'un sens, celui de montrer la vie humaine comme un instant imparfait, et combien imparfait, puisqu'une vie de cette nature pourrait durer indéfiniment sans qu'il en résulte jamais autre chose qu'un instant. Ce n'est pas parce que sa vie était trop brève que Moïse n'est pas entré en Chanaan, c'est parce que c'était une vie humaine. Cette fin des cinq livres de Moïse offre une ressemblance avec la scène finale de l'Education sentimentale."*
 |
| Edition de 1982, traduction de Marthe Robert |
Et, à la page suivante, je recopiai encore cette entrée du 28 janvier 1922 (il y a donc cent ans très exactement, à trois jours près) :
"(il y a quarante ans que j'erre au sortir de Chanaan.) [...]
"peut-être resterai-je tout de même en Chanaan", mais entre temps je suis arrivé depuis longtemps dans le désert et ces espoirs ne sont que les chimères du désespoir, surtout en des temps où, même au désert, je suis la plus misérable des créatures et où Chanaan doit nécessairement se présenter à moi comme l'unique terre d'espoir, car il n'y a pas de troisième terre pour les hommes.
Le 11 septembre, désireux d'approfondir mon approche de Kafka, j'emprunte à la bibliothèque carrément trois livres autour de l'écrivain : Franz Kafka, de R.M.Albérès et Pierre de Boisdeffre, aux Editions universitaires (1960), Les écrivains de la nuit du seul Pierre de Boisdeffre, Plon (1973) et La Conscience des mots, d'Elias Canetti, Albin Michel (1984). Ce dernier livre, recueil de textes du prix Nobel, je l'avais déjà pris en juin 1991, mais je tenais surtout à relire l'Autre Procès, où Canetti commentait les lettres de Kafka à Felice Bauer. Je notais qu'il était d'ailleurs intéressant de constater combien la compréhension de Kafka avait été renouvelée par la publication de cette correspondance, éditée en français seulement en 1972. Dans le Kafka de 1960, les auteurs ne parlent encore que de Melle F.B, et le récit de son mariage manqué n'occupe que dix pages sur les 115 qui composent l'ouvrage. Or, en 1973, ce sont vingt-deux pages qui y sont consacrées sur un total de cinquante. Autant dire que cette histoire longue de cinq années passe du rang d'épisode de la vie de Kafka à celui d'épreuve décisive pour la formation de son oeuvre et la pénétration de sa signification. Pierre de Boisdeffre (dont je découvris un peu plus tard qu'il avait une maison place du Marché - il était encore vivant à l'époque - mort en 2002, il est enterré au cimetière de La Châtre)**, reprenant par ailleurs des passages entiers de son étude antérieure, est profondément marqué - même s'il ne la cite qu'une seule fois, par acquit de conscience, dirait-on - par l'analyse tendue et précise de Canetti.
Ces lectures me permirent d'enrichir le parallèle Moïse-Kafka. En effet, une des surprises de la lecture de Martin Buber avait été de découvrir que Moïse était bègue. "Ne suis-je pas incirconcis des lèvres ?"proteste-t-il quand il est mandaté par Dieu pour porter sa parole auprès du Pharaon. "Il s'agit là d'un "état d'incirconcision", écrit Buber, qu'aucune circoncision ne peut faire cesser, d'un sentiment d'entrave qui va jusqu'au fond de l'âme et d'une impossibilité de se désentraver. Ce n'est pas seulement là une simple atteinte des organes de la parole, mais une inhibition de l'expression elle-même. Envoyé comme porteur du verbe, intermédiaire du verbe entre le ciel et la terre, Moïse ne dispose pas d'une parole qui coule spontanément. C'est ainsi qu'il a été créé et c'est comme tel qu'il a été élu. Ainsi, un mur a été dressé entre lui et le monde des hommes. Lui qui doit établir le pacte de son peuple avec YHVH, il n'est pour ainsi dire pas admis pleinement dans le pacte de sa tribu. A la fois enseignant, prophète et législateur, il reste pourtant invinciblement isolé dans la sphère de la parole. En dernière analyse, il reste seul avec la parole du ciel, qui, traversant son âme rebelle, passe dans son gosier rebelle."
"Lui qui ne peut pas pleurer, à la fin de la lecture du Verdict, il a les larmes aux yeux. La lettre du 4 décembre, immédiatement après cette lecture, est carrément stupéfiante dans sa sauvagerie : "Très Chère, j'ai un plaisir de tous les diables à lire ; gueuler dans les oreilles préparées et attentives des auditeurs fait tant de vie au pauvre coeur. Mais je les ai copieusement engueulés aussi ; et la musique qui retentissait des salles voisines et qui voulait m'ôter la peine de lire, je l'ai simplement écartée par mon souffle. Tu sais, commander aux gens, ou du moins, croire à son commandement - il n'existe pas de plus grand bien-être pour le corps." Il y a quelques années encore, il aimait rêver que, dans une grande salle pleine de gens, il lisait à haute voix en français, sans interruption, toute l'Education sentimentale de Flaubert, qu'il aimait passionnément - et cela, "à en faire vibrer les murs".Il ne s'agit pas réellement de "commander"- ici, par suite de l'exaltation où il se trouve encore, il ne s'exprime pas de manière tout à fait exacte - c'est la loi qu'il aimerait proclamer : une loi enfin assurée ; et, s'agissant de Flaubert, c'est pour lui comme la loi de Dieu, et il serait son prophète." (p. 125)
Je découvre aujourd'hui, presque trente ans plus tard, cet article de Yannick Haenel dans la revue québécoise Ecrits (n° 147, août 2016), L’instant impossible, Quand la parole défaille. Haenel commence en racontant qu'il est allé voir un soir d'octobre, à l'Opéra Bastille, Moise et Aaron de Schoenberg, mis en scène par Romeo Castellucci. La Voix du Buisson Ardent, composée avec six voix solistes, dit à Moïse: «Tu as vu les atrocités, reconnu la vérité.» Et elle lui demande d’être son prophète, de délivrer son peuple.
"Moïse ne chante pas, c’est écrit dans la Genèse : sa langue est lourde — autrement dit, il est bègue. Pour faire entendre le contraste entre la langue malhabile de Moïse inspirée par un Dieu unique et irreprésentable et le peuple livré à son besoin de croire et de voir son Dieu, Schoenberg a imaginé d’accorder au peuple le chant, mais pas à Moïse. Le peuple chante, Aaron chante, même Dieu chante, mais pas Moïse : lui, il parle. Il parle d’une manière monotone et sévère, comme si chaque mot dans sa bouche était un caillou du désert: il psalmodie. Être la bouche de la Voix du Buisson Ardent l’empêche de chanter. Être en proie à l’irreprésentable le fait bégayer, et le bégaiement ouvre dans sa bouche la voie à l’irreprésentable. Moïse est bègue parce qu’il a reçu dans sa bouche ce qui ne peut pas se dire. L’irreprésentable est ce qui affecte le langage.
Car c’est précisément parce que la parole lui manque, parce qu’il fait l’expérience de l’impossibilité de se représenter Dieu, que celui-ci l’a choisi pour être sa bouche — pour «être la bouche de l’absolu», comme dit Adorno dans son commentaire de Schoenberg. Précisément parce que la parole fait défaut à Moïse, il transmettra mieux qu’aucun autre la puissance unique, éternelle et invisible de la parole divine. L’impossibilité sera le langage même de l’irreprésentable."
Yannick Haenel écrit après les attentats terroristes du 13 novembre 2015. Pardon de le citer longuement, mais ce qui est dit là touche, me semble-t-il, à l'essentiel :
"Depuis ce soir d’octobre où j’ai vu Moïse et Aaron à l’Opéra Bastille, je pense tout le temps aux difficultés de Moïse, à ses derniers mots : « O Wort, du Wort, das mir fehlt ! » « Ô Verbe, Verbe qui me fait défaut ! ». Au lendemain des tueries du 13 novembre, j’ai commencé à lire un livre de Jacques Derrida qui s’appelle Donner la mort. [...] J’étais encore sous le coup de Moïse et Aaron, tout se mélangeait dans ma tête, le désert blanc de la parole qui manque, les flaques de sang autour du Veau d’or, les nuits blanches passées à regarder BFM-TV, à attendre sur l’écran de l’ordinateur l’arrivée des tweets de Libération et du Monde, l’impossibilité d’en parler à ma fille, trop petite pour entendre certains mots, le tourment, puis la colère politique face à l’indécence des discours et la rapacité de la domination et je pensais à Moïse: Moïse viens! me disais-je, viens nous parler de l’impossibilité, viens nous dire à quel point il est important que la parole défaille, que le verbe manque. J’écoutais l’opéra de Schoenberg au casque, la gorge nouée, et je lisais Derrida. [...] j’ai lu ce livre qui est entre autres un commentaire de Crainte et tremblement, le livre de Kierkegaard consacré au sacrifice d’Isaac par Abraham, à ce qu’on nomme, dans la tradition juive, la ligature d’Isaac : un livre dont le sujet est le moment irreprésentable de la mise à mort, l’instant impossible où le père lève le couteau vers la gorge de son fils bien-aimé parce qu’une voix, encore plus inconnue que celle qui parle à Moïse, bien plus aride — une voix du désert, impérieuse, énigmatique —, le lui a demandé.
[...] Je ne vais pas parler des attentats du 13 novembre; je préfère ne rien avoir à en dire. La défaillance est aussi une parole, je m’en remets à sa justesse. Je préfère parler de Derrida et de Kierkegaard, de la manière dont leur pensée s’est mise à nourrir la recherche qui s’était ouverte pour moi dix jours plus tôt avec l’opéra de Schoenberg — à approfondir cette séquence où des voix qu’on n’entend pas se mettent à parler et, chaque fois, demandent l’impensable. La parole qui parle en silence, qu’est-ce que c’est? Et qui sont ces solitaires, Moïse, Abraham, qui entendent cette parole?L’irreprésentable, dit Kierkegaard, c’est ce qui se passe dans la tête d’Abraham. Personne ne sait ce qu’Abraham a pensé au moment où une voix lui a demandé de sacrifier son fils et au moment où il l’a fait: non seulement, comme dit Kierkegaard, il «n’a pas laissé de lamentations», mais il n’a pas non plus parlé de son geste à qui que ce soit. Le silence d’Abraham est aussi vertigineux que le sacrifice qu’il a accompli: c’est l’objet du livre de Kierkegaard, qui en explore le labyrinthe éthique."
A la suite de Canetti, je me demandais le 11 septembre 1992 si la loi ne serait pas cette vibration qui ne pouvait naître que sur la toile de fond du silence. Ce son fondamental qu'approcherait seule, paradoxalement, une parole bégayante. Et certes, je ne sais plus trop aujourd'hui ce que je voulais signifier avec ces mots mais je m'en remettais encore à Kafka, Kafka disant encore :"La mission de l'écrivain est de mener ce qui est isolé et mortel jusqu'à la vie infinie, de transformer ce qui est hasard en ce qui est conforme à la loi." Et j'ajoutais : "Peut-on dire, avec Pierre de Boisdeffre, que Kafka, s'il n'a pas non plus reculé devant cette tâche, ne l'a pas non plus accomplie ? Peut-on affirmer, toujours avec le même, qu'il a seulement creusé "le puits de Babel" et que la seule chose définitive qu'il ait découverte, c'est la souffrance ? " (Je finissais en disant "je n'en suis pas si sûr").
Je n'ai pas plus de certitude aujourd'hui. Et puis je m'aperçois que ce retour à La Châtre s'est étiré en longueur et que je n'ai encore rien dit ou presque de Chagall et d'Olivier Clément. Et qu'il me reste encore des choses à dire autour de cet article de Yannick Haenel. Ce sera l'affaire d'un autre jour.
_________________
* Pour mémoire, voici cette fameuse scène finale :
Et ils résumèrent leur vie.
Ils l'avaient manquée tous les deux, celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ?
-- C'est peut-être le défaut de ligne droite, dit Frédéric.
-- Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte de mille choses secondaires, plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi de sentiment.
Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés.
Frédéric reprit :
-- Ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois, à Sens, quand tu voulais faire une histoire critique de la Philosophie, et moi, un grand roman moyen âge sur Nogent, dont j'avais trouvé le sujet dans Froissart : Comment messire Brokars de Fénestranges et l'évêque de Troyes assaillirent messire Eustache d'Ambrecicourt. Te rappelles-tu ?
Et, exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient :
-- Te rappelles-tu ?
Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves, un nommé Angelmarre, de Versailles, qui se taillait des sous-pieds dans de vieilles bottes, M. Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de dessin linéaire et de grand dessin, Varaud et Suriret, toujours en dispute, et le Polonais, le compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire, -- puis une terrible ribote en promenade, leurs premières pipes fumées, les distributions des prix, la joie des vacances.
C'était pendant celles de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque.
On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turc ; et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement, situé au bord de l'eau, derrière le rempart ; même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poissons rouges, près d'un pot de réséda, sur une fenêtre. Des demoiselles, en camisole blanche, avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles, frappaient aux carreaux quand on passait, et, le soir, sur le pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque.
Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases : " L'endroit que vous savez, -- une certaine rue, -- au bas des Ponts. " Les fermières des alentours en tremblaient pour leurs maris, les bourgeoises le redoutaient pour leurs bonnes, parce que la cuisinière de M. le sous-préfet y avait été surprise ; et c'était, bien entendu, l'obsession secrète de tous les adolescents.
Or, un dimanche, pendant qu'on était aux Vêpres, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de Mme Moreau, puis sortirent par la porte des champs, et, après un grand détour dans les vignes, revinrent par la Pêcherie et se glissèrent chez la Turque, en tenant toujours leurs gros bouquets.
Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords, et jusqu'au plaisir de voir, d'un seul coup d'oeil, tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement, qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras ; croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit ; et, comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre.
On les vit sortir. Cela fit une histoire, qui n'était pas oubliée trois ans après.
Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre ; et, quand ils eurent fini :
-- C'est là ce que nous avons eu de meilleur ! dit Frédéric.
-- Oui, peut-être bien ? C'est là ce que nous avons eu de meilleur !, dit Deslauriers.
** Son nom complet est Pierre Jules Marie Raoul Néraud Le Mouton de Boisdeffre. Son trisaïeul paternel, le botaniste Jules Néraud, fut un ami de George Sand. Il est curieux de penser qu'à cent mètres à peine de chez Boisdeffre habitaient rue Notre-Dame Fred Deux et Cécile Reims. Quoi de commun entre le grand bourgeois, diplomate et "homme de lettres", et le fils de prolo et la petite Juive ? Je doute qu'ils se soient rencontrés, rien ne l'indique en tout cas, et jamais il ne fut question de Boisdeffre dans nos conversations. Peut-être se sont-ils croisés au hasard des rues et des promenades, sans savoir même ce qu'ils étaient les uns et les autres.
Bertrand Poirot-Delpech, qui rédigea sa nécrologie dans Le Monde, le 25 mai 2002, écrit à son sujet :
"Gaulliste, catholique, posément centre droit, il s'est ingénié à irriter tour à tour les familles dont il se sentait proche. Ses écrits sur Tolstoï, Goethe, Gide, Kafka, Barrès, Jouhandeau, Malraux, se ressentent de sa passion d'adolescent pour la littérature d'avant-guerre, dont il regrettait que ses thèmes nocturnes aient été démodés par les nihilismes du nouveau roman et de l'absurde théâtral, stigmatisés dans un pamphlet parodique, La cafetière est sur la table.
La critique spiritualiste des années 1960 lui savait gré de cet attachement aux valeurs anciennes, de ses indulgences pour Brasillach ou Mgr Lefebvre, mais pas au point de l'accueillir dans les hauts lieux de la conformité. Même dans les journaux bien pensants, il peinait parfois à y placer sa copie. Trop jaloux de sa liberté pour connaître les reconnaissances dont il avait rêvé, Pierre de Boisdeffre était aussi trop rangé pour atteindre à la singularité d'autres fous de livres plus marginaux comme Roger Stéphane ou Jacques Brenner, à côté de qui on le rangera sans doute. Mauriac, dont il aurait aimé connaître la réputation de soufre tempéré, voyait, dans sa rondeur et sa voix perchée, les traits d'un "chanoine des Lettres". C'était dit avec une moquerie affectueuse que les collégiens du milieu n'ont cessé de lui témoigner."