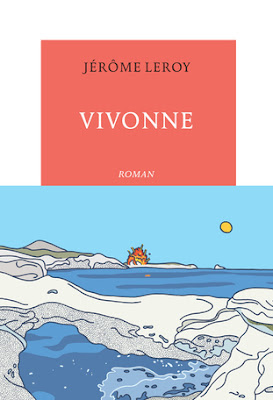Avant de revenir sur le Matthieu de Denis Guénoun, je te propose, ô patient lecteur, une petite bifurcation avec le couple Leroy/Tarkovski. Lundi dernier, j'ai en effet terminé la lecture de Vivonne, le dernier roman de Jérôme Leroy, publié à la Table ronde, et vu, le soir-même, pour la seconde fois de ma vie, le chef d’œuvre d'Andreï Tarkovski, Andreï Roublev. Entre les deux se fomentèrent aussitôt des échos si puissants que le désir d'en établir une chronique s'imposa très vite. Et j'ai l'intuition qu'une seule n'y suffira pas.
A ma droite, donc, Jérôme Leroy, plusieurs fois rencontré dans ces pages, avec ce nouveau roman, Vivonne, qui fait sauter la barrière des genres : thriller, fantastique, anticipation s'y mêlent savamment avec un autre élément littéraire peu familier de ces domaines : la poésie. L'action se déroule principalement en 2028, ce qui autorise à parler de dystopie légère, à l'instar des Furtifs d'Alain Damasio, qui consiste en somme à extrapoler certaines tendances contemporaines, mais les retours en arrière sont aussi très nombreux, sans compter le prologue et l'épilogue, qui encadrent le récit principal en nous transportant dans une temporalité plus éloignée. C'est dire si l'on a affaire à une construction complexe.
J'ai lu depuis lundi pas mal de critiques et d'avis sur Vivonne, mais je n'ai pas vu pour l'instant d'interrogation sur le pourquoi de ce titre, qui reprend le patronyme du personnage principal, le poète Adrien Vivonne, dont Leroy s'amuse à clore le roman par la bibliographie exhaustive. Il lui prête aussi nombre de ses traits, en le faisant naître par exemple à Rouen le 13 septembre 1964, tandis que lui-même est mis au monde dans la même ville le 29 août 1964. Un décalage de quinze jours qui les place néanmoins dans une certaine gémellité astrologique, placés qu'ils sont tous les deux sous le signe de la Vierge. Le livre tout entier se présente comme une quête de ce personnage, disparu mystérieusement en 2008, sur fond de décomposition de la société, en proie à une "balkanisation climatique" (mais le livre parle aussi de Libanisation) qui voit s'affronter les milices de différents clans, tandis que se profile la menace d'un Stroke, la Panne générale d'internet et de toute communication numérique (qui reprend en quelque sorte le concept d'accident intégral de Paul Virilio*).
Mais revenons sur ce nom de Vivonne, évidemment emprunté à Marcel Proust qui rebaptise ainsi le Loir qui coule à Illiers-Combray, associé à un souvenir d'enfance évoqué dans Du côté de chez Swann :
« Je m’amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre les petits poissons, et qui, remplies par la rivière, où elles sont à leur tour encloses, à la fois « contenant » aux flancs transparents comme une eau durcie, et « contenu » plongé dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, évoquaient l’image de la fraîcheur d’une façon plus délicieuse et plus irritante qu’elles n’eussent fait sur une table servie, en ne la montrant qu’en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l’eau sans consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne pourrait en jouir. Je me promettais de venir là plus tard avec des lignes ; j’obtenais qu’on tirât un peu de pain des provisions du goûter ; j’en jetais dans la Vivonne des boulettes qui semblaient suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation, car l’eau se solidifiait aussitôt autour d’elles en grappes ovoïdes de têtards inanitiés qu’elle tenait sans doute jusque-là en dissolution, invisibles, tout près d’être en voie de cristallisation."
On peut suivre François Bon qui, en 2013, vient sur les lieux retrouver la Vivonne :
"D’abord, ci-dessus, la bande-son au Pré-Catelan d’Illiers-Combray : trois pas plus loin que le marché du vendredi sur la place de l’Église et les bruits de la route, probablement peu de différence avec ce que Marcel Proust entendait, les trois étés où il est venu à Combray, entre ses 8 et ses 11 ans.
Il y a bien les deux directions pour suivre le petit cours d’eau tranquille, entre gués et nénuphars, que Proust nomme dans son livre la Vivonne – nom pour moi associé à Poitiers où elle coule toujours. [...]
On porte chacun une Vivonne intérieure, qu’on a reconstruit comme Proust lui-même à partir de nos souvenirs d’enfance, il importe de ne pas la dissoudre au profit de la beauté ici d’une allée couverte, d’un reflet du vieux lavoir, ou de cette échappée de route qui s’envole en tournant."Alexandre Garnier, l'ami et éditeur de Vivonne, tentant de reconstituer sa biographie, raconte l'accouchement aquatique à la clinique Semmelweiss de Rouen :
"Si je me permets cette supposition d'un lien de cause à effet entre cet accouchement et la joie d'Adrien Vivonne, c'est que décidément, à lire son œuvre, l'eau joue un rôle fondamental, originel. L'eau est l'élément bienfaiteur : celle qu'on boit et celle où on se baigne, mers, rivières, lacs. Adrien Vivonne n'était pas sportif mais il était, d'après tous les témoignages, un excellent nageur." (p. 81)Il est temps, maintenant, d'en venir à ma gauche, autrement dit à Andreï Roublev, ce film tourné en 1966 mais que le monde ne verra qu'en 1969, au festival de Cannes, avant même le public soviétique, qui n'y aura droit qu'en 1971 (il faut dire que Brejnev, qui eut le privilège d'un visionnage exclusif, ne s'y trompa pas : malgré le fait que l'histoire se passe au XVème siècle et ne comporte pas de critique explicite du régime, il en perçut tout de même le fond contestataire et quitta ostensiblement la salle). Nous avons, ma fille Violette et moi, décidé de regarder tous les films de Tarkovski, dans l'ordre de leur sortie. Après L'enfance d'Ivan la semaine dernière, c'était donc le tour d'Andreï Roublev. Eh bien que voit-on dès le prologue (et je ne m'avise qu'à l'instant que le film et le roman sont construits identiquement avec un prologue et un épilogue), sinon un fleuve, sur le fond duquel se détache cet homme nommé Yefim qui prépare un ballon à air chaud près d'un petit village, un prototype rudimentaire de montgolfière, et parvient à s’envoler, avant d’atterrir en catastrophe sur la rive.
Le motif du fleuve revient plusieurs fois dans le film. Sur le forum dvdtoile, un commentateur, Vincentp, tient les propos suivants :
"Tarkovski place sa caméra à une hauteur de deux mètres environ et filme ses personnages en légère contre-plongée, selon la position du christ orthodoxe, dixit le documentariste Chris Marker.Des mouvements de caméras spectaculaires permettent d’accroître considérablement cette hauteur et d'observer la société russe du XV° siècle dans un plan d'ensemble. Le film s'ouvre (par le vol en ballons) et se conclut (par la fonte de la cloche) par une représentation d'un collectif composé d'anonymes. Est porté à notre regard un monde qui se situe à la frontière de la ruralité et de la petite cité organisée autour de son lieu de culte orthodoxe. Le fleuve, et la boue qui le sépare du rivage, réalisent la transition entre ces deux mondes. Aux portes de la cité existe une nature omni-présente, immense, boueuse, déifiée par les moujiks. L'air y circule de façon paisible (chute de flocons) ou tumultueuse (bruit des moustiques dans la steppe)." [C'est moi qui souligne]
Jean Douchet, dans une causerie à l'Institut Lumière sur le film, montre bien, à l'avenant, que la terre, et surtout la terre humide, est un élément essentiel dans la symbolique déployée par Tarkovski.
Pour donner un autre exemple de parallèle entre Vivonne et Roublev, je vais choisir un autre passage, situé cette fois à la fin du livre, dans l'épilogue :
" Adamas avait été bombardé par les bateaux des Autres.
Aucun bâtiment ne semblait épargné. Les tavernes où aimaient traîner Titos étaient dévastées. Et on voyait des corps, toujours des corps. La Douceur ne l'avait pas préparé, ni lui, ni personne, à cette vision de la mort de masse. Une mort qui surprend dans des positions grotesques, une mort qui abîme les chairs, qui défigure.
Dans la Douceur, quand un Ami passait de l'Autre Côté, il était entouré des siens. Les proches récitaient des poèmes d'Adrien, des chants du Grand Aveugle. Parfois, celui qui pressentait sa mort proche choisissait de partir vers le large, face au soleil : on le perdait de vue depuis la rive, il devenait écume, rayon de soleil ou poisson aux écailles scintillantes et entrait dans l'Alliance du Vivant." (p. 402)
Cette cruauté, ce chaos sont aussi au coeur de Roublev, avec l'invasion tatare qui conduit au sac de la ville de Vladimir et au massacre de ses habitants, un épisode qui conduit Andreï à cesser de peindre et à faire vœu de silence. Dans le tableau de la fête (1408), au premier tiers du film, où il avait découvert des paysans dans leur rituel païen, dansant nus sur le bord du fleuve, il avait été attaché par un groupe d'hommes qui l'avaient menacé de noyade. Une femme, Marfa, l'avait libéré après l'avoir embrassé.Le lendemain, alors qu'il a rejoint ses compagnons et descend le fleuve en barque, des soldats arrivent et violentent les païens. Andreï détourne le regard devant Marfa qui s'enfuit en nageant, s'éloignant sans retour.
Comme je le pressentais, cette exploration des rapports entre les deux œuvres ne fait que commencer.
_____________________
* C'est aussi en 2008 que Virilio confiait dans un entretien au Monde, que le krach boursier représentait l'accident intégral par excellence. L'article finissait par ces lignes :
"Vous croyez au chaos ?
Après avoir déstabilisé le système financier, le krach risque de déstabiliser l'Etat, dernier garant d'une vie collective. Il essaie en ce moment de rassurer. Mais si la Bourse continue de baisser, c'est l'Etat qui sera à son tour en faillite, et va plonger les nations dans le chaos. Ce n'est pas du catastrophisme de ma part. Je ne crois pas au pire, je ne crois pas au chaos, c'est absurde, c'est de l'arrogance intellectuelle, mais il ne faut pas s'empêcher d'y penser. Face à la peur absolue, j'oppose l'espérance absolue. Churchill disait que l'optimiste est quelqu'un qui voit une chance derrière chaque calamité."
Le chaos, engendré par un État dépassé par les événements, est au cœur du roman de Jérôme Leroy.