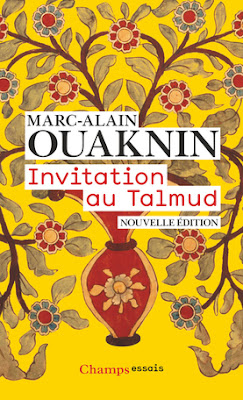"D’un côté, les traces peintes de ces mains millénaires, orientées selon un axe vertical, qui ornent la grotte de Gargas ; de l’autre, l’extension progressive d’un monde horizontal avec cette carte, Cosmographiae introductio, où est dessiné pour la première fois le continent américain, puis celle, rapprochée des toiles de Jackson Pollock, qui figure l’ensemble des trajets des bus Greyhound et où se résume la vocation de cette même Amérique à installer et imposer mieux que tout autre un mode de rapport géographique au monde."
 |
| Mains négatives de Gargas réalisées au pochoir, dont certaines avec doigts tronqués (Wikipedia) |
Et bien sûr, cela me renvoyait immédiatement à la forte description d'Henri Van Lier : "L'angle droit, qui réfère entre eux les trois
plans et les trois dimensions selon lesquelles le corps
redressé d'Homo distribue son environnement, a envahi ses
articulations. Il a plié orthogonalement deux à deux
phalangettes et phalangines, phalangines et phalanges, et
ainsi de suite de main en poignet, en coude [...] Les bras levés, cette menace des
Primates qu'Homo transforma en supplication au ciel,
confirment la fécondité anthropogénique des angles. Rien
d'étonnant que ce corps orthogonalisant se soit mis un jour à
précadrer ses images au paléolithique supérieur, et à cadrer
(quadrare, carrer) ses images et tout son milieu au
néolithique." Mais aussi - et c'était encore plus surprenant - à ce livre de Georges Perec acheté quelques jours plus tôt, What a man !, dans une nouvelle édition revue et augmentée au Castor Astral, et commencé ce même 8 octobre.
On me dira : mais quel rapport avec les mains de la grotte de Gargas ? Eh bien, What a man ! est un court texte oulipien que l'on nomme un monovocalisme en A. Aucune autre voyelle n'y apparaît (pour le lire en intégralité, voir ce site). Voici à titre d'exemple le premier paragraphe :
Smart à falzar d’alpaga nacarat, frac à rabats, brassard à la Frans Hals, chapka d’astrakhan à glands à la Cranach, bas blancs, gants blancs, grand crachat d’apparat à strass, raglan afghan à falbalas, Andras MacAdam, mâchant d’agaçants Partagás, ayant à dada l’art d’Alan Ladd, cavala dans la pampa.A la fin du texte, Perec signe - histoire de respecter la contrainte jusqu'au bout : Gargas Parac.
Gargas, comme les grottes du même nom.
La lecture de l'article de Diacritik ne fait que renforcer mon intérêt :
"Toute la force du livre tient dans cette capacité à créer des liens et des échos entre tous ces éléments mais aussi à les faire entrer en dialogue avec toute une série de récits bibliques ou mythologiques que le narrateur reprend à son compte en les résumant et les reformulant : récit du Déluge, histoires d’Hercule et de Cacus, d’Isaac et de Jacob, songe de Nabuchodonosor, légendes de Saint Christophe ou des sept dormants d’Ephèse."Je commande l'ouvrage très peu de temps après. Je compte entamer très bientôt sa lecture.
En attendant, de livres, je ne manquais pas. J'en avais dernièrement acheté plus que je ne pouvais décemment en lire. Mieux, déraisonnablement, un passage à la médiathèque que j'eusse dû éviter m'avait précipité sur le dernier récit d'Olivier Rolin, Extérieur monde. Une impulsion irrésistible, qui provient du fait que l'écrivain a été la matière de plusieurs articles, le dernier en date étant celui du 14 novembre 2017, # 272/313 - Enorme poupée de ténèbres, où j'évoquais Tigre en papier :
Du Rolin au Belin. Le lendemain, je devais baigner encore dans les effluves de ce canular Nanar, car au concert de Bertrand Belin aux Bains-Douches de Lignières, je trouvais que le chanteur faisait un sort tout particulier à cette voyelle A. J'en veux pour preuve la chanson Camarade :
* La quatrième de couverture, rédigée par Rolin lui-même, me réjouissait d'emblée avec ce vertigineux, placé en seconde position dans la phrase :
** Pierre Dac, magnifique humoriste, et il ne faut pas l'oublier, figure de la Résistance. Le A ne manque pas dans sa biographie : "André Isaac dit Pierre Dac, né le 15 août 1893 au 70 rue de la Marne à Châlons-sur-Marne (Marne) actuellement Châlons-en-Champagne, et mort le 9 février 1975 à Paris." Il avait formé avec Francis Blanche un duo auquel on doit de nombreux sketches dont le fameux Le Sâr Rabindranath Duval (1957), où le A se taille encore la part du lion.
"Le livre est puissant, mais je n'en aurais peut-être rien consigné si plusieurs échos aux thèmes étudiés ici ne s'étaient manifestés. Le premier écho fut une évocation de Che Guevara, dans la revue puis dans Tigre en papier, alors même que j'avais prévu d'insérer dans l'épisode du 8 octobre de ma Fiction-1967 une allusion à la capture ce jour-là du guérillero égaré en Bolivie :
"Le Che n'était pas un écrivain, d'accord, mais tout de même la dernière phrase de son carnet, "nous sommes partis à dix-sept sous une lune très petite", c'était aussi parfaitement beau que la dernière phrase de Rimbaud,"dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord", non ?"
Je découvre en rédigeant ce billet-ci cette récurrence du 8 octobre. L'épisode de ma fiction 1967 - qui fait écho au 8 octobre 1967 - a été publié le 8 octobre 2017.
Bref, délaissant pratiquement les autres lectures engagées, je me lance dans le récit rolinien*, et, page 21, je lis ceci : "Il y avait aussi, chez un vieux couple tatar à Astrakhan, accrochée au mur à côté de versets coraniques (...)" Tatar à Astrakhan, je songe aussitôt au What a man ! de Perec, à la "chapka d’astrakhan à glands à la Cranach". C'est un petit fragment monovocaliste qu'insère ici Rolin, et je me demande s'il l'a fait exprès ou si c'est totalement fortuit. Et mes doutes redoublent quand il est question quelques lignes plus loin d'une ébouriffante Kazhake dans le delta de la Volga.
Or, il se trouve qu'à la fin de ce chapitre, sept pages plus loin, Rolin écrit : "J'étais plus petit encore, j'avais six ans, et j'aurais pu ce jour-là rencontrer non seulement un rorqual de vingt mètres, mais Georges Perec, parce qu'il me semble qu'il y a dans Je me souviens un "Je me souviens de Nanar le goujon géant", mais je n'en suis pas sûr." Et moi non plus je ne suis pas sûr malgré tout que Rolin ait sciemment voulu décalquer la contrainte perecquienne, mais sa présence ici (et Perec reviendra à plusieurs reprises dans le livre) atteste de son affection pour cet écrivain qu'il juge "magnifique". Qui sait si le monovocalisme en A ne joue pas inconsciemment chez Rolin ? En tout cas, il nous apprend in fine que Nanar le goujon géant était un "stand gag installé à côté par Pierre Dac et Eddie Barclay" (dans ce morceau de phrase, on peut encore noter le nombre très important de a). Cela, il l'a appris sur Internet, il ne cite pas sa source, mais j'en ai retrouvé plusieurs :
"En 1955, des farceurs scandinaves installèrent sur l'esplanade des Invalides une gigantesque baraque. A l'intérieur, ils y avaient installé une baleine naturalisée, qu'ils avaient baptisée "Jonas". Affiches, cartons d'invitation, publicité, tout était réuni pour que Jonas devint une attraction vedette. Et les Parisiens affluèrent pour admirer l'animal. Déçus par Jonas, trois farceurs parisiens, dont celui qui sera célèbre plus tard sous le nom d'Eddie Barclay, installèrent une seconde baraque à quelques mètres de Jonas. Là, ils exhibèrent "Nanar". Goujon français, lui réellement géant, puisque long de 76 centimètres, ce qui constitue à n'en pas douter un record mondial pour ce cyprinidé d'eau douce. Grâce à l'intarissable verve de Pierre Dac, Nanar eut bientôt plus de succès que Jonas."
| Le Confédéré, 5 octobre 1953 |
Du Rolin au Belin. Le lendemain, je devais baigner encore dans les effluves de ce canular Nanar, car au concert de Bertrand Belin aux Bains-Douches de Lignières, je trouvais que le chanteur faisait un sort tout particulier à cette voyelle A. J'en veux pour preuve la chanson Camarade :
On n'est pas bien sûr obligés de me suivre jusque-là. Après tout, comme disait Pierre Dac**, "Parler
pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes
majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant
de l'ouvrir."
___________________________
___________________________
* La quatrième de couverture, rédigée par Rolin lui-même, me réjouissait d'emblée avec ce vertigineux, placé en seconde position dans la phrase :
«Bigarré, vertigineux, toujours surprenant, tel demeure le monde aux yeux de qui en est curieux : pas mondialisé, en dépit de tout. Venu du profond de l’enfance, le désir de le voir me tient toujours, écrire naît de là. Chacun des noms qui constellent les cartes m’adresse une invitation personnelle. Ce livre est un voyage à travers mes voyages. Digressions, zigzags, la mémoire vagabonde. Visages, voix, paysages composent un atlas subjectif, désordonné, passionné. Le tragique, guerres, catastrophes, voisine avec des anecdotes minuscules. Des femmes passent, des lectures. Si j’apparais au fil de cette géographie rêveuse, c’est parce que l’usage du monde ne cesse de me former, que ma vie est tressée de toutes celles que j’ai rencontrées.»
** Pierre Dac, magnifique humoriste, et il ne faut pas l'oublier, figure de la Résistance. Le A ne manque pas dans sa biographie : "André Isaac dit Pierre Dac, né le 15 août 1893 au 70 rue de la Marne à Châlons-sur-Marne (Marne) actuellement Châlons-en-Champagne, et mort le 9 février 1975 à Paris." Il avait formé avec Francis Blanche un duo auquel on doit de nombreux sketches dont le fameux Le Sâr Rabindranath Duval (1957), où le A se taille encore la part du lion.