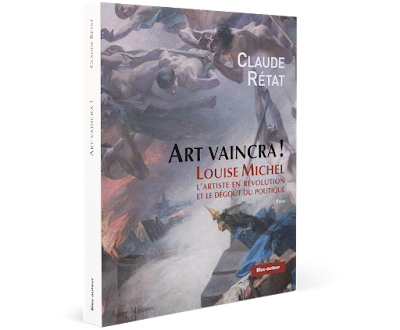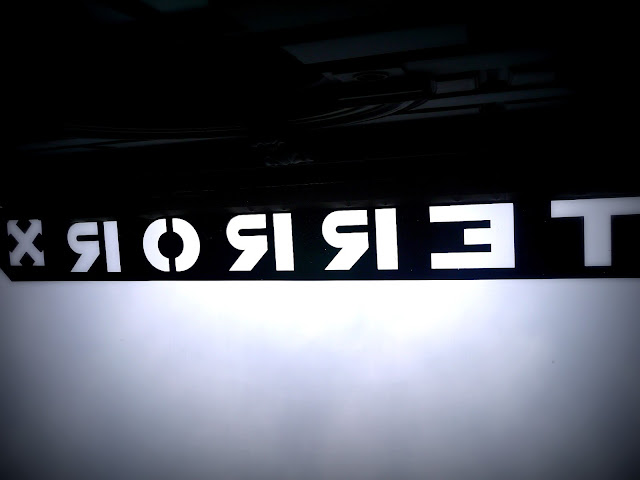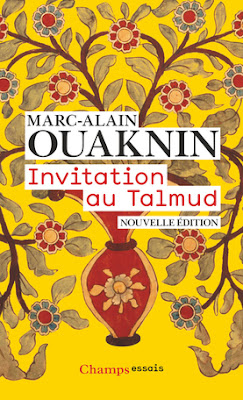J'enchaîne avec l'essai de Claude Rétat, directrice de recherches au CNRS, Art vaincra ! Louise Michel, l'artiste en révolution et le dégoût du politique, ouvrage de la petite maison d'édition Bleu autour, sise à Saint-Pourçain sur Sioule, dans l'Allier, et dont je ne manque jamais de visiter le stand aux Rendez-vous de l'Histoire à Blois (où Claude Rétat avait même donné une conférence à laquelle je n'avais pu assister) . J'avais choisi ce livre car il présente une facette largement ignorée de la célèbre communarde (1830 -1905), son oeuvre de romancière, musicienne et poète.
Le volume était resté dans la pile toujours plus importante des livres en attente. Aucune urgence apparente et pourtant c'est lui que je suis venu chercher dimanche soir après avoir lu un nouveau chapitre du Tango de Satan de László Krasznahorkai (roman puissant, mais dur et exigeant, que je ne puis lire que lentement) - j'éprouvais le besoin d'une échappée, d'un saut hors de la boue hongroise. Mais pourquoi Louise Michel ? Je n'en sais rien, je n'obéissais là qu'à une sorte d'instinct, c'était celui-là et pas un autre, ou bien est-ce l'Attracteur étrange qui me dictait mon choix ? Hypothèse à considérer avec attention car, en y revenant donc hier, je m'avisai que je n'avais pas noté alors sur mon cahier vert une coïncidence pourtant singulière.
Dans le premier chapitre, intitulé Le microbe, Claude Rétat cite ce passage d'une interview de Louise Michel dans Le Temps du 6 décembre 1895 : "L'esprit révolutionnaire se communique par un travail obscur et qu'on ne peut suivre. C'est peut-être un microbe." Elle développe ensuite cette affirmation :
Il me souvint alors que quelques heures plus tôt, en visite chez mes parents à Aigurande, en pause entre deux parties de belote, j'avais changé de chaîne sur la télévision du salon qui tournait comme souvent à vide, personne ne regardant plus le biathlon de la Chaîne 21. J'avais mis Arte et tombé au milieu d'un reportage sur les entrailles du sol, où de bien curieuses créatures subsistaient dans les grottes. Je n'avais pas suivi le documentaire jusqu'à son terme, juste quelques minutes, mais il me semblait qu'il s'agissait bien de ces fameux protées dont parlait Louise Michel. Je vérifiai en me rendant sur le site d'Arte.tv et revisionnait l'émission : il s'agissait bien du protée, Proteus anguinus, amphibien appartenant au même ordre que les tritons et les salamandres, qui intrigue furieusement les"Louise Michel est pire, ou mieux, que myope : elle est aveugle, reconnaissant l'obscur et, du même mouvement, revendiquant l'art, avec un certitude de toucher, de déclencher, sans savoir exactement où, quand, quoi et comment. L'heure de la révolution est, chez elle, la grande inconnue, imprédictible, imprévisible : en images, elle se représente comme l'instant où tout le travail de sape, longtemps invisible, bascule en effondrement.Aveugle, elle l'est de par l'objet même de sa vision, le monde futur, celui qui doit suivre la Révolution. A ceux qui "craignent l'inconnu", "nient la lumière de demain" ou "veulent qu'on leur précise ce qui sera dans cette lumière", elle répond qu'on ne peut "demander aux protées aveugles des lacs souterrains de se rendre compte du jour que verront leurs descendants jetés hors des cavernes par les cataclysmes." [C'est moi qui souligne]
scientifiques car il est capable de jeûner 48 mois tandis que sa longévité peut atteindre 80 à 100 ans.
D'autres résonances apparurent alors : tout d'abord dans le texte de Michel Quint, qui avertissait : "Ne négligeons pas Wattrelos où j'ai habité entre 55 et 67 en tant que ville frontalière." et qui précisait ceci : "Wattrelos comportait encore, dans les années cinquante et soixante, des zones vertes, emblavées, sur ces lisières belges, avec des mares à tritons et salamandres."
Et ce n'est pas la seule. Le second chapitre de l'essai de Claude Rétat se nomme Germinal. Un rapport de la préfecture de police daté du 17 février 1886 note que dans une réunion publique organisée par des groupes anarchistes, Louise Michel a soutenu Zola et vanté Germinal "parce que cet écrivain avait exposé des idées anarchistes dans son oeuvre". Dans un poème de jeunesse écrit vers 1850, en un temps où elle était atteinte, dirait-elle plus tard, de "rougeole religieuse", on peut lire :
Versez, grands cieux ardents, versez votre rosée.
Des souffles ennemis la terre reposée
A germé le Sauveur. (...)
Claude Rétat explique qu'il s'agit là d'un décalque du latin liturgique, d'une paraphrase d'un texte chanté au premier dimanche de l'Avent, dès la première page du missel : "Rorate, coeli, desuper et nubes pluant justum - Aperiatur terra, et germinet salavtorem" - Cieux, versez votre rosée, et que les nues pleuvent le juste. Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le sauveur."
"La terre a germé le sauveur" traduit "germinet salvatorem". "En latin, précise Retat, le verbe germinare est transitif (et signifie produire, faire germer), en français "germer" est en revanche intransitif. En utilisant transitivement le verbe français, Louise Michel fait donc un latinisme." Que l'on retrouve bien plus tard, en 1891, dans son roman La Chasse aux loups, "qui met en scène l'apothéose d'une Commune future : "Un bourdonnement énorme emplissait l'univers, germant la liberté."(page 203). Puis, page 222 :
Sur l'immense hécatombe, vingt ans ensevelis, fleurissait la vengeance et l'on entendit parler le spectre de mai.*"Le lecteur, poursuit Claude Rétat, reconnaît le "germinet" latin (métamorphosé, sans le sauveur désormais), et mieux encore. Ces volcans en éruption, cette révolution géologique mêlée à la révolution sociale ne crachent pas seulement leur lave, ils recrachent aussi, retravaillé, transformé, converti, le texte latin d'origine. "Que la terre s'ouvre" est devenu : "Quelque chose d'une révolution géologique"... C'est bien l'avent du missel, devenu séisme et tremblement de terre : Louise Michel arrange la nativité au bénéfice de la Révolution." (p. 53)
L'Europe entière était debout.
Il semblait que les peuples se rapprochassent comme des hommes, se serrant les mains par-dessus les frontières.
La Russie [...] se démantelait.
L'Italie, l'Espagne rejetaient, comme un volcan sa lave, les institutions pourries ou vermoulues.
Quelque chose d'une révolution géologique se mêlait à l'époque - l'humanité germait des sens nouveaux.
Vertigineuse germination : ne venais-je pas de la lire quelques minutes plus tôt, encore une fois, dans les mots de Michel Quint ?
"Ma mère, née à Leforest comme moi, retrouvait une sorte de parfum de pays natal sur la lessive qu'elle suspendait : la suie crachée par les hautes cheminées de Roubaix laissait des traces sur le linge propre. Ce n'est pourtant et surtout pas une région à regrets, à nostalgie, c'est une région à cicatrices refermées, nettoyées, prête à d'autres moissons, comme un jardin, un potager, un verger neufs après de tristes récoltes, des abandons, où tout ce qui a disparu, s'est éteint, a laissé des graines, de la germination en train. Germinal toujours recommencé. Un jardin de mémoire, fertile." [C'est moi qui souligne]
Les protées, Germinal, c'était étonnant (me lasserais-je un jour de ces échos étourdissants ?), mais ce n'était pas encore fini. Il devait me rester encore un peu d'énergie à dissiper dans la lecture car je me tournais pour finir vers un de mes livres de chevet, le Cambouis du poète Antoine Emaz. D'un autre recueil de notes, Planche, j'avais extrait l'autre jour des passages pour ma petite soeur qui lutte contre la maladie, et c'était aussi en pensant à elle que je l'ouvris comme d'habitude, au hasard. Mais ce hasard suivait les pentes creusées par l'Attracteur étrange car voici que je lus :
L'universel reportage... Je venais juste de lire cette expression page 40 de l'essai de Claude Rétat :"Ne pas se substituer à l'historien ou au journaliste. Mais on n'est pas non plus hors temps.Sur ce point, je déteste le chiffon rouge de l'"universel reportage", agité au nom de Mallarmé par ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une articulation poésie/social, poésie/politique, poésie/engagement..." (p. 42)
"La préface que Mallarmé écrit au Traité du verbe de Ghil, en 1885, oppose à la "fonction de numéraire facile et représentatif" du langage (ce parler "commercial" de "l'universel reportage", qu'il répudiera à nouveau dans Crise de vers) le "Dire" du poète, "rêve et chant", pointe "d'un art consacré aux fictions".
Et comment ne pas frémir en parcourant les lignes qui suivaient immédiatement, alors que j'écris à quelques heures de cette grève qui s'annonce massive, en ce 5 décembre maintenant advenu :
"Il serait absurde de replier mécaniquement l'univers de Mallarmé sur celui de Louise Michel : tel n'est pas l'objet. Mais il serait absurde aussi d'isoler a priori chaque auteur comme une monade. Ainsi, du côté de Louise Michel, dire une grève, c'est bien dire une absente et la radicalité d'une absence. Car cela revient pour elle à évoquer l'inconnu futur, le ce-qui-n'est-pas-encore, le point même de la rupture radicale, et pour cela un absolu de la grève auquel aucune des grèves réelles ne satisfait. Grève-rêve : les deux mots marchent de pair sous sa plume, et délibérément. " Le rêve c'est la réalité", écrivait-elle dans un fragment de jeunesse. "Le rêve c'est la vie", dit-elle toujours dans les années 1890. Le gréviste et celui qu'elle appelle le "chasseur d'étoiles" sont le même homme." [C'est moi qui souligne]
__________________________
* C'est-à-dire de mai 1871, la Semaine sanglante qui mit fin à la Commune (note de Claue Rétat).