Je me suis cependant accroché, et cette fois je suis allé au bout, non sans mal, et sans assurance d'en avoir compris tout le propos. Les visites de Budapest, ville d'une beauté parfois sidérante, divisée par ce majestueux Danube que je voyais pour la première fois, me donnèrent envie d'explorer plus avant la littérature de ce petit pays à la langue aussi opaque que la plupart des visages de ses habitants (combien rare y est le sourire, c'est ce qui ne cessera de m'étonner). Et dans mes rêves commencèrent à apparaître des noms d'écrivains, cités par Kertész ou me remontant en mémoire, oui des noms plus que des images, et je me mis en quête, non le mot est trop fort, disons que j'étais prêt à saisir l'occasion d'en savoir plus si elle se présentait.
Nous croisâmes donc des librairies, grandes, avec des étages, mais quasiment désertes. L'une, pas très loin de l'appartement réservé, offrait un café fort agréable. J'en profitai pour faire un tour du propriétaire. A part quelques ouvrages touristiques, aucun livre en français, alors même que les livres en anglais avaient droit à quelques rayonnages. J'ai cru un instant avoir vu un livre sur Perec, mais il ne s'agissait pas de Georges mais d'un bouquin de cuisine - le bretzel se disant perec dans la langue magyare.
Le troisième jour, visitant le quartier juif d'Erzsébetváros, la pluie un tantinet battante nous fit nous réfugier dans un très beau café littéraire (petite précision liminaire, parler de quartier juif est un peu usurpé car ce quartier ne tire pas son nom du fait qu’y était regroupé l’ensemble de la communauté juive, mais parce que c’était l’ancien ghetto de Budapest pendant la 2ème Guerre Mondiale, à partir de 1944. Ce sont les nazis hongrois, les Croix fléchées, qui cantonnèrent 70 000 Juifs de Budapest dans un minuscule périmètre, organisèrent eux-mêmes les déportations vers Auschwitz et procédèrent à de nombreuses exécutions sommaires le long du Danube. Une des plus sombres pages de l'histoire hongroise).
Dans ce beau café paisible, où les tables s'étageaient en amphithéâtre, avec de pleins rayonnages de livres, un Français avait droit aux plus hautes positions : Szerotonin de Michel Houellebecq trônait au-dessus de tout le monde. Comme autre auteur français, je n'ai guère vu qu'Anna Gavalda (mais je n'ai pas fait d'enquête fouillée et exhaustive). Ceci dit, malgré pléthore de livres, une seule personne en lisait un, un livre, un vrai, tous les autres (et nous-mêmes aussi, il faut se mettre dans le lot) surfions sur les smartphones et les ordinateurs.
Je demandai à la jeune serveuse, dans mon anglais trébuchant, si la maison n'avait point par hasard quelques ouvrages dans la langue de Molière (non, je n'ai pas dit ça comme ça, pas parlé de Molière vous pensez bien). Non, dans le café il n'y en avait pas, mais je pouvais aller voir à la librairie, juste à côté. Eh oui, un long corridor vous faisait passer dans un autre vaste magasin à livres, où, comme d'habitude je ne vis aucun client. Juste une ou deux employées presque surprises, aurait-on dit, de voir surgir un quidam. Je m'enquiers à nouveau de la possibilité d'un écrit rédigé en dialecte hexagonal. On me redirige sur l'étage. J'y vis de belles étagères de littérature british et teutonne, mais évidemment point de française. L'employée présente à qui je m'adresse au seuil du découragement ouvre alors un carton qui, providentiellement, séjournait sur son présentoir. Elle en extrait une poignée de romans d'auteurs hongrois en Folio ou Livre de Poche. Une dizaine tout au plus. Je ne me sens plus de joie et je choisis un court roman de Sándor Márai, L'héritage d'Esther, ainsi que Tango de Satan, de Laszlo Krasznahorkai.
Je m'apercevrai un peu plus tard que je les ai payés plus du double que ce qu'ils m'auraient coûté en France. Et vous pouvez penser avec raison que rien ne pressait et que j'aurais pu attendre d'être revenu. Certes, mais acheter un livre sur place c'est un souvenir de voyage, et il n'est pas certain que ma ferveur hongroise eut perduré une fois de retour au bercail.
Je n'ai pas regretté. J'avais fini Kertész, je lus le petit Sándor Márai en une nuit ou presque. Autant le premier avait été aride, autant le second s'imposa par une fluidité étonnante. C'était tout bonnement une sorte de chef d'oeuvre.
D'ailleurs, à peine reposé le pied en France, j'achetai le Libération du week-end (Libération que je n'achète plus que rarement) parce qu'il contenait un long article de Philippe Lançon sur le Journal des années hongroises (1943-1948) de Sándor Márai, qui vient de paraître chez Albin Michel. Article magnifique, comme le plus souvent avec Lançon, rendant bien compte du destin tragique d'un écrivain majeur qui se résoudra à l'exil en Amérique la mort dans l'âme : "Dès 1945, l’exil paraît à Márai la pire des solutions, peu à peu à l’exception de toutes les autres."
De cet article encore, j'extrais le passage suivant qui évoque précisément un café littéraire.
Cette terreur quotidienne, on peut l'appréhender à travers la visite du bien-nommé Musée de la Terreur, sur l'avenue Andrassy, qui raconte les deux périodes noires de l'histoire du pays, le pouvoir génocidaire des Croix Fléchées et l'occupation soviétique.Terreur quotidienne
Márai possède 5 000 livres et il a beaucoup de souvenirs, d’inquiétude, de chagrin. Lui et sa femme sont mariés depuis vingt ans. Leur unique enfant est mort en bas âge. On l’apprend incidemment : «Quand mon père est mort, je suis aussitôt sorti de sa chambre fumer une cigarette dans le couloir de l’hôpital. J’ai agi de même quand mon fils est mort. Il semblerait que je sois vraiment un grand fumeur.» C’est le ton de Márai : celui d’un désespoir observateur et ironique. Le couple va adopter un enfant abandonné, Janos. La description de sa force joyeuse et de sa spontanéité égocentrique est un contrepoint solaire à ce qu’il voit d’un monde «au seuil de l’enfer». Une image anecdotique de cet enfer est ce qu’il reste d’un «café littéraire» : «On dirait une salle d’hôpital psychiatrique où, au lieu de travaux manuels ou de jeux de société, on occupe les malades avec des chimères et des rêves de grandeur. Des yeux où brûle une vanité ulcérée, des cheveux hirsutes, des visages suspicieux et grimaçants. La littérature est un service divin accessible à l’homme - qui consiste à définir le sens de l’existence et à décider du rapport de l’homme avec le monde - mais c’est aussi celui dont la majorité des prêtres est malade et blessée.»
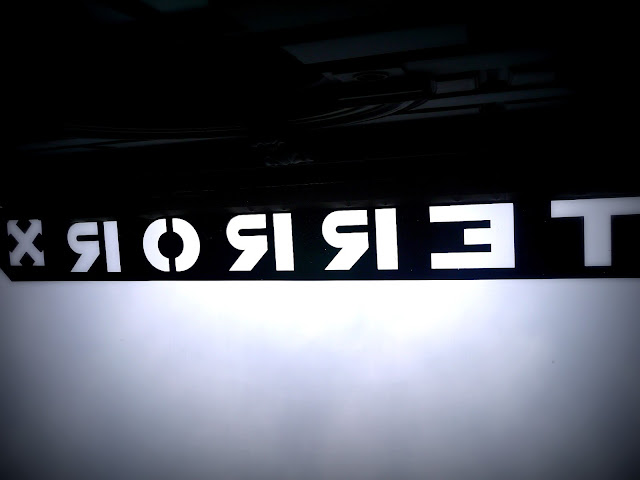 |
| Musée de la Terreur, Budapest |
Voici donc ce que je rapportai de ce voyage à Budapest, le souvenir de beaucoup de beauté entrevue mais aussi les stigmates du malheur des hommes. Devais-je me plaindre encore des sourires absents ?





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire