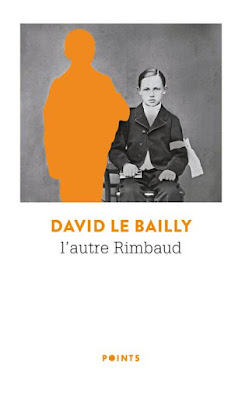"Je me glisse dans la niche, un pied de marbre avec, au-dessus, l'autel qui porte l'ancienne Madone. On raconte qu'une fille à moitié sauvage l'a sculptée avant que la ville n'existe, sans outil, seulement avec ses mains, ses dents et ses ongles, pour les couleurs elle a creusé dans la terre, les racines, en a tiré des pigments. Une statue de vingt centimètres, qui vous traverse de ses yeux.
A partir d'elle, on a bâti la ville."
Claudie Gallay, Avant l'été, Actes Sud 2021, p. 40
Je l'avais emprunté à la médiathèque, in extremis. Je ne l'avais pas cherché mais, devant la machine, au moment d'enregistrer mes prêts, je l'ai vu sur un rayonnage bas du meuble accueillant les nouveautés. Impossible alors de ne pas l'embarquer, malgré les réticences que je pouvais nourrir : était-il bien sensé de se charger d'un roman de presque 500 pages quand tant de livres encore inabordés m'attendent à la maison ? Si j'avais beaucoup apprécié Détails Opalka, n'allais-je pour autant à la déception avec un roman de facture traditionnelle ? J'avais déjà expérimenté avec La beauté des jours, est-ce que ça valait le coup de récidiver ?

Je dois dire que j'ai été tenté par la réponse négative : l'histoire placée en 1985 de cinq jeunes filles dans une petite ville aux portes de Lyon, qui se lancent dans le défi d'un défilé de mode pour le concours de talents de la fête du printemps, ne m'a pas séduit outre-mesure. Et je ne suis pas le seul, une partie du lectorat fidèle de Claudie Gallay, si j'en crois les critiques sur Babelio, a été déçu. J'ai attendu en vain le ou les passages qui feraient écho aux motifs qui m'occupent, et l'un de ceux-ci était le thème de la rencontre, comme le donnait à entendre la quatrième de couverture : "Sur les rencontres décisives et les renoncements nécessaires, un roman de la métamorphose, plein de promesses d'avenir." Tout est un peu faux dans cette phrase car la seule rencontre décisive pour Jessica la narratrice est celle de Madame Barnes, "une vieille dame nostalgique et fantasque", qui a tourné dans Mort à Venise et dont elle devient en quelque sorte la dame de compagnie. Mais, plus que sa personnalité (cette dame Barnes n'a rien de particulièrement fascinant ni même d'attachant), c'est sa mort qui va orienter l'existence de Jessica et la conduire à quitter le cocon familial et social (le renoncement est-il si douloureux ? la pesanteur et l'ennui provincial, bien rendus, laissent à penser que non). Au bout du compte, la métamorphose annoncée n'est encore qu'embryonnaire. Par ailleurs, dans ce livre, rien ou presque ne laisse deviner les obsessions à la Roman Opalka. Je dis presque parce qu'un élément peut tout de même y être rattaché : ce sont les agendas du père, maçon qui note chaque soir les détails de sa journée, et, surprise de Jessica quand elle consulte en cachette ces carnets soigneusement rangés, les grands événements de la vie familiale y sont à peine effleurés, seul semblent compter pour ce père la bonne tenue du ciment, le temps qu'il fait et les insectes dont il fait collection.
Et si l'essentiel était ailleurs, non dans l'intrigue, sans grand intérêt, non dans les personnages, très oubliables, mais dans certaines entités a priori secondaires mais qui irriguent le sous-sol de l'ouvrage. Et c'est loin d'être une métaphore en ce qui concerne la première de ces entités : le Bourde, la rivière qui baigne la petite ville et dont la rumeur enflant parfois jusqu'à la violence de la crue traverse tout le roman. Première apparition page 12 : "Avec l'eau du Bourde, les géraniums fleurissent bien, ma mère en met à toutes les fenêtres."Puis, page 35, Jessica vient s'asseoir au soleil, après le pont, observant les libellules ("Les libellules n'ont pas d'attachement, elles sont là et un jour elles repartent, elles vont voir ailleurs. Et là où elles s'arrêtent, ce nouveau bord de mare ou de rivière devient leur bord de mare, de rivière.") - libellules qui reviendront à la fin du livre, en écho au départ de Jessica pour Venise (je spoile le roman, désolé). Un peu plus tard, c'est l'affaire du petit Gregory, qui est évoquée en passant ("A cause du petit Grégory qu'on a retrouvé mort il y a trois mois déjà, c'était en octobre, dans une rivière qui porte le nom de Vologne et qui ressemble à notre Bourde.") Et puis c'est la crue du Bourde, plusieurs fois annoncée, toujours redoutée, qui va être la cause de l'événement qui va bousculer la destinée des cinq copines : le Bourde sort de son lit, déferle dans les rues, juste au moment d'un mariage à l'église. Le fils Canfre, un handicapé en fauteuil roulant, se retrouve seul sur la place devenue un lac. Jessica prend le parapluie d'un invité mais sa meilleure amie, la belle Juliette, s'en empare à son tour et va le placer au-dessus du fils Canfre. Le photographe de la noce prend une photo qui va faire le tour de la ville et des gazettes. Juliette devient l'héroïne du jour. Sa mère tente d'exploiter cette soudaine célébrité, et tout cela finira par tourner vinaigre.
A la fin du roman, l'importance de ce moment précis est bien mis en relief :
"Il m'arrive d'envier Juliette, mais ce n'est pas de la jalousie. (...) Et je ne lui en veux pas.
Elle aussi a pris ma place, le jour de la photo, quand elle m'a arraché le parapluie de la main. Elle a abrité le fils Canfre en restant sous l'orage, dans sa petite robe blanche. Quand on y réfléchit, tout est parti de ce test, tout le reste, et le cours des choses a changé. Et le mien aussi. Le cours de ma vie.
Et celui du fils Canfre un peu.
Et celui de Madame Barnes surtout.
Tout ça pour dire aussi que Madame Barnes est morte à cause de la photo. Ou de la petite robe. Parce que sans la photo. Cette photo, c'était juste une image. C'aurait dû être moi avec le Canfre, si elle ne m'avait pas pris le parapluie des mains. Prendre le parapluie pour aller abriter le plus difforme de la ville, et rester sous la pluie, tout ça pour qu'on la regarde, pour exister !" (p. 494)
Jessica pense que Juliette voyait loin, qu'elle a su anticiper, su se mettre en scène en profitant de la présence du photographe. Quoi qu'il en soit de la crédibilité psychologique du personnage et de ses intentions, c'est un vieux concept grec qui est à l'oeuvre ici : le kairos, l'occasion favorable qu'il faut saisir aux cheveux (et sur lequel, j'ai déjà écrit deux ou trois petites choses).
C'est le titre de l'un des derniers fragments fictionnels des Pérégrins, d'Olga Tokarczuk (eh oui, encore elle, et dites-vous bien que ce n'est pas fini, soit dit en passant, elle est née en 1962, comme Jessica Belmont). Histoire d'un vieux professeur et de sa femme Karen, vingt ans plus jeune, en croisière d'été aux îles grecques sur un paquebot de luxe où il dispense des conférences aux passagers :
"Je m'attarderai seulement sur une conférence qui est ma préférée. Karen en avait soufflé l'idée à son mari, lui suggérant de parler des dieux mineurs (...). Il s'agissait de tous ces dieux passés sous silence par Homère et, plus tard, ignorés par Ovide, dont les aventures et les histoires d'amour n'étaient pas jugées suffisamment truculentes pour mériter de passer à la postérité, des divinités pas assez terrifiantes ni assez rusées, trop éphémères, dont nous n'avons eu connaissance que par quelques débris de roches, par de rares mentions trouvées sur des documents sauvés de bibliothèques anéanties par les flammes. Mais, grâce à cela, ces divinités avaient réussi à garder quelque chose que les autres dieux, plus connus, ont perdu à jamais : l'instabilité et l'insaisissabilité divines, la fluidité des formes et l'incertitude généalogique. Elles avaient émergé de l'ombre, de l'informe, puis avaient de nouveau plongé dans l'obscurité. Citons, par exemple, Kairos, qui se manifeste toujours à l'intersection du temps linéaire des humains et du temps divin - qui est cyclique . mais aussi à l'intersection du temps et du lieu, à cet instant qui s'ouvre brièvement pour accueillir cette possibilité unique, opportune, une configuration qui ne se reproduira plus. C'est le point où la ligne droite qui va de nulle part à nulle part rencontre le cercle, l'espace d'un instant." (pp. 517-518, c'est moi qui souligne)
 |
|
Le kairos, pour Jessica Belmont, c'est la mort de Madame Barnes (dont on apprendra in fine que Juliette n'est pas tout à fait innocente - mince, je spoile encore), la venue subséquente de son fils Pietro qui lui propose de gérer ses affaires à Venise. : "Il y a des choses qui ne doivent jamais arriver. Et elles arrivent cependant. Je pars. Et ça ne me fait pas peur. Je marche le long du Bourde et on dirait que le Bourde m'accompagne."(p. 535)
Le Bourde d'Olga Tokarczuk s'appelle l'Oder (incidemment, les quatre lettres du fleuve sont contenus dans le nom du Bourde) : il intervient très tôt dans Les Pérégrins, avec le second fragment, Le monde dans la tête. But de son premier voyage, à pied, à travers champs. L'Oder me semblait immense, écrit-elle :
"Le fleuve coulait au gré de ses caprices, incontrôlable, imprévisible, enclin aux inondations. (...) Debout sur la digue, les yeux rivés sur le courant tumultueux de l'Oder, j'ai pris conscience que ce qui est en mouvement - en dépit de ses dangers - sera toujours meilleur que ce qui est immobile, et que le changement sera toujours quelque chose de plus noble que l'invariance, car ce qui stagne est voué inévitablement à la dégénérescence, à la décomposition et, en fin de compte, au néant, alors que tout ce qui évolue saura durer, et même éternellement. Depuis ce jour, le fleuve, comme une aiguille, est venu se ficher dans la bulle sécurisante du paysage qui m'environnait : le parc, le potager où poussaient des légumes sagement alignés sous les châssis, et la rue avec son trottoir aux dalles de béton sur lesquelles on jouait à la marelle. L'aiguille traversait de part en part ce décor rassurant par sa stabilité et y introduisait une troisième dimension - la verticale ; elle y laissait un petit trou, et le monde de l'enfance n'était plus alors qu'un ballon de baudruche percé dont l'air s'échappait avec un sifflement ténu." (p.11)
En parfait écho, ces lignes de Claudie Gallay, page 536 :
"Je sais aussi qu'on change. Nous, mais aussi les choses.
Je regarde couler l'eau brune du Bourde.
Elle aura duré longtemps, mon enfance, bien plus longtemps que celle de la plupart des filles qui étaient à l'école avec moi, il me semble que j'en ai étiré son fil jusqu'à ne plus pouvoir."
------------------------------
On pourra lire aussi l'entretien d'Olga Tokarczuk avec le poète John Freeman (Libération du 14 octobre 2019) où elle revient sur son premier voyage vers l'Oder :
"
Vous rappelez-vous le tout premier voyage de votre vie ?Quand j'étais petite fille, j'aimais beaucoup explorer mon propre espace. Je faisais des excursions plus ou moins longues, et l'une d'entre elles m'a menée jusqu'à l'Oder, ce fleuve qui coulait à seulement deux kilomètres de ma maison. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'être une conquérante. Ce fut une expérience fondatrice de mon enfance. Explorer le monde, en faire un espace de confiance et de sécurité. C'est quelque chose que ne connaissent plus les enfants d'aujourd'hui. Je me rappelle encore le moment où je suis arrivée face au fleuve, et ce fleuve était immense ; immense et magique. C'était quelque chose. Alors, je me suis dit :
«Je l'ai fait.» Un petit kilomètre, mais un grand pas pour l'humanité ! (Rires.).
Les éléments naturels sont très présents dans votre livre, l’eau ne cesse d’apparaître, et les baleines ne sont jamais loin. L’eau a-t-elle pour vous quelque chose de mythique ?Bien sûr. L’eau est la métaphore de notre inconscient. Elle est une limite, le symbole de la frontière que nous pouvons franchir. L’embarcation, le bateau est un autre genre de symbole. Je crois que l’idée de fendre les eaux est encore très présente dans la conscience humaine. Mais l’eau peut aussi être plate, périlleuse, ou au contraire une entité fertile, qui nous donne le pouvoir de croître, comme les plantes. L’eau est un éternel réservoir à significations. Quant à moi, en cartographiant le territoire de mon enfance, j’ai très tôt découvert que les cours d’eau avaient la même forme que les nerfs humains, que nos veines. Ce livre est aussi profondément ancré dans l’essence fractale des choses, le fait que ce qui est grand est très proche de ce qui est petit. Nous vivons dans un microcosme."