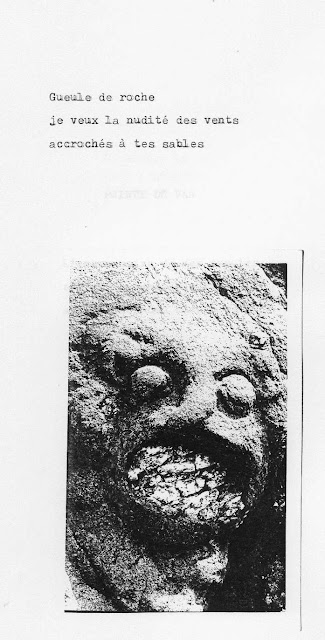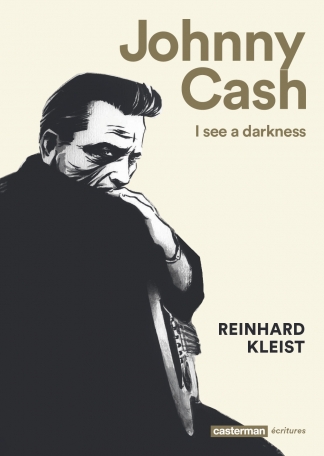Le 2 janvier 2017 John Berger décédait à Antony à l'âge de 90 ans. Cela je l'appris hier en lisant "John Berger, la vie du monde", un article de la revue Ballast, écrit par Joshua Sperling, paru en anglais sous le titre « The Transcendental Face of Art », sur Guernica, en février 2017 — et traduit par Isabelle Rousselot et Anne Feffer.
2 janvier 2017, autrement dit, il y a sept ans très exactement.
Or, ce lundi 2 janvier 2017, je publiais le premier article (sur 313) de ce que j'appelais le projet Heptalmanach, fondé comme son nom l'indique sur le nombre 7. Il s'agissait de Otto et l'attracteur étrange. Où j'abordais le concept d'attracteur étrange à travers la bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, Otto, l'homme réécrit (Delcourt, 2016). Il n'est peut-être pas inutile de revenir sur l'oeuvre en question. J'écrivais donc ceci :
"Otto est un artiste reconnu qui réalise des performances autour de la thématique du double, du miroir, reflétée dans son nom même, Otto, à vrai dire un palindrome, un mot se lisant dans les deux sens. Or, à l'issue d'une ultime performance au musée Guggenheim de Bilbao, il est la proie d'un vertige intérieur et comprend qu'il est dans une impasse. Il ne rêve plus que d'effacement. Peu de temps après, il apprend la mort de ses parents, qu'il ne voyait plus depuis longtemps. Son héritage se réduit à une maison et une malle, mais dans cette malle, qu'il retrouve au grenier très classiquement, il découvre des cahiers, des notes, des documents photo, audio et vidéo, qui concernent les sept premières années de sa vie - ses parents ayant été associés à un programme scientifique visant à enregistrer son existence de la façon la plus exhaustive.
Après une période de doute, il décide de se retirer dans un vaste loft d'une ville reculée pour tout lire, tout voir, tout entendre, tout revivre de ces années enregistrées à son insu mais dont la mémoire vive lui faisait défaut. Concentré sur les faits, les actes, les pensées de son passé, il les organise "
dans leurs interrelations multiples, les agençant entre eux par une logique spatiale et temporelle."
C'est cet agencement qui va dessiner rien moins qu'un
attracteur étrange."

Je citais ensuite cet extrait d'entretien avec Marc-Antoine Mathieu :
"En faisant ses recherches sur lui-même, Otto a produit cette forme gigantesque, qui le dépasse. Il la compare aux attracteurs étranges, ces rendus géométriques des phénomènes chaotiques. Comme la météo, un robinet qui coule ou la digestion d’un moineau. Des phénomènes engendrés par des relations de causes à effets extrêmement complexes, imprévisibles car comportant trop de paramètres. Des points aléatoires qui, après deux ou trois jours de calcul par ordinateur, peuvent être reliés pour former des dessins différents. Certains neurologues pensent que la consience fonctionne un petit peu selon la même configuration. Otto, en voulant tracer son être, débouche donc sur un attracteur étrange. Il ne savait pas ce qu’il cherchait mais il l’a trouvé en cherchant. C’est une posture de scientifique, qui devrait à mon sens être davantage utilisée dans l’art. Pour ma part, j’avance souvent dans une idée sans savoir où je vais, et à un moment quelque chose m’échappe, et je découvre des choses inattendues." [C'est moi qui souligne]
Je concluais en affirmant que depuis longtemps, ici sur Alluvions, et donc aussi sur le projet Heptalmanach, je ne fonctionnais pas différemment. C'était un attracteur étrange qui allait, du moins je l'espérais, se construire peu à peu, tissé de mille liens, une figure complexe qui tiendrait beaucoup à mon propre itinéraire de recherche.
313 articles plus tard, ainsi qu'une fiction centrée sur l'année 1967, à laquelle je donnais ultérieurement le titre de Barbe Bleue ne passe pas le dimanche, je ne sais pas si j'ai réalisé mon objectif (je n'en ai pas tracé une représentation graphique calquée sur celle de MAM), mais ça y ressemble tout de même.
Il est maintenant très curieux et, dirais-je, éminemment étrange, que sept ans plus tard très précisément, par l'entremise de John Berger, ressurgisse cet article initial. Comme si une nouvelle boucle de sept ans était ainsi bouclée.
Et tout ceci n'a été possible que par cet élément déclencheur qu'a été ce petit déménagement parisien, et l'achat, absolument pas prévu, d'un livre de John Berger, qui me conduisit à ouvrir enfin ce roman, G., que je conservais en attente depuis je ne sais combien de temps.
Comme l'attracteur étrange est généreux (mais il peut aussi se taire, et se rendre indisponible, au sens que donne à ce terme le sociologue allemand Hartmut Rosa), il est rare qu'il se manifeste sans provoquer quelques résonances supplémentaires (à l'image d'un séisme qui s'accompagne le plus souvent de répliques). Je note tout d'abord 1) que l'ouvrage trouvé à Austerlitz, et dont le G de la couverture faisait écho au G. du roman de John Berger, a été publié en 1967, 2) que, comme dans un rêve, chaque détail compte, ainsi le code-barre barré de G. porte dans la suite numérique au-dessous un 777.

Ce n'est pas tout. En ce jour second de l'année, la grisaille et la pluie attristant la ville, je me suis plongé plus que jamais dans la lecture et j'ai fini d'une part G., d'autre part Mon année dans la baie de Personne, de Peter Handke. Or, entre ces deux romans qui ont donc marqué les derniers posts, des connexions se sont établies. On sait que Peter Handke est originaire de Carinthie, en Autriche, land le plus méridional du pays, avec une minorité ethnique slovène, à laquelle appartenait la mère de Handke (sont père était un soldat allemand qu'il n'a connu qu'à l'âge de 19 ans). Igor Fiatti, dans un article de la revue en ligne Slavica bruxellensia, « Peter Handke : La parole slovène à travers les confins », montre bien l'attachement de l'écrivain pour cette langue maternelle, visible surtout à travers le roman Le Recommencement (Die Wiederholung), publié chez Gallimard en 1989, mais affirmé aussi dans un entretien :
Dans toute ma vie, hormis ce que j'ai épié, vu et lu du national-socialisme, je n'ai subi aucun événement historique qui pût me déterminer – à part, si vous acceptez cet exemple, le bilinguisme en Carinthie du Sud, où j'ai été élevé, et où j'ai remarqué que le groupe qui parle l'allemand opprime le groupe qui parle une autre langue, le slovène, et le considère comme de valeur moindre. C'est déjà une expérience déterminante, mais dans ce cas-là, elle ne me diminue pas. C'est tout au plus pour moi un motif de me mettre à écrire. Cela renforce pour ainsi dire le pathos – ou cela fortifie le pathos et lui donne aussi une nourriture concrète.*

Si l'on veut donner un exemple de l'attention portée par l'écrivain à la langue slovène, on peut citer ce passage où Gregor Keushnig, le narrateur de Une année dans la baie de Personne commence à évoquer son idylle avec les champignons, et mentionne une récolte faite avec son grand-père dans les montagnes de Yougoslavie. Il poursuit ainsi : "Et ma mémoire n'a retenu aucune découverte de cèpes dans mon enfance. Il arrivait, assez rarement, que mon grand-père rentrât avec un exemplaire de ce qu'il appelait en slovène, de manière plutôt péjorative, jurček, mais lui qui partageait volontiers ne trahit même pas à moi ses endroits secrets, et je me figure toujours que je vais tomber sur un testament scellé où il me les dévoile." (p. 585)
Or, la quatrième partie de G. se déroule à Trieste en 1915, et commence par cette phrase : "Nuša estima que G. était différent de la plupart des autres hommes." La jeune femme est slovène. La question de la langue et de la discrimination qui l'accompagne affleure dès le second paragraphe :
"Au bout d'un moment il lui demanda d'où elle venait. La question semblait innocente et elle lui répondit qu'elle était née dans le Karst. Dans ce cas, dit-il, dites-moi quelque chose en slovène, s'il vous plaît. Elle dit en slovène : Il y a du soleil aujourd'hui. Il lui demanda de dire quelque chose de plus long. Elle dit : La plupart des Italiens méprisent notre langue. " (p. 283)
Un nom apparaît aussi dans cet extrait, qui est rien moins que fondamental : le
Karst. On le trouve chez Handke dans
L'histoire de mon amie, dont j'ai déjà parlé dans l'article
Tu lèverais tes bras dans la nuit. Avec cette originalité chez cette femme de refuser de donner des noms : "
Mais en règle générale, rien au monde n'avait pour elle de nom particulier ou propre. La "Dalmatie", où elle habitait depuis longtemps, ne devait pas s'appeler ainsi, mais "le pays de la côte" ou "le pays des falaises sur la mer" (même le Karst était trop spécial à ses yeux)." (p. 371) On retrouve aussi le Karst plus loin dans le roman quand le narrateur revient sur son ami architecte et charpentier, en voyage au Japon : "
Il n'était certes pas toujours rétribué, mais il était souffert, d'autant qu'il se mettait immédiatement au travail d'une manière qui ne laissait pas place à la contradiction. Il se tenait à l'écart, mais il ne se présentait pas comme un étranger et faisait comme s'il était chez lui, dans le Karst ou le Frioul, sinon qu'ici, ailleurs, il menait ses entreprises à bonne fin." (p. 614)
Il est intéressant de retrouver cette alliance du Karst slovène et du Frioul dans un passage de l'étude d'Igor Fiatti : "La langue slovène « retrouvée » par Handke est symétrique, dans un tel sens, à l’idiome utilisé par Pier Paolo Pasolini dans ses Poesie friulane (Poèmes frioulans). À ce propos, Johann Strutz relève que « l’innige Ironie » (l’ironie intime) de la langue slovène de Handke exprime une idée similaire au « frioulais » de Pasolini : les deux ont choisi un idiome non corrompu, le mythe d’une culture et d’une société non aliénées, sans bourgeoisie, sans aristocratie. Une langue mère qui, dans le livre de Handke, représente par ailleurs la seule voie pour tenir en vie sa propre foi." Cette langue maternelle, la « Muttersprache »"se révèle une allégorie biblique qui ouvre une série de parallélismes entre le peuple slovène et le peuple hébraïque. La matrice architextuelle de l’Ancien Testament se concrétise dans l’âpreté du paysage du plateau du Karst, où le destin slovène de Die Wiederholung se superpose à l’écho éloigné de l’errance du peuple de Moïse dans le Sinaï. Le vent karstique, en particulier, est le souffle vital, créateur de la Genèse et, en même temps, il est le souffle de la Pentecôte – mais non dans l’interprétation chrétienne proposée par l’excellente analyse de Desbrière-Nicolas, plutôt dans la lecture hébraïque liée à la célébration du don de la Loi. Sans le vent du Karst, le narrateur reconnaît qu’il n’aurait pu raconter aucune histoire, « aucune inscription ne courrait sur ma stèle. Tout cela ne faisait-il pas une loi ? »
 |
| Peter Handke, Le dessin d’une table à la terrasse du « Schloßhotel à Velden », daté du 8 août 1978**. |
C'est enfin avec Trieste que s'achève Le Recommencement : "Les échos biblico-karstiques résonnent depuis longtemps dans la production littéraire – le Karst a été transposé bibliquement dès le début du XIXe siècle dans la littérature triestine –, mais, dans le roman de Handke, les renvois au thème de la traversée, de la traversée du désert, s’accumulent dans sa recherche du seuil. La figure de Moïse se découpe enfin nettement dans le golfe de Trieste, où se conclut le voyage de Filip qui aperçoit un bateau, « l’Arche de l'Alliance »"
______________________
*
Extrait de l’entretien que Peter Handke a accordé au germaniste suisse Herbert Gamper (Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen: ein Gespräch, Amman, Zürich, 1987) : Gamper H., Espaces intermédiaires : entretiens, traduit de l'allemand par Nicole Casanova, Christian Bourgois, Paris, 1992, p. 113.
** Ce dessin correspond à l’étape d'un voyage qui a conduit Handke de Styrie en Carinthie en longeant la frontière austro-slovène (en passant par Pongratzen, Eibiswald, et la station ferroviaire Aich dans la vallée de la Jaun). L’image montre une table sur laquelle il y a un petit plateau avec une tasse de café et un verre d’eau ; à droite, on voit une carte – rappel de la marche à pied effectuée par Handke. (Lire
Notes-dessins et dessins-récits, Esquisses, dessins et images dans les carnets de Peter Handke de 1972 à 1990, par Christoph Kepplinger-Prinz and Katharina Pektor.