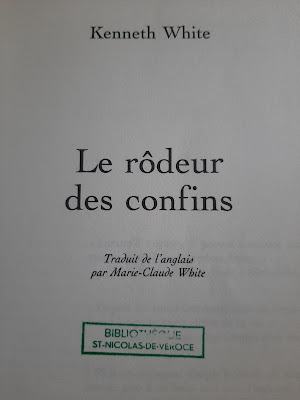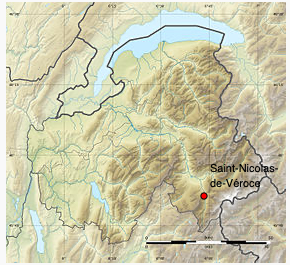"Toutes les familles abritent dans leurs replis les plus intimes ces petits morts qui étaient le lot des temps, une sorte de tribut de chair fraîche et tendre payé aux dieux lares des descendances pléthoriques."
Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils, Folio, p. 142
→ Suite de 2 - Le fils perdu (mais peut se lire indépendamment)
Le 8 avril dernier, de passage à Cultura, je vois que Histoire du fils, le dernier roman de Marie-Hélène Lafon, est paru en poche. J'aime beaucoup Marie-Hélène Lafon, qui a déjà hanté ces pages à plusieurs reprises, mais je ne m'étais pas précipité sur ce livre, qui avait reçu le prix Renaudot. Moi, les prix, ça ne m'encourage guère à l'achat, c'est même le plus souvent répulsif. Un stupide esprit de contradiction, peut-être ? Rien de systématique, je tiens à le dire, mais quand même. Alors là, en poche, vais-je m'y résoudre ? J'ouvre le volume et je lis, sur une page nue, cette seule date, Jeudi 25 avril 1908.
Alors que la veille, j'avais écrit cet article sur le compas new-yorkais chiné à la brocante des Marins, le Eagle Compass and Divider No. 569. Où il était écrit au revers du couvercle, Maurice Niveau, Château-du-Loir, janvier 1908. Cette coïncidence de dates, ce 1908 récurrent, évidemment, produit son effet.
Je retrouverai plus tard cette année 1908 dans l'écriture de 2 - Le fils perdu, avec James Joyce et Ulysse, commenté par Philippe Forest :
Forest pose alors une autre question : que savait-il, Joyce lui-même, de la mort ? Pas grand chose en fait, dit-il, avant de signaler pourtant une épreuve dans l'existence du romancier, à laquelle les biographes de Joyce n'accordent pas plus d'importance qu'à la disparition du fils unique de Shakespeare - "comme si, précise-t-il avec un peu d'ironie amère, ces triviaux incidents n'intéressaient que la nursery et ne méritaient pas d'avoir exercé quelque influence que ce soit sur la library de la littérature universelle." Ce "trivial incident", le voici :
"Le 4 août 1908, donc, Nora, mère déjà d'un petit garçon et d'une petite fille, Giorgio et Lucia, perd en fausse couche celui - ou celle - qui aurait dû être son troisième enfant. La grossesse s'interrompt brutalement et sans que l'on puisse savoir pourquoi au bout de trois mois. La jeune femme ne se trouvera plus jamais enceinte. A son frère, Stanislaus, Joyce confie être probablement le seul "à regretter l'existence tronquée" de cet être qui ne sera pas. Et il lui avoue avoir longuement examiné le foetus rejeté du ventre de sa femme." (p. 166)
Et que se passe-t-il donc ce 25 avril 1908 dans le roman de Marie-Hélène Lafon ? Je ne divulgâche guère l'intrigue si je révèle qu'il s'agit d'un accident mortel, même si la mort n'est pas dite explicitement. La mort d'un enfant de cinq ans. Un autre fils perdu.
Importance cruciale des dates chez la romancière du Cantal. Ce sont des dates précises qui constituent les différents chapitres de l'histoire. Le dernier est placé au vendredi 28 avril 2008, et commence justement par ces mots, les dates :
"Les dates sont là, gravées en lettres dorées sur le marbre sombre du caveau, quasiment pimpantes dans l'avril bondissant. 2 août 1903-28 avril 1908. Armand Lachalme. Cent ans. Le jour, le mois, l'année sautent aux yeux d'Antoine. Armand Lachalme est mort et enterré depuis cent ans, jour pour jour, à Chanterelle, Cantal, pays perché, pays perdu. Antoine, son petit-neveu, il hésite un instant sur le terme exact à mettre sur ce degré de parenté jusqu'alors inusité dans le champ de sa conscience d'homme bientôt quinquagénaire, lui donc, Antoine Léoty, son petit-neveu, citoyen franco-américain, nanti de la double nationalité depuis plus de quinze ans, de passage en France pour trois jours, entre deux avions, se tient là devant la tombe de cet enfant de cinq ans dont, quelques heures plus tôt, débarquant à Chanterelle au volant d'une voiture louée à Clermont-Ferrand, il ignorait jusqu'à l'existence." (pp. 164-165)
C'est une fiction. MHL pourrait se passer de cette coïncidence. L'histoire serait presque la même, peut-être même plus crédible. Mais j'aime qu'elle s'en empare parce que la vraie vie, c'est ça, je ne cesse de le vérifier, contrairement à ce que la majorité pense, les coïncidences sont légion dans l'existence. Elles participent de son mystère. Paul Auster ne dit pas autre chose : "En tant qu'auteur de romans, je me sens l'obligation morale d'incorporer à mes livres des événements de ce genre, de décrire la réalité telle que je la vis - pas telle qu'on me dit qu'elle devrait être. L'inconnu se précipite sur nous à tout instant. Ma fonction, telle que la comprends, consiste à demeurer ouvert à de telles collisions, à guetter tout ce qui se produit de mystérieux dans le monde." (L'Art de la faim, p. 386)
Cette collision de dates n'est pas unique chez MHL, un autre exemple s'en trouve dans Nos vies : " (...) on aurait tout fêté ensemble, le mariage et le baptême de l'enfant, le samedi 28 octobre 1967, le jour des trente-trois ans de Lionel, on n'avait pas fait exprès, mais c'était un beau hasard." (Buchet-Chastel, 2017, p. 92) Citation que je mis en exergue d'un article d'octobre 2017.
Coïncidences qu'on retrouve encore dans le chapitre du 21 avril 1962, où le père d'Antoine, André Léoty, se rend à Paris avec sa femme Juliette, boulevard Arago où réside le père qu'il n'a pas connu, Paul Lachalme, frère jumeau d'Armand Lachalme, le fils perdu. Il s'agit de "faire face au fantôme, se tenir un jour devant lui, oser, monter à l'assaut, crever le vieil abcès qui ne faisait pas mal, pas encore, mais ne se viderait pas seul." A Pâques, ils ont réservé trois nuits dans un hôtel de la rue Gay-Lussac "dont l'enseigne leur était apparue, à une lettre près, comme un signe de bel augure. L'Hôtel des Familles, Maison Lachaume, Père et fils, depuis 1924, portait bien son nom ; ils y avaient été accueillis, et enveloppés, par une patronne bienveillante, native de Bretenoux et exilée au nord de la Loire par amour pour Monsieur Lachaume fils, né en 1924, année de la création de l'hôtel, et prénommé Paul. Ahuris de coïncidences, Juliette et André avaient été sur le point de tout raconter à leur hôtesse, et s'étaient ravisés, avant de prendre d'un pas plus léger, dès le samedi matin, le chemin du boulevard Arago." (p. 118, c'est moi qui souligne)
Ce n'est que le samedi soir, après avoir visité le Louvre, et s'être saoulés "de couleurs, de corps, de motifs" devant les Noces de Cana, qu'il ont osé franchir le seuil de l'immeuble, sonner à la lourde porte, longuement, deux fois, trois fois. En vain. Il n'y eut pas d'autre tentative.
 |
| Les Noces de Cana par Véronèse, vers 1563 |
Ce n'est pas la seule présence de ces coïncidences qui m'a fait aimer ce livre, ce n'est jamais seulement cela d'ailleurs, non, ce serait très réducteur, je dois dire surtout qu'à la fin de ce livre, qui ne verse jamais, au grand jamais, dans le pathos, malgré le malheur initial, les secrets de famille et les deuils accumulés, j'ai éprouvé une émotion rare, aussi surprenante et intense que celle qui m'avait saisi en lisant les nouvelles de
Cristal de roche d'
Adalbert Stifter.
Mais de coïncidence, il en reste encore une à exposer, une résonance personnelle celle-ci, elle se trouve à deux pages de la fin :
"Antoine le sait depuis longtemps, quelque chose a résisté à son père, l'a empêché de remonter aux sources de Chanterelle, a été plus fort que le désir et le manque. Son père a désiré, son père a manqué. Il réfléchit, il roule dans la nuit, vitres ouvertes, le vert pétulant des feuillages neufs éclate dans la lumière des phares, le haut pays et ses frênes encore nus sont derrière lui, il a dépassé Aurillac, file vers Maurs, Figeac est à un peu plus d'une heure."
Aurillac, Maurs, Figeac, c'est la même route que nous avons arpenté l'été dernier dans le Cantal, et dont porte en partie témoignage cet article écrit au retour,
Nous allons perdre deux minutes de lumière, qui reprenait le titre d'un petit livre de poésie de
Frédéric Forte, où il était question, encore, de "
relever des coïncidences". L'article finissait ainsi :
Le jeu est très présent dans le livre de Frédéric Forte, avec le sudoku et candy crush au chant 1, qui se termine d'ailleurs avec des SMS des deux garçons de l'auteur : A. m'écrit / j'ai bien joué au théâtre j'étais Lucky/ Luke et Camille Pikachu. gros bisous. Au chant 2, on peut lire : je croque une pomme et le roi la reine / les parties de bataille sont interminables, tandis qu'au chant 3 il est dit : deux labyrinthes dans une même journée / ça fait beaucoup. dans celui de verre au jardin / d'acclimatation les enfants n'ont presque pas / essayé de se perdre. Et il se trouve - autre coïncidence - que je viens juste de lire au Lieu tranquille l'entrée que consacre Alain Baraton, dans son Dictionnaire amoureux des jardins, au Jardin d'acclimatation, dont il commence par dire que les Parisiens le découvrirent le 6 octobre 1860, donc 157 ans jour pour jour avant la fin de l'écriture de Nous allons perdre deux minutes de lumière.
Encore une date-clé, encore un événement survenu n ans plus tard, jour pour jour.
J'ajouterai, pour finir, que cette dernière date, 6 octobre 1860, renvoie à une année, 1860 donc, absolument essentielle pour l'œuvre d'un écrivain récemment apparu dans ces pages avec Fenua, son dernier livre : Patrick Deville. Or, il était l'invité de l'Envolée des livres, le salon qui s'est déroulé à Châteauroux ce week-end, au couvent des Cordeliers. J'ai assisté samedi après-midi, bien sage spectateur, à une table ronde où Patrick Deville côtoyait Hyam Yared, Patrice Franceschi et Olivier Weber. L'écrivain expliqua entre autres comment l'année 1860 est au coeur du cycle de douze romans qu'il a entrepris. Dans La Presse, il répondait déjà, en 2017, à une même question sur cette année-là :
"Pourquoi cette obsession de l'an 1860, dans vos romans?
Tous les romans du cycle Sic transit gloria mundi commencent en 1860 et vont jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant une année que je connais tout autour du monde comme si je l'avais vécue. 1860, c'est le moment où pour la première fois - enfin, c'est la thèse que je prends -, toutes les informations sont disponibles sur toute la planète, où toutes les civilisations et tous les peuples connaissent l'existence des autres et où un événement qui se produit quelque part a des répercussions partout. C'est la deuxième révolution industrielle, la planète rétrécit brusquement, avec les navires à coques en fer, la vapeur, les locomotives, le canal de Suez, etc., et c'est le début de l'européanisation du monde, jusqu'à la Première Guerre mondiale."
Je regrette de n'avoir pu échanger un moment avec l'auteur. Il ne vint pas ensuite à sa table de dédicace et je ne pouvais revenir le lendemain. J'achetai néanmoins Viva, en pensant que c'était le premier de la série (je me trompais, c'était Pura Vida), mais cela a peu d'importance, les livres peuvent se lire dans le désordre.
________________________
[Ajouts du 12 mai, après-midi :
1/ Après avoir rédigé et publié cet article, j'ai parcouru l'édition numérique de Libération, et suis tombé sur le portrait de Soeur André, devenue à 118 ans la nouvelle doyenne de l'humanité. Je fus frappé par les premières lignes : "Au commencement, elles étaient deux. Lydie et Lucile, nées le 11 février 1904 à Alès, dans le Gard. La première est décédée à 18 mois d’une pneumonie. La seconde, âgée de 118 ans, défie aujourd’hui toute certitude scientifique sur la longévité. Sœur André, de son vrai nom Lucile Randon, est devenue doyenne de l’humanité le 19 avril dernier, une distinction décernée par le livre Guinness des records et l’International Database of Longevity (IDL)."
Comment ne pas faire le parallèle avec les jumeaux de
Histoire du fils, Armand et Paul Lachalme, celui qui décède à cinq ans, et celui qui meurt à 95 ans ?
2/ Ce matin, je vois sur mon fil Facebook une notification de Frédéric Forte, pour un atelier d'écriture oulipien. Or, je n'ai pas publié mon article sur FB, et c'est la première fois, à ma connaissance, que le nom de Frédéric Forte s'affiche sur mon mur. L'algorithme zuckerbergien est-il puissant au point de lire dans les publications non directement visibles de ses membres ? Quoi qu'il en soit, cette quasi-synchronicité interroge.
La publication à laquelle quelques personnes (dont ma fille Pauline) ont réagi est une photo d'étranges nuages, que j'ai appelé nuages-méduses, aperçus dans le crépuscule castelroussin pendant la rédaction même de mon billet.