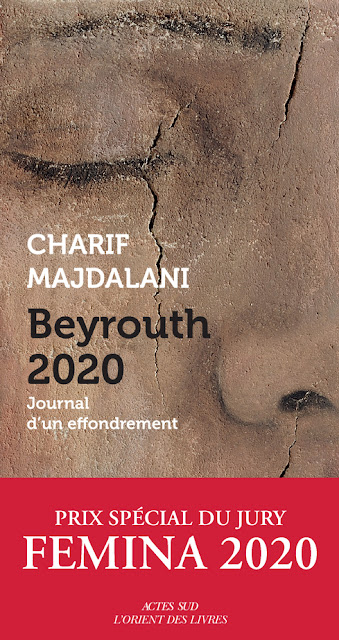Venons-en au finale de la représentation du cirque Bastiani. Petit cirque familial avec le père, le magicien au coq de Bantam, "sa très belle femme et leurs trois enfants bruns et bouclés, non moins beaux". Ils jouent ensemble une musique qui remue Austerlitz jusqu'au fond de l'âme, "une musique de nuit absolument étrangère, comme arrachée du néant par des instruments un peu désaccordés". Ce qui se passa en lui alors, il ne le comprend toujours pas, de même qu'il n'aurait su dire "si sa poitrine était oppressée sous l'effet de la douleur ou se dilatait de bonheur pour la première fois de ma vie."
Dans les études sur Sebald et particulièrement sur Austerlitz, je n'ai rien lu sur ce passage du cirque Bastiani (mais je ne peux assurer bien sûr qu'il n'existe pas quelque part une exégèse bien sentie qui réduira à peu de chose cette propre chronique, disons simplement que toutes mes recherches sur le net ont été vaines). Et pourtant ce moment me semble crucial : tout d'abord parce qu'il est rare dans cette œuvre de trouver un moment qui s'apparente à de la joie. Or, la joie est ici présente, dans cette dilatation de bonheur qui me rappelle l'étude du philosophe Jean-Louis Chrétien sur la Joie spacieuse, sous-titrée justement Essai sur la dilatation (Éditions de Minuit, 2007). Je dois à la vérité de dire que je n'ai pas lu ce livre (j'ai lu avec le plus grand intérêt d'autres essais de ce grand philosophe, mais pas celui-ci), mais ce que j'en sais par la lecture de critiques me suffit présentement pour opérer ce parallèle, et retrouver par là cette parenté troublante de la joie avec l'angoisse, telle qu'elle se dessine dans Austerlitz :
"La joie nous rend plus vifs dans un plus vaste monde. Comment penser cet élargissement du dehors et du dedans, et le chant neuf de ses possibles ? Et de quelle manière décrire ce que la Bible nommait dilatation du cœur, laquelle parfois se produit jusque dans l'épreuve et l'angoisse, comme si leur pression faisait naître une force à nous-mêmes imprévue ?" (Extrait de la présentation sur le site de Minuit)
Il convient maintenant de faire place aux deux dernières phrases qui décrivent cette "inoubliable représentation de cirque", avant que Sebald ne reprenne sa marche en avant et revienne sur le motif de la Bibliothèque nationale :
"Pourquoi certaines mélodies vous touchent à ce point, certaines syncopes, certaines tonalités, jamais un être aussi peu musical que moi ne pourra jamais le comprendre, mais aujourd'hui, rétrospectivement, il me semble que le mystère qui m'a effleuré à l'époque a été levé par l'image de cette oie blanche [le dernier enfant de la troupe est accompagné d'une oie blanche] qui, impassible, se tenait immobile au milieu des artistes pendant qu'ils jouaient. Paupières closes, le cou légèrement tendu vers cet espace ouvert par le faux ciel du chapiteau, elle écouta jusqu'à ce que les dernières notes se dissipent, comme si elle connaissait son propre sort et aussi le sort des gens de cirque en compagnie desquels elle se trouvait."
 |
| "Forains mi-gitans, avec leurs oies savantes", Saintes-Maries de la Mer, 1948, Photo Base PhoCem |
Sebald ne développe pas : quel est donc ce sort réservé à l'oie blanche, et, dans la foulée, aux gens du cirque qu'elle accompagne ? pourquoi le mystère effleuré à l'époque est-il levé par cette image de l'oie blanche ? Encore une fois, pas de réponse sur le net. Faut-il faire le rapport avec l'oie blanche qui est, selon l'expression consacrée, "une jeune fille très innocente, très niaise, pure" ? Cette locution n'est pas immémoriale, elle daterait de la fin du XIXe siècle, et aurait été mise en vogue par le romancier Marcel Prévost.
L'oie blanche est souvent la victime du pervers, qui profite de sa naïveté pour lui extorquer des faveurs. On aurait quelque raison alors de craindre pour son avenir. Il y a en tout cas comme une menace implicite dans cette expression "comme si elle connaissait son propre sort". Cette oie blanche pourrait bien passer à la casserole, dans tous les sens du terme. Et n'est-ce pas ce qui menace aussi les circassiens qu'elle accompagne ? En un sinistre rappel du génocide des Tsiganes perpétré par les Nazis : rappelons que les Sintis et les Roms n’ont été déclarés victimes de la politique raciale du IIIe Reich qu’en 1982 par l’Allemagne et que la France n’a reconnu sa responsabilité dans l’internement des gens du voyage qu’en 2016. Il reste encore difficile de chiffrer le nombre de morts durant cette période en Europe, mais on l'estime entre 300 000 à 500 000, au minimum.
 | |
| Après l’arrestation de la famille, Ceija et sa mère sont successivement déportées à Auschwitz, Ravensbruck et Bergen-Belsen. |
Le coq de Bantam et l'oie blanche, ces deux volatiles, seraient, selon cette perspective, comme les emblèmes de l'extermination.
Pour finir, je voudrais dire qu'il y a un film auquel ce passage du cirque Bastiani m'a irrésistiblement fait penser, et qui n'est autre que Les Ailes du désir de Wim Wenders. L'action se passe à Berlin et non à Paris, mais on y trouve aussi un petit cirque, le cirque Alekan (qui porte le nom du grand Henri Alekan* qui a éclairé le film), installé là aussi sur un terrain vague. C'est pour l'amour de Marion, la trapéziste, interprétée par Solveig Dommartin, que l'ange Damiel (Bruno Ganz) renonce à sa condition d'immortel et devient humain.
Marion, porteuse des ailes d'ange pour son numéro, ne serait-elle pas cette oie blanche tendant le cou vers le faux ciel du chapiteau ? En une résonance avec la Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda.
Comment exclure la possibilité que Sebald, grand admirateur de Peter Handke (qui écrivit une partie des dialogues du film de Wenders), ait écrit ce passage d'Austerlitz en songeant précisément à ce film si proche de lui de par sa tonalité mélancolique ?
_______________________________
* Dans sa quinzième livraison de son feuilleton Unicorn, mon ami Nunki Bartt insère une photographie du Cirque Alekan, alors même que je ne lui avais pas touché le moindre mot sur cette relation que j'entrevoyais entre Sebald et Wenders.
Extrait : "Tout autour d’eux n’était qu’un enchantement, un opérateur aussi doué qu’Henri Alekan n’aurait pas mieux fait, pensait Lars, lui qui semblait tout droit sorti d’une comédie musicale à la Stanley Donen. La lumière était parfaite, rassurante. Le blanc et le noir se distribuaient harmonieusement sur la moindre parcelle d’un feuillage, sur la plus infime aspérité d’une roche, sur le simple pli d’un vêtement. Jasmine, attentive au moindre mouvement d’Unicorn, lui flattait toujours l’encolure, et la bête comblée d’aise, s’était mise à ronfler ; faiblement d’abord, puis de plus en plus fort, déclenchant chez Lars et Med un fou rire contagieux qu’ils essayaient d’étouffer en enfouissant leur visage dans les feuilles mortes qu’ils avaient rassemblées en petits tas."