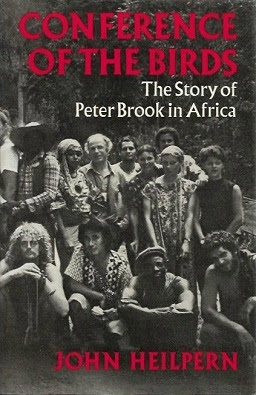Le 18 août 2021, Lola Lafon a passé la nuit au Musée Anne Franck, dans l'Annexe, à Amsterdam. Le livre qu'elle en a tiré vient de paraître chez Stock, dans cette collection Ma nuit au musée, à laquelle appartient Ephémère de Bernard Chambaz, dont j'ai rendu compte ici en mai 2021 (c'est dans le musée de Franco Maria Ricci que Chambaz avait passé la nuit). J'ai acheté ce livre samedi dernier, entre toutes les nouveautés de la rentrée littéraire, mû par une sorte d'urgence, d'intuition souveraine. De Lola Lafon, nom connu, je n'avais encore rien lu. La maison d'Anne Franck, je l'avais visitée, il y a bien des années maintenant, et pourtant, bizarrement, je n'ai jamais lu le Journal, parce que c'était comme si je savais déjà ce que j'allais y trouver, et que l'injustice faite à cette enfant, cette réclusion forcée qui ne la protégea pas jusqu'au bout (elle fut arrêtée, le 4 août 1944, avant d’être déportée à Auschwitz, puis Bergen-Belsen), me révoltait trop pour que je m'inflige ce tourment. C'est en partie idiot, j'en conviens.
J'ai plongé dans le récit de Lola Lafon, et en suis ressorti le lendemain, ébloui. Le défi était immense, être à la hauteur de l'adolescente, évoquer sa vie, sa chambre, le destin de son Journal, en restant à la bonne distance, en ne cédant jamais au pathos, en parlant aussi de soi, de sa propre histoire sans s'enfermer dans une perspective narcissique, non, rien n'était simple dans toute cette affaire. D'autant que l'écrivaine, en se rendant à Amsterdam, si elle éprouvait la nécessité d'écrire ce récit, ne savait pas pour autant de quoi il serait fait. A Ronald Leopold, le directeur du Musée, qui sonde en quelque sorte ses intentions, elle cite in fine Marguerite Duras : "Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire, avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine."
Autre difficulté, cette Annexe dans laquelle Lola Lafon va passer dix heures n'est pas autre chose qu'un appartement vide. Otto Franck, le père d'Anne Franck, quand il revint de sa captivité à Auschwitz en 1945, retrouva la cachette pillée par les nazis, vidée de tout élément. Alors, quand il fut question, en 1960, de faire de cet endroit un musée, il "exigea que l'appartement demeure dans l'état où il l'avait retrouvé. Qu'on en soit témoin, du vide, sans pouvoir s'y soustraire ; qu'on s'y confronte. [...] Ainsi, en sortant, on ne pourra pas dire : dans l'Annexe, je n'ai rien vu. On dira : dans l'Annexe, il y a rien, et ce rien, je l'ai vu." (p. 34)
Lola Lafon confie aussi qu'avant de rentrer dans cette nuit d'août 2021, "elle ne sait rien, sauf ceci : les fantômes, au contraire du mythe qui voudrait qu'ils nous hantent sans pitié, se tiennent sages. Ils nous espèrent, ils ont tout leur temps, celui que nous n'avons pas. Ils attendent qu'on accepte d'être déroutés. Que nos paupières se dessillent et qu'on devine, au travers du temps, leurs ombres patientes. Alors on pourra faire place à ceux qu'on dit avoir "perdus". On les retrouve." (p. 53) Et elle va les retrouver.
Et elle évoquera d'abord son enfance dans la Roumanie de Ceaucescu. Née à Paris en 1974, elle est la fille de deux professeurs de littérature communistes (son père est français, sa mère roumaine ou biélorusse - les sources divergent), qui s'expatrient, d'abord en Bulgarie puis en Roumanie, à Bucarest. Quand la famille revient à Paris, Lola a douze ans. Une trajectoire qui m'en évoque une autre, plus proche, celle de Bristena, la femme de mon fils Adrien, originaire de la ville de Cluj, venue en France avec Felicia, sa maman, à l'âge de onze ans (si je me souviens bien).
Pour Lola, la rupture est brutale : elle renonce vite à expliquer aux camarades de classe le quotidien paranoïaque des Roumains. Les parents soi-disant "sous écoute" : elle était mythomane ! C'est faute de se faire des amis qu'elle se met à écrire sur ce qu'elle ne peut pas partager. Tout son livre est d'une certaine façon une réflexion sur l'écriture, son sens, sa nécessité : "Peut-être commence-t-on parfois à écrire pour faire suite à ce qu'on a perdu, pour inventer une suite à ce qui n'est plus. Pour dire, comme le petit rond rouge sur un plan, que nous sommes ici, vivants. Si la mémoire s'étiole, les mots, eux, restent intacts, ils sont notre géographie du temps." (p. 96)
Entre treize et vingt ans, c'est l'emprise de l'anorexie, "expérience d'une solitude absolue, d'un vertige." Que seuls peuvent peupler des écrivains, des musiciens, eux-mêmes exilés. Apatrides chéris entre tous, qui "tournoient entre les identités".
Ida, sa grand-mère, parlait polonais, yiddish et français. Né à Lublin, elle rejoint son frère à Paris en 1930, exerce comme manucure dans un salon de coiffure, rencontre dans un bal d'immigrés russes un jeune homme qui a autant de prénoms que de pays traversés : "né Grichka en Russie, renommé Herschel, pus Zwi, lors de son passage en Palestine, en France, il sera Georges, le groom, le chauffeur e taxi, l'homme à tout faire, le vendeur de bibles à la sauvette et même l'ordonnance du maréchal Juin." Ida et Georges ont une fille, la mère de Lola, qu'ils cachent pendant la guerre dans des granges, des couvents, des familles protestantes, à Vif en Isère ou au Chambon-sur-Lignon.
Les deux grandes soeurs d'Ida, restées en Pologne, sont mortes de faim dans un ghetto.
"C'est elle, Ida Goldman, écrit encore Lola Lafon, la raison de ma nuit dans l'Annexe ; elle qui m'a offert, j'avais une dizaine d'années, une médaille dorée frappée du portrait d'Anne Franck."
Avec cette médaille, un photomaton, silhouette d'un adolescent en pull marin, qui aura quinze ans pour l'éternité. C'est cette dernière partie du livre qui donnera la raison de son titre, et ne lisez donc pas plus avant si vous voulez garder la surprise.
Je me ravise, je ne dirai rien, seulement que cette chanson est la trace d'une rencontre, brève et intense, à Bucarest. Elle s'appelle I started a joke, une chanson des Bee Gees, enregistrée et publiée en 1968 dans leur album Idea.
[...]
Ce même samedi, j'avais acheté le hors-série du Monde consacré à Gotlib. Je savais déjà que ce génie de la bande dessinée avait eu une enfance douloureuse, mais je ne connaissais pas le détail. Marcel Gottlieb est né le 14 juillet 1934 (la même année que mon père) dans le 14ème arrondissement de Paris. Son père, Erwin, immigré juif roumain, peintre en bâtiment, est arrêté en septembre 1942 par la police française, puis transféré à Drancy et déporté par le convoi no 37 du 25 septembre 1942 au camp de travail et de concentration de Blechhammer. Il survit à l'évacuation du camp lors de la marche de la mort mais est assassiné au camp de concentration de Buchenwald le 10 février 1945. Quelques mois après, Régine, la mère de Marcel, prévenue de la rafle par un gendarme, réussit à le cacher ainsi que sa sœur chez une famille de paysans d'Eure-et-Loire.
Gotlib a peu évoqué cette période sombre de sa vie, à deux reprises seulement, avec deux Rubriques-à-brac, quatre planches en tout et pour tout, mais c'est poignant. L'une d'elles est Chanson aigre-douce *(Pilote n°525, du 27 novembre 1969), dédiée à sa fille Ariane, née quelques mois plus tôt. Une histoire totalement autobiographique, ainsi qu'il le confiait à Télérama à l'occasion de l'exposition que lui consacra en 2014 le Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme :
"Dans La Rubrique-à-brac, au milieu des trucs comiques, je glissais parfois des pages un peu plus graves. Celle-là est complètement autobiographique, pour une fois. Pendant l'Occupation, ma mère nous avait mis en pension chez des fermiers, un peu Thénardier sur les bords. Ces gens-là gardaient plein de mômes. Au début j'allais à l'école, mais ils m'en ont retiré pour m'envoyer garder la chèvre. Je passais mes journées avec elle. Juste au-dessus de nos têtes, il y avait des batailles aériennes. Les avions se mitraillaient et moi, j'étais là, les mains dans les poches. Un jour, en rentrant la chèvre, j'ai vu une voiture garée devant la ferme, une traction avant peinte aux couleurs de l'armée allemande, et des soldats chez mes logeurs. Je suis resté prudemment en arrière... Dans cette Chanson aigre-douce, je ne parle pas directement de la guerre, mais l'allusion est suffisamment poussée pour qu'on comprenne. Ce genre d'histoire, il en paraissait peu dans les pages de Pilote. Je me souviens de celle du « petit Biafrogalistanais », assez dure sur la famine des enfants. René Goscinny l'a lue devant moi et m'a dit en baissant les yeux : « Je suis fier d'être directeur d'un journal où des pages comme ça sont publiées. » Alors là, je me suis envolé."

______________________