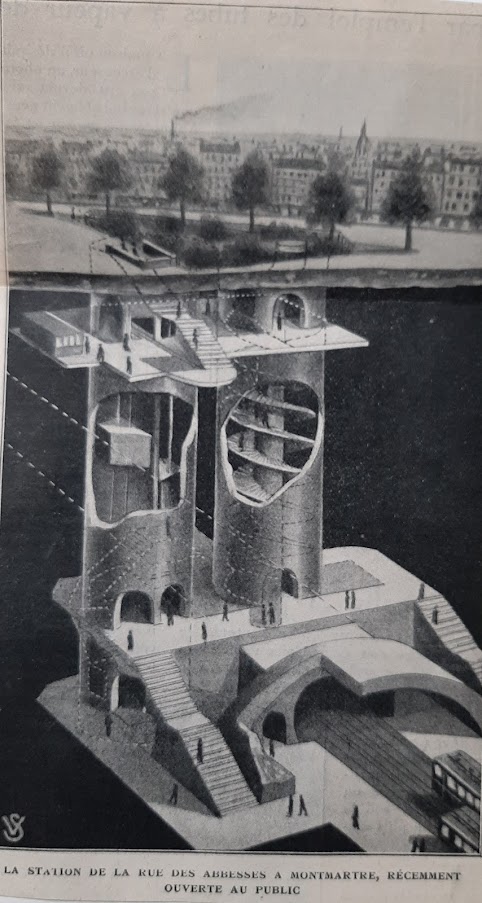"Nous ne prendrons que le début de la grande RUE ORDENER (2020 x 20 m) qui traverse le quartier d'est en ouest, et que nous dédions au sublime Rue Ordener Rue Labat de Sarah Kofman. Sarah Kofman (1934-1994) hante cette partie du 18e comme elle hantera peut-être ce livre."
Thomas Clerc, Paris Musée du XXIe siècle, Le dix-huitième arrondissement, Minuit 2024, p. 104.
J'avais noté ce bref passage lors de ma lecture (Thomas Clerc n'ajoute rien de plus), je l'avais noté car Sarah Kofman ne m'était pas inconnue, j'avais lu en effet il y a très longtemps son essai L'enfance de l'art.
J'ai tout oublié ou presque de cet essai, et n'ai jamais lu un autre livre de Sarah Kofman. Et puis voilà que samedi dernier, dans la belle librairie de Bourges qui se nomme Bifurcations, je vois Rue Ordener, rue Labat, réédition chez Verdier de cet ouvrage publié pour la première fois en 1994 (quelques mois plus tard, Sarah Kofman se suicidait, 150 ans jour pour jour après la naissance de Nietzsche - avec Freud, la figure centrale de son travail philosophique).
Un livre court, vingt-trois chapitres, d'une concision, d'une sobriété et d'une force étonnantes. Bereck, le père de Sarah, rabbin dans une petite synagogue de la rue Duc*, est arrêté à son domicile le 16 juillet 1942, il ne cherche pas à fuir, pensant que son arrestation permettra à sa femme et à ses six enfants d'échapper à la rafle. Il ne reviendra pas d'Auschwitz. Les enfants sont cachés dans diverses familles à Paris ou plus loin, mais la petite Sarah, 8 ans, ne supporte pas d'être éloigné de sa mère. Ainsi, placée dans une maison d'enfants juive, rue Lamarck, sa mère l'entend dans l'escalier pleurer, crier, hurler. Elle revient sur ses pas et repart avec elle. Dans la nuit qui suit, la Gestapo investit la maison rue Lamarck et tous les enfants juifs sont déportés : "Ma mère cria au miracle et décida de me garder avec elle, quoi qu'il arrive." Mais un jour, des scellés sont mis sur la porte et il faut chercher un autre refuge. Le recours le plus habituel est la "dame de la rue Labat", Claire Chemitre (Mémé), une ancienne voisine (ce nom n'est pas donné dans le récit).
Dans un article de Libération publié la veille, Frédérique Fanchette écrit que "l’hébergement d’un jour va durer jusqu’à la fin de la guerre. Et cette femme blonde, veuve et aimante, qui risque la mort en cachant des Juifs, va devenir une seconde mère pour Sarah. Ce que la vraie mère supporte mal tout en étant réduite à l’impuissance. Mémé embrasse trop l’enfant selon Feyga qui voit Sarah rhabillée de neuf, recoiffée, nourrie de viande saignante, s’éloigner du judaïsme. Sarah se sent parfois un peu coupable car sa préférence va clairement à Mémé, un épisode relatant la recherche de deux cadeaux pour la fête des mères lui en fait prendre conscience et elle rougit."
Je ne développe pas plus. Il faut lire ce livre dont Georges-Arthur Goldschmidt écrit, dans En attendant Nadeau, qu'il "est la bienvenue en ces temps de confusion, où les faits aiguisent la portée et l’actualité du passé".
Ce n'est pas tout. Un autre livre me fait signe. D'un auteur jusque-là inconnu, Romain Noël, qui signe La Grande Conspiration Affective, un thriller théorique, dans la collection de la Librairie du XXIe siècle, au Seuil (octobre, 2014). "La Grande Conspiration Affective part d’un double effondrement, personnel (une rupture amoureuse) et collectif (la crise écologique). Le livre propose un dispositif littéraire pour « en sortir » : le narrateur enquête sur les méthodes et travaux d’artistes contemporains, il convoque lectures et réflexions afin de reprendre pied. Au fil de ses rencontres, il entend parler d’un manuscrit perdu et d’un groupe mystérieux, la Grande Conspiration Affective, une société secrète qui l’intrigue tout autant qu’elle l’attire." (Extrait de la quatrième de couverture)
J'avais déjà décidé d'acheter le livre lorsque j'ai découvert à la première page de texte ces lignes : "J'aimerais commencer ma recherche là où Barthes a été forcé d'interrompre la sienne, pour cause de mort foudroyante, au niveau de la préparation du roman. Je me tiens sur le seuil où les choses changent et où l'inconnu nous oblige à parler, à écrire et à vivre autrement. C'est pourquoi je reprends la question fatidique posée par Sarah Kofman : comment s'en sortir ?"
____________________
* La rue Duc est aussi dans le 18e, aussi est-elle mentionnée par Thomas Clerc page 315 : "Au 5,se trouvait la synagogue dirigée par le rabbin Bereck Kofman, le père de Sarah Kofman. Vie antérieure : j'ai suivi un cours de S.K. en 1985 à la Sorbonne." La rue Labat, elle aussi dans le 18e, ne déclenche pas chez Clerc d'évocation de la "dame".