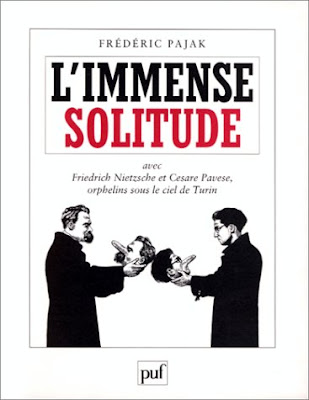"Dans nos moments de confusion
souvent j'éprouve le besoin
de contempler un lichen.
Apportez-moi une montagne
et je vous montrerai ce que je veux dire."
Hans Magnus Enzensberger, Ecriture braille, 1964.
J'ai terminé l'article précédent, consacré à Rainer Maria Rilke, en évoquant un ancien billet du 17 janvier 2017 où j'avais cité des extraits d'un même texte extrait de l'ouvrage de Pierre Desgraupes sur le poète. Le titre en était Le Titanic fera naufrage, lui-même titre de l'essai de Pierre Bayard paru en 2016, et qui commençait par ces mots : " L’écrivain américain Morgan Robertson n’a jamais dissimulé qu’il s’était inspiré dans son roman Futility, pour décrire l'odyssée dramatique de son navire imaginaire, le Titan, du naufrage du Titanic survenu quatorze années plus tard." Et j'enchaînai ainsi : "Ainsi commence le nouvel essai de Pierre Bayard, tout entier consacré à ces anticipations littéraires de l'avenir. Le paradoxe de la phrase illustre bien le caractère renversant de son hypothèse : les écrivains - il le montre avec force à travers plusieurs exemples puisés chez les plus connus, comme Kafka, et chez les moins connus, Frantz Werfel ou Eugène Zamiatine, par exemple - nous livrent des vues prémonitoires où catastrophes naturelles, guerres et accidents se taillent il est vrai la part du lion. Est-ce pour cela que ces oiseaux de malheur ne sont guère convoqués pour peser sur la marche du monde ? C'est pourtant ce que préconise l'essayiste, qui en appelle à leur confier des responsabilités politiques et à les associer aux recherches de la science. On ne sait trop à quel point Pierre Bayard ajoute foi à cette revendication, mais son humour très pince-sans-rire doit nous inciter à la prudence."
Au moment où je publie, le 2 décembre à 10 h 15, je m'aperçois qu'un article de Diacritik vient de paraître deux heures plus tôt, intitulé Yves-Noël Genod, « Titanic, hélas ». Evoquant la fin d'un spectacle mis en scène par Yves-Noël Genod, sur la péniche La Pop amarrée sur le bassin de la Villette*. J'ai envie bien sûr de signaler cette résonance, mais bon, je m'en abstiens cette fois-ci.
Oui, mais le Titanic ne se laisse pas si facilement oublier : le lendemain le voici qui redébarque, si j'ose dire, dans le chapitre 14 de L'impitoyable aujourd'hui, cet essai de l'historienne Emmanuelle Loyer qui est si délectable que je n'en lis qu'un chapitre par jour (il y en a 20, et il m'en reste encore quatre à l'heure où j'écris). J'aurai l'occasion d'en reparler plus longuement, mais restons sur ce chapitre 14, Halluciner l'histoire - c'est le titre -, où elle commence justement par évoquer l'essai de Pierre Bayard :
"Ecrire la catastrophe, c'est la reconnaître lorsqu'elle a eu lieu ; c'est comprendre et décrire comment elle a vampirisé les décennies qui l'ont suivie et estampillé les lieux qu'elle a touchés - souvent bien au-delà de leur géographie initiale.
Mais ce peut être aussi écrire, en somnambule, les yeux ouverts sur un avenir sombre, la catastrophe à venir. Pour prédire la catastrophe, il faut d'abord l'imaginer. En réalité, comme le plaide Pierre Bayard dans un stimulant essai et exemples à l'appui, les portes de l'anticipation sont largement ouvertes à la littérature qui accouche bien souvent de prémonitions étonnantes de justesse, jusqu'à un degré parfois troublant de précision dans la prédiction." (p. 231)
Et jamais deux sans trois : le lendemain encore, 4 décembre, voici que Bernard Umbrecht publie dans son Saute-Rhin (blog inscrit dans ma catégorie Autres sentes) un hommage à l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger (1929-2022), qui vient de disparaître le 24 novembre dernier. Il s'intéresse ici essentiellement au versant poétique de son oeuvre, à travers trois contributions d'amis. Or la troisième est Weitere Gründe dafür, daß die Dichter lügen / Encore des raisons qui font que les poètes mentent, un extrait de Le naufrage du Titanic, Une comédie. Chant 18. NRF Gallimard.1981.

Ce n'est pas tout. Il se trouve que lors de ma dernière sortie à la médiathèque, à la recherche d'Adèle Blanc-sec, j'ai rapporté par la même occasion le Lichens de Vincent Zonca. Rien à voir en apparence, sauf que l'une des deux citations épigraphes de ce livre consiste en ces vers de Hans Magnus Enzensberger que j'ai reproduits en tête de cet article. On retrouve l'écrivain dans le corps de l'ouvrage, par exemple à la page 75 où Vincent Zonca évoque la famille des Graphidaceae, "le lichen préféré des écrivains et donc le mien. L'espèce la plus connue est le Graphis scripta, appelé aussi "lichen script", "lichen à écriture secrète", très commun dans les campagnes françaises. Ses organes de fructification (les apothécies) dessinent sur le thalle de petits traits fendus, qui peuvent être simples, ramifiés, ou encore en forme d'étoiles et ressemblant à s'y méprendre à une écriture ou à une ponctuation (...)".

Et Zonca poursuit ainsi : "Ils sont nommés lirelles, du latin lira, le sillon de la charrue, comme s'ils étaient tracés par un soc : ils renvoient, en cela, à l'imaginaire (lira a donné en français "délire", c'est-à-dire "sortir du sillon"- et à l'écriture (en latin, le sillon de la charrue, c'est aussi le "vers", versus, de poésie). Tapissant les branches ou s'enroulant autour des rameaux des feuillus, ces lichens sont une invitation au déchiffrement : lire les lirelles, les voir et les toucher, comme du braille - titre d'un recueil du poète allemand Hans Magnus Enzensberger (né en 1929) :
Le lichen a son graphisme
ses inscriptions son écriture
chiffrée qui décrit
un silence prolixe
Graphis scripta.
On le retrouve aussi à l'ouverture du livre III, à côté d'Henri Michaux (dont je ne peux me retenir de citer l'aphorisme extrait de Poteaux d'angle : "Faute de soleil, sache mûrir dans la glace"), avec ces deux vers issus de La Fureur de la disparition (1980) : "Le lichen sur le poteau/survit." Qui me fait aussitôt penser à ces poteaux de béton lichenisé que j'aime à photographier lorsque je vais me promener sur les berges de l'Indre, sur le chemin dit du Lavoir (un lavoir qui n'existe plus).
Dans l'index des noms propres, Enzensberger voisine avec un autre poète, français celui-ci, qui a porté aussi une haute attention au lichen : Antoine Emaz (qui faisait ici même le sujet de l'épisode 6 de Cristal noir). C'est même lui qui donne la raison du sous-titre de Lichens, Pour une résistance minimale, à travers un texte d'entretien donné pour la revue Nu, en 2006 :
"Il y a une forme de résistance minimale dans le fait simplement d'écrire de la poésie encore et malgré tout. Pour combien de personnes ? Pour cent, deux cents lecteurs ? C'est fou ! On n'est plus dans la logique de ce monde. Et pourtant, je continue à passer ma vie, mes heures, à travailler pour cela. Il y a bien un engagement. Quant à l'espoir pour la poésie, je n'ai aucune crainte à ce sujet. La poésie s'est déjà suffisamment dégradée sur le plan de l'économie, du lectorat, pour qu'il ne puisse plus rien lui arriver. [...] Donc l'espoir - on va parler d'un espoir raisonnable - existe. La poésie n'est pas un feu d'artifice qui brille, se remarque de loin, mais qui dure peu de temps. Je la vois plutôt comme une veilleuse ou un lichen. [...] Le lichen est habitué aux milieux hostiles. Lorsque les conditions de vie deviennent impossibles, il tombe en léthargie pour renaître dès qu'elles redevient acceptables. Il me semble que la poésie traverse de telles phases, sans jamais disparaître tout à fait." (p. 190-191)

Finissosn en reparlant de l'autre Adèle, Adele Bloch-Bauer, dont Gustav Klimt fit le portrait au début du siècle dernier. J'ai écarquillé les yeux lorsque je l'ai vue à la une du numéro 4 du magazine Le musée idéal.

Je n'ai pu faire autrement que d'acquérir l'exemplaire. L'article de la revue ne m'apprit pas grand chose de plus, mais quand j'en eus fini la lecture, et que je retournai au livre de Zonca, il se trouva que la page sur laquelle je l'avais laissé se terminait ainsi, par l'évocation de Prunus blanc et prunus rouge en fleurs, de Chen Hongshou : " On retrouve, sur le tronc, ces ornements de lichens foliacés (Parmotrema), dont le vert clair, prolongé par les étendues de quelques mousses ou lichens lépreux sur l'écorce, contraste, à droite, avec le rouge complémentaire des bourgeons et des fleurs. C'est que, dans la peinture japonaise, les lichens font fleurs, elles sont esthétiquement des fleurs des fleurs au même titre que celles du prunus. Ce tableau m'évoque le raffinement et les contrastes de certaines toiles expressionnistes de Gustav Klimt." (p. 313, je souligne) C'est par ailleurs la seule apparition de Klimt dans l'ouvrage.**
________________
* "Ce week-end, à contrecœur et presque en douce, Yves-Noël Genod faisait ses adieux à la scène, sur la Seine. Dans la cale d’une péniche parisienne, ses fans s’entassaient sous des manteaux, des plaids, et quelques gilets de sauvetage pour entendre son Titanic, hélas (c’est le titre), révérence tirée à une carrière qui prenait l’eau. Tandis que l’artiste disparaissait dans le noir, main dans la main avec une vieille dame au dos voûté, maquillée de fards colorés et gantée jusqu’aux coudes comme les chanteuses de music-hall, le froid et l’émotion faisaient naître de la buée sur les hublots. Que s’est-il donc passé, dans la société, pour qu’on doive se passer des dingueries d’Yves-Noël Genod ?" Eve Beauvallet, dans Libération (article réservé aux abonnés).
** Il me faut aussi dire deux mots de Munch, dont Le Cri décidément me poursuit (sur un mode plutôt cocasse, on va le voir, fort heureusement). M'étant rendu chez la coiffeuse de la rue de Strasbourg pour une action disciplinaire sur ma chevelure, je me trouvai en voisinage de shampouinage (le salon est mixte) avec une dame qui informa l'assemblée qu'elle était allée avec une sienne copine voir l'exposition à Orsay de Munch et de Rosa Bonheur. Elle me montra même la photo qu'elle avait prise de la lithographie du Cri qui siège là-bas.
Enfin, ayant repris la lecture de Résonance, l'imposant essai d'Hartmut Rosa (quatre ans que je suis sur ce livre, c'est fou), et revenant en arrière au hasard, j'ouvris directement sur la page 329 où je lus ces lignes (que j'avais donc parcourues mais que j'avais depuis longtemps oubliées) : "Ecouter le Voyage d'hiver de Schubert ou l'opéra rock The Wall de Pink Floyd (ou s'absorber dans Le Cri d'Edvard Munch) sur un mode de résonance dispositionnelle, c'est donc éprouver simultanément deux modes de relation au monde : c'est être touché, ému, saisi par la forme même que le traitement esthétique confère à l'aliénation existentielle soit faire à la fois l'épreuve d'une résonance et d'une aliénation, les deux étant non pas fondues en une forme hybride mais unies par un rapport d'intensification réciproque : plus l'aliénation représentée ou modelée est "authentique", crédible et irrésistible, plus l'effet de résonance est grand."












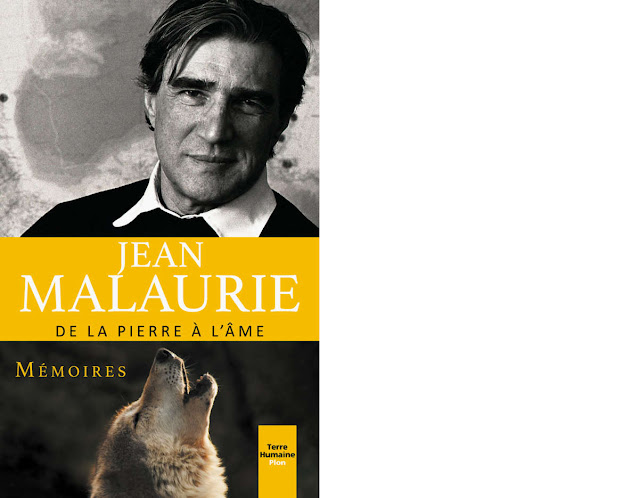




_5702a.jpeg)