Gardien de chats, cela laisse du temps libre. Remplir les gamelles, nettoyer les litières, caresser de temps à autre les deux matous, la tache n'est pas exorbitante. Et si j'ai arpenté quelques musées, j'ai aussi beaucoup lu. Par exemple, Changer : méthode d’Édouard Louis, qui était dans la bibliothèque de Gaby. Son quatrième récit autobiographique (je n'avais lu jusqu'ici que Qui a tué mon père, Seuil, 2018), où il revient sur son enfance, son adolescence, et son itinéraire de transfuge de classe, avec tout le travail accompli sur son corps pour masquer son origine prolétaire : attention aux gestes et à la voix (accent qu'il faut perdre), manières de manger, garde-robe renouvelée, dentition refaite (grâce à de généreux mécènes), culture littéraire et musicale à absorber à fortes doses, etc. Un parcours édifiant, souvent douloureux, jalonné de rencontres déterminantes, mais qui passe aussi par des mensonges et des abandons d'amitié (qui laissent plus d'une fois songeur - et c'est sans doute que notre conception de l'amitié ne peut s'affranchir de la fidélité et de la permanence).
Et puis, non loin de l'appartement, sur cette longue avenue de Grammont, mon fils m'avait signalé la librairie Les Temps sauvages, librairie coopérative (la meilleure de Tours, m'avait-il précisé). Sans doute avait-il exagéré, mais j'y dénichai en tout cas un livre que j'avais vainement cherché jusque-là. Un petit livre de 80 pages, dont j'avais lu la chronique dans le Libération du 30 mai dernier : Treize années à te regarder mourir (éditions du commun), par Benjamin Daugeron.
La chronique de Libé commençait ainsi : "C’est un petit livre qui tient dans la poche et laisse sa marque. Un livre rouge, court, simple dans son expression, direct, carré, comme s’il fallait maintenant mettre de l’ordre et faire les comptes. Treize années à te regarder mourir dit où, quand, comment, combien, et commence par une naissance : «André est né à La Châtre dans l’Indre, en plein cœur du Berry. Le Berry c’est loin. Loin de tout. La grande ville, la mer, la montagne, tout est loin.» "
La Châtre, où je suis allé au lycée (George Sand, évidemment), où j'ai habité plus de dix ans, où j'ai rencontré Fred Deux et Cécile Reims, où je retourne régulièrement pour visiter ma mère, entrée à l'ehpad. La Châtre, au beau milieu de la diagonale du vide, écrit encore l'auteur. Son père, André, y naît le 12 octobre 1964. Daniel, le grand-père, est ouvrier agricole, "malade de l'alcool comme ses frères et sœurs, et comme ses parents, ses oncles, ses tantes, et peut-être même ses grands-parents avant lui." D'emblée, le grand thème du livre est donc posé : «Un alcoolisme qui n’est pas le fruit d’une tradition ou d’une culture mais qui est déjà le témoin à l’époque d’un renoncement à l’avenir de toute une catégorie de population abandonnée, laissée à elle-même. L'alcool est un moyen de sortir du réel, d'accepter le poids de l'existence, sa fatalité."
Fatalité, peut-être pas. Il a raison de dire que l'alcoolisme n'était pas le fruit d'une tradition ou d'une culture : mon propre père était aussi ouvrier agricole, et son père avant lui, qui n'a jamais eu que quelques hectares de terre, deux vaches et un âne. Et pourtant, dans cette famille, je n'ai observé aucun cas d'alcoolisme. De même dans ma famille maternelle, paysanne elle aussi. Et je connais beaucoup d'autres familles semblables. Ce n'est pas pour dire que l'alcoolisme n'existe pas dans les campagnes et que seule cette malheureuse famille Daugeron en aurait été frappée. Non, c'est un phénomène social bien réel, et Benjamin Daugeron en donne un témoignage bouleversant. Le livre est dédié à Colette, sa grand-mère, dont il relate le chemin de croix. Elle essaie par deux fois d'obtenir le divorce d'avec Daniel, son mari violent et violeur, mais la justice, reconnaissant son alcoolisme comme une maladie de longue durée, rejette la demande en divorce. Un peu plus tard, il se suicide d'un coup de carabine.
A partir de là, à partir du second chapitre, le fils s'adresse au père. André, qui vit dans un appartement de la ZUP 1, seul, avec comme éternelle compagne la télévision : "Tu ne comptes plus les heures passées devant la télévision. Tu ne t'ennuies même plus. Tu fixes l'écran, le regard vide. Il t'anesthésie. Il amollit tout ton corps, anéantit tes capacités intellectuelles et participe à détruire tout espoir d'une vie nouvelle." De même, Édouard Louis dans Changer : méthode, s'adresse à son père : "Tu m'avais appris qu'il fallait regarder la télévision à table, que l'heure du repas était celle où on regardait la télé en famille, les informations du soir et ensuite un film ou une série. Si ma mère essayait de parler ou si je voulais raconter une anecdote de ma journée à l'école tu t'énervais, tu nous disais de nous taire. Tu disais que regarder la télé le soir était une affaire de politesse. A la maison il y avait quatre ou cinq télévisions, tu allais les chercher à la décharge et tu les réparais, une télé dans chaque chambre, une dans la pièce commune. On la regardait le matin avant d'aller à l'école, le soir avant de dormir, les après-midi pendant le week-end."
Il y a ainsi des parallèles frappants entre les deux récits. Ce n'est pas un hasard, les mêmes déterminismes sociaux sont à l’œuvre, provoquant les mêmes dégâts irréversibles. Benjamin raconte la descente aux enfers de son père, qui sombre aux alentours de ses 32 ans, après le diagnostic de cancer à l'âge de six mois du fils cadet : "Bien que soigné avec succès, c'est à l'hôpital que tu prends de mauvaises habitudes. Il faut oublier la mort qui plane, se détendre après la chimio du petit, alors tu sors boire un coup, puis deux deux, voire trois. Tous les soirs." Le petit s'en sort, mais André continue de boire, le couple se fissure, la violence s'installe, à tel point que Benjamin appelle la police contre son père. Il a 8 ans. André reste seul. La maison de la rue de la Rochette est vendue, et l'argent de la vente vite dilapidée. Perte de la famille, perte du travail, la santé qui se détériore de jour en jour. "Tu passeras des années devant ton écran de télévision à attendre la mort."
Dans L'effondrement, un autre livre (que je n'ai pas lu), Édouard Louis raconte comment son grand frère s’est définitivement «effondré» à 38 ans. Il a été retrouvé sur le sol de son appartement inconscient, «comme un animal à l’agonie, comme une bête». Ses organes étaient dégradés par l’alcool, son cerveau endommagé, sa mère a autorisé l’équipe médicale du service de réanimation à le débrancher. «Il était mort mais elle était la seule à avoir le droit de le faire mourir. Il avait trente-huit ans.»
C'est Colette, la grand-mère, qui va chez son fils et le découvre gisant derrière la porte du salon. "Vert. Jaune. Marron. Gonflé. Méconnaissable. Mort." Mort trois jours avant. "Trois jours de putréfaction de la viande dans une pièce chauffée à 22° C ont rendu l'autopsie difficile et presque impossible la détermination exacte de la mort."
La suite est édifiante : "Il faut voir comme les agents publics nous regardent à notre arrivée au tribunal pour signer une renonciation à la succession. La justice lit sur nous la pauvreté. Nous sommes ce que les gens qui n’en sont pas appellent des “cas sociaux”. Le ton avec lequel la fonctionnaire qui nous reçoit s'adresse à nous est équivoque. Je sens encore le poids de son regard de mépris sur mes épaules. Peut-être que le soir en rentrant chez elle, elle parlera de nous à son mari en disant les "cassos". C'est comme ça que je le vois écrit sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les Blancs privilégiés qui m'entourent disent à l'école."
Benjamin Daugeron n'est pas resté un "cassos", il n'a pas connu la trajectoire foudroyante d’Édouard Louis, mais il a réussi à intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles option économie à Orléans, puis il est allé à Paris, où il vit désormais. Il a surtout écrit ce livre courageux, qui n'aura certainement pas un grand succès public (j'espère me tromper), mais qui mérite vraiment le détour.
Je l'avais demandé dans les deux librairies existant à La Châtre. Il n'y était pas. On ne savait rien de lui. J'ai lu que Gaël Faye avait été reçu récemment dans l'une des deux. C'est bien. Mais il faut inviter aussi Benjamin Daugeron. Le malheur n'est pas qu'en Afrique, il est aussi parfois au coin de sa propre rue.
 |
| Ayline Olukman - America |
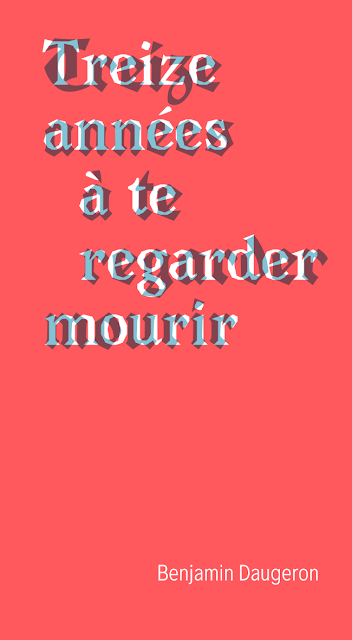
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire