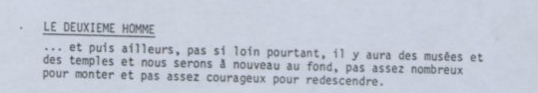Le 28 novembre dernier, j'ai eu 60 ans. Comme me l'écrivait un grand ami - par ailleurs président de l'honorable confrérie des Tasons - "nous voilà rendus à l'âge de notre millésime, ça a de la gueule." A cette formule sur carte postale bleue, sa douce et lui-même avaient joint un cadeau magnifique : Cathédrale Cardon, de ce dessinateur que j'avais connu par Le Canard enchaîné, et dont la poésie dépassait de loin la stricte charge politique.
Les grands dessins pleine page, qu'il n'est pas usurpé de qualifier de vertigineux, sont précédés d'un texte de l'artiste, signé de son nom complet, Jacques-Armand Cardon, évoquant son enfance pendant la seconde guerre mondiale : père prisonnier en Allemagne qui succombe à un bombardement, exode en Bretagne, toute la famille dans une seule chambre, résistants pendus aux poteaux et aux balcons, instituteur aux yeux crevés, et puis in fine, au retour à Paris, cet éblouissement : Notre-Dame, un choc visuel qui ne le quittera plus : "La guerre nous avait tellement éparpillés, explique-t-il sur France Culture, qu'il fallait regrouper quelque chose dans un récipient. Et la Cathédrale de Notre-Dame de Paris s'est imposée à moi directement. C'est dans ce monument-là où j'ai pensé que la cuisine, ce que j’avais l'intention de dire, ce que la vie me forçait encore à dire pour m'en débarrasser, allait trouver son espace dans ce que représentait cet énorme bâtiment."
Il dit encore, dans cette même émission, ce qui constitua la première résonance à ce nombre symbolique de 60 que j'avais donc atteint ces jours-ci : "Ce livre s'écrit depuis 60 ans, on est comme un scaphandrier qui descend soi-même pour faire remonter à la surface des épaves ou des visions profondes. Il y a du ressenti physique, des malaises, de l'intranquillité permanente, sans le père qui est là pour vous rassurer, il faut avoir une résilience, essayer de compenser l’absence par un surcroît d'imaginaire. Il a fallu que je me débarrasse noir sur blanc, c'était lourd à porter."
Quand j'eus enlevé le papier cadeau bleu de chez Mollat, je posai le volume sur la table basse du salon, sur un autre livre, cadeau personnel celui-ci, le Chardin d'Alexis Merle du Bourg, de chez Citadelles et Mazenod, que je venais de recevoir peu de temps avant.
Je m'avisai alors seulement de la cohérence de l'association : il en va un peu comme de ce jeu où il faut passer d'un mot à un autre en changeant une seule lettre à chaque fois : Cardon - Chardon - Chardin. On notera aussi que le RD central chez Cardon et Chardin se retrouve en miroir dans cathéDRale, ce qui, outre la syllabe initiale commune, montre que le titre de ce livre n'est nullement anodin.
A ce premier présent amical cardonien, s'ajoutèrent les livres offerts par ma compagne : le premier était Politique de la mélancolie, un recueil d'essais autour de W.G. Sebald, édité par Muriel Pic, elle-même contributrice. C'était fort bien vu, d'autant plus remarquable qu'elle ignorait que j'avais commandé peu avant le dernier texte de Muriel Pic, Affranchissements, publié au Seuil dans la collection Fiction § Cie. Lequel arriva trois jours plus tard, et je le lus pour ainsi dire sur-le-champ, comme s'il devait me donner une réponse aux questions que je me posais sourdement. C'est bien sûr toujours une illusion, mais j'eus au moins le plaisir d'y observer toute une chaîne de résonances (je venais de reprendre la lecture du grand livre d'Hartmut Rosa - Résonance, une sociologie de la relation au monde - et j'étais donc plus que jamais attentif à tout ce qui pouvait s'inscrire dans cette perspective). Ou, dit autrement, un bouquet de ces lucioles, petites bulles synchroniques, minuscules coïncidences crevant à la surface des jours.
Ce fut tout d'abord, dès l'incipit du récit, cette mention de William Carlos Williams, le grand poète américain lié à sa ville de Paterson, que j'ai souventes fois évoqué en ces pages. Un peu plus loin, c'est le tour du grand-oncle de la narratrice, Jim, né en 1923, mort en 2001. Comment ne pas penser à Jim Jarmusch, le réalisateur du film Paterson ? Curieusement, il n'en sera jamais fait mention (mais il est vrai que le cinéma n'apparaît guère dans le récit de Muriel Pic).
Traçant le portrait de cet oncle Jim, célibataire et bossu à cause du mal de Pott, une sorte de tuberculose osseuse, elle en vient à parler de cette lame du Tarot parfois dénommée l'Hermite, avec un h (représentée dans le livre - qui use de la photo et du dessin à l'instar de son modèle sebaldien). Encore une fois, c'est une figure connue à laquelle j'ai consacré peu ou prou quelques articles en 2016. Dans l'un de ceux-ci - L'hôte le plus étrange que Riva ait connu - je cite ce passage d'un livre de Sebald, Vertiges, où le Dr K. assiste au départ de la jeune
Génoise, ondine, sirène, nymphe, ainsi qu'il la désigne, génie des
eaux en tout cas, qui lui évoque, au moment précis où elle franchit, "d'un pas incertain, écrit-il, l'étroite passerelle pour monter à bord du vapeur",
une scène datant de quelques jours, où, autour d'une table avec une
poignée de personnes, une jeune Russe, très riche et très élégante, "par ennui et par désespoir", précise-t-il encore, leur avait tiré les cartes à tous.
"Comme il en va la plupart du temps en ces circonstances, il n'en était rien ressorti de bien sérieux et l'épisode avait plutôt tourné au futile et au ridicule. Seulement, quand la dame russe en était arrivée à la jeune fille de Gênes, les cartes avaient présenté une combinaison sans équivoque, et elle lui avait annoncé que jamais elle ne contracterait ce qu'on a coutume d'appeler les liens du mariage. Le Dr K. avait alors ressenti une étrange inquiétude à l'idée que cette jeune femme vers qui le portait toute son inclination et que pour lui-même, depuis qu'il l'avait aperçue, il appelait, à cause de ses yeux vert d'eau, la sirène, que cette jeune femme et personne d'autre s'entendait prédire par les cartes une existence de célibataire, en dépit du fait que rien en elle ne laissait présager la vieille fille ; si ce n'est peut-être la coiffure, dut-il s'avouer en la voyant pour la dernière fois, en train d'esquisser de la main gauche, la droite reposant sur le garde-corps, un peu maladroitement, le signe voulant dire : tout est fini."
Je me demandais alors quelle pouvait être cette combinaison sans équivoque décrite dans le texte. Une combinaison impliquant plusieurs cartes, j'écrivais que "celle qui s'impose à l'évidence pour un célibat, c'est précisément l'Ermite que j'ai évoqué récemment".
Muriel Pic écrit de son côté que "le tarot est un art d'imaginer juste à partir d'un nombre d'images données". Elle poursuit ainsi : "Je dispose devant moi celles que j'ai collectées à propos de Jim, photographies, timbres, cartes postales, dessins, cartes à jouer, livres, et bouts de textes. Les fragments se combinent pour raconter un épisode possible de sa vie, mais je dois continuellement rejouer la partie, car une seule configuration n'est pas suffisante pour saisir son personnage vernal et ses histoires d'affranchissements. Je les compte, cela fait soixante documents, nombre que la symbolique associe à la neuvième lame du tarot, qui représente le karma général de l'univers et désigne le globe terrestre." (p. 40-41)
Je suis mitigé sur cette dernière phrase car je me demande où Muriel Pic a pris cette information sur le lien de 60 avec la lame de l'Ermite. Rien dans le Dictionnaire des Symboles de Chevalier et Gheerbrant ou dans L'univers inconnu du Tarot, la somme de Robert Grand, ne signale ce fait. Le karma, concept oriental, hindou ou bouddhiste, n'a pas grand chose à voir avec le tarot. Quant à la désignation du globe terrestre par 60, c'est là aussi un mystère. Ceci, par ailleurs, importe peu, Muriel Pic n'écrit pas un traité de symbolique et seul compte pour moi en définitive cette irruption du soixante dans sa narration.
Continuons donc de la suivre dans son cheminement sinueux. Page 63, dans un chapitre intitulé pas par hasard 0 (ils portent tous un millésime), elle confesse qu'au printemps 2017, elle s'est trouvée dans un profond désordre intérieur : "J'approchais du milieu de ma vie, je voulais tout envoyer promener, et je menais avec moi-même de longs entretiens sur le vertige." Tiens donc, le vertige... Elle ajoute aussitôt : "A présent, je me dis qu'il fallait sans doute en passer par là pour retrouver Jim." Elle retrouve alors dans ce grenier des enveloppes envoyées par Jim jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle n'avait pas ouvertes depuis septembre 1998 : "Avec ces pensées troubles, j'ai commencé à ouvrir les enveloppes les unes après les autres, en suivant scrupuleusement leur ordre chronologique, sans doute pour vaincre le vertige qui m'envahissait de m'aventurer dans un imprévisible passé." (p. 65) Imprévisible passé, l'oxymore est beau (le futur ne serait donc pas seul à être imprévisible ?) : il y a bien de quoi craindre le vertige.
J'en étais là de ma lecture, en cette page 65, lorsqu'un autre ami m'appela au téléphone. Le Baroudeur, qui ne baroude guère en ces temps de pandémie, et qui me pose une question sur le sens de l'expression "au tournant du troisième millénaire avant J-C." Le IIIe millénaire av. J.-C s'étendant de 3000 à 2001 av. J.-C, le tournant se place donc à l'an 3000. (Bon, on a parlé d'autres choses aussi, il ne faut pas croire...).
Or, la phrase suivante du récit de Muriel Pic, après celle de l'imprévisible passé, était celle-ci : "Et, de fait, j'ai revécu, enveloppe après enveloppe, puis timbre après timbre, , les dernières années de la vie de Jim et, avec elles, ce à quoi je ne m'attendais pas, notre passage au troisième millénaire." Une belle synchronicité.
Le lendemain, j'atteins le chapitre 1949 bis, où Pic raconte que lors d'un séjour à la montagne, un jour de mauvais temps, elle furète dans la bibliothèque de ses hôtes et débusque une anthologie bilingue de poèmes de William Carlos Williams, traduits par Hans Magnus Enzensberger. Et elle lit pour la première fois le poème qui donne son titre au recueil, The Words, the Words, the Words. J'en donne ici le début et la fin :
Le parfum de l'iris, citron doux,
l'argent le transfigure, transfigure aussi
l'odeur de la femme, l'odeur du sarrasin. [...]
Dame derrière la haie, derrière le
mur :
membres de soie, front clair,
l'argent tombe à travers la diagonale
des feuilles sur toi
Debout, secoue tes robes
pour les renoncules, jaune frotté comme
l'or
Elle pense que Williams a certainement écrit son poème avec des manuels de botanique sous les yeux. "Il aura pu lire, écrit-elle, le nom latin de l'iris jaune, Iris pseudacorus, et son nom vernaculaire, lingot d'or ou gold bar en anglais.* Dans le premier vers en tout cas, il est bien question de cet iris qui a la couleur du citron doux, l'iris jaune lingot d'or l'entrée du poème, tout comme la renoncule (ou bouton d'or) au dernier vers, les deux fleurs du premier printemps."
 |
| Bouton d'or (Ranunculus Repens) |
"Il est cependant évident, poursuit-elle, qu'outre un manuel de botanique, Williams écrit aussi avec un livre de beaux-arts sous les yeux ou avec le souvenir d'un tableau en tête. Il pense à l'iconographie de l'épisode mythologique de la pluie d'or, événement qui féconde Danaé, jeune fille au nom de fleur. [...] Danaé est une vierge aux longues tresses à la mode grecque qui habillent son cou d'oiseau, séparent en deux l'arrière de sa tête et dégagent sa nuque couverte de duvet. Elle a été enfermée dans une tour aux portes de bronze par son père."
 |
| Danaé et la pluie d'or, par Orazio Gentileschi (1563–1639) Cleveland Museum of Art |
Portes de bronze... A ce stade, je frémis. Je frémis parce que ce sont les premiers mots du texte de Cardon : "Porte de bronze !... Porte de bronze !... opposait ma tante Antoinette, soeur aînée de ma mère, aux questions inopportunes. Outre le doigt sur les lèvres, sa sévérité affichée d'initiée imposait silence sans appel. Que pouvait donc bien celer cette porte imposante dont les lourds vantaux devaient résonner longtemps à chaque ouverture ?"
On retrouvera ce thème au terme du texte, quand s'impose la vision de la cathédrale au jeune Cardon :"Tout cela n'était que plaisir et regard gourmand. Ce que j'avais devant moi dépassait tout ce que j'avais pu imaginer pour la porte de bronze."
J'en finis là pour aujourd'hui, de cette pluie de lucioles. Mais ce n'est pas terminé, il sera encore question de Cardon et de Pic, de Pic et de Cardon, et de bien d'autres choses.
_____________________________
* Une fois encore, je suis obligé de mettre en doute les assertions de Muriel Pic. En cherchant une illustration de cet Iris, je ne trouve aucune mention de ce nom vernaculaire de lingot d'or. Ce n'est pas faute d'avoir cherché : sur Tela Botanica, l'encyclopédie botanique collaborative, à la section ethnobotanique, je découvre 32 noms communs de la fleur. Aucun ne correspond à lingot d'or. (ou gold bar).
[Ajout du 11/12 : Déniché ce matin, grâce à ma compagne, un Iris Lingot d'or qui pourrait bien être la matrice du récit picquien : l'Iris "Lingot d'or" de Gamm Vert, "n°1 de la jardinerie (13, 90 euros, produit actuellement indisponible). Le texte de présentation a peut-être même directement inspiré la traduction du poème. Qu'on en juge : "Un iris en harmonie de jaune. 'Lingot d'or' a des pétales blanc veinés de jaune citron doux, sépales jaune d'œuf ultra vif à barbes jaune orangé bordées de petites stries brunes." On retrouve en effet le "citron doux" du poème, qui traduit le sweet citron de Williams. Il reste que cette appellation "Lingot d'or" désigne ici un produit de la marque Gamm Vert, ce n'est pas à proprement parler un nom vernaculaire.]